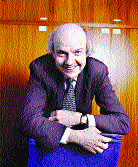
|
| Tina
Merandon |
|
Le
réseau de résistances
Les portraits des internautes
créateurs de sites citoyens
Pierre
Lazuly
Pour une vraie
société sociale
Meryem
Marzouki
Le Net marchand
nous menace
Erwan
Cario
A bas les
friconautes
Joëlle
Palmieri
Le point com des
femmes
|
|
Enseignant, Alain Busson a longtemps étudié de près
les pratiques sociales et culturelles des Français. Aujourd'hui, il
est délégué général de l'Observatoire des télécommunications dans la
ville, une association créée en 1991 qui rassemble, entre autres,
les associations nationales d'élus et de responsables territoriaux.
A travers une publication régulière de guides et par l'intermédiaire
de son site Internet (www.telecomville.org), elle invite au partage
d'expériences et explore les enjeux de la société de l'information.
Télérama : Quelle est la nouveauté essentielle issue
d'Internet ?
Alain Busson : Pour la
première fois dans l'histoire des médias, on est en présence d'un
système décentralisé : la croissance se fait par la périphérie,
pas par le centre. On peut, si on veut, comparer au téléphone qui
fonctionne sur l'accumulation de connexions complémentaires. Mais ce
réseau-là est pauvre : il n'utilise que la voix alors que, par
le Net, on a le son, l'image et le texte. Avec Internet, il n'y a
plus de structure pyramidale, chacun a la possibilité d'autoproduire
pour l'ensemble. Ce type de fonctionnement se retrouve au niveau
macroscopique et microscopique : la société en réseau renverse
les points de vue. Le politique n'est plus le seul organisateur du
pouvoir, l'enseignant dans sa classe ne doit plus se penser comme le
détenteur du savoir, l'artiste ne peut plus se considérer comme
faisant partie d'un monde un peu à part, un peu sacré.
Télérama : Quels sont les risques ?
Alain Busson : Le plus grand, c'est de créer des
exclus à cause des barrières financières et culturelles. Pour éviter
la fracture numérique, il faut donc avant tout multiplier les accès
publics à Internet. Il est un peu tôt pour faire un bilan, mais il y
a aujourd'hui beaucoup d'initiatives au niveau local. La ville de
Brest, par exemple, a développé ces accès publics en partant du
principe que chaque habitant ne doit pas en être éloigné de plus de
500 mètres. Ce ne sont pas des cybercafés où chacun peut venir
surfer, mais des lieux d'initiation, de sensibilisation, avec un
encadrement assuré par des gens suffisamment impliqués. Aujourd'hui,
il y en a de 1 500 à 2 000 en France. Les opérateurs privés ont
plutôt tendance à développer les réseaux là où il y a un
marché ; les collectivités locales se doivent d'apporter un
effet correctif. La conception française de l'aménagement du
territoire va dans le sens de l'égalité des chances. Permettre à
tous de s'approprier les nouvelles technologies en fait partie afin
que chacun soit l'acteur de sa propre vie et de son propre quartier.
Télérama : Dans un système où il n'y a pas de
centre, que devient la notion d'Etat ?
Alain
Busson : On n'a pas aujourd'hui de réponse définitive, bien
sûr. Deux tendances opposées s'affrontent. La première, c'est la
globalisation, la mondialisation. Un petit fabriquant de pièces
mécaniques de Clermont-Ferrand peut traiter ses affaires en direct
avec n'importe quel client de la planète. Mais plus la
mondialisation s'amplifie, plus il y a besoin d'identité locale. Ça
peut conduire à des dérives très regrettables comme les
nationalismes, c'est vrai. Mais l'échange n'a de sens et de valeur
que s'il se fait sur la différence. Du coup, - c'est la seconde
tendance - il y a recentrage sur le territoire local, mais avec une
ouverture nouvelle. Il faut créer de nouveaux liens de proximité,
reconstruire une identité en tenant compte de l'ouverture globale.
Je crois totalement au retour du politique, d'une manière réinventée
qui tiendra compte de ces données et constituera alors un ciment
fort.
Télérama : Une nouvelle forme de service
public ?
Alain Busson : Aujourd'hui, le
service public a besoin de prouver son utilité sociale pour acquérir
sa légitimité. A quoi on sert ? Comment correspondre avec les
gens ? Ces questions reviennent souvent dans un certain nombre
de mairies où les employés se rendent bien compte qu'ils ne
répondent qu'à 20 % ou 30 % des demandes. Les conséquences sur les
organisations internes et sur les circuits d'information sont
directes. D'abord pour les petits problèmes quotidiens. A Parthenay,
par exemple, s'il y a une panne d'éclairage dans une rue, grâce à
l'Intranet de la ville, on avertit en direct celui qui répare.
De manière générale, le service public
ne peut exister que s'il met le citoyen au centre, il en va même de
sa survie. Ça modifie évidemment l'exercice de la démocratie, ça va
dans le sens de la transparence, des débats ouverts, des
explications, de la participation aux décisions collectives, tout ce
qui permet de réinventer le politique. Et puis les réseaux informels
permettent le partage d'expérience en même temps que l'éveil des
consciences. Ces formes de dialogue entraînent le citoyen à devenir
plus responsable.
Télérama : Comment sent-on ces
évolutions ?
Alain Busson : Le fait que les
initiatives viennent de la périphérie provoque en particulier
l'éclatement de la relation au travail. Il n'y a plus de linéarité,
de carrière toute tracée. Le fonctionnement du monde du travail se
rapproche de celui qui régit depuis toujours l'économie de la
culture et qui me paraît depuis longtemps mieux convenir à
l'individu que le rythme industriel : création, autonomie,
responsabilité, objectifs, missions... Cinéastes, musiciens,
comédiens, peintres ne fonctionnent pas autrement. Simultanément, le
risque personnel est plus grand.
Télérama : Ce
risque n'incite-t-il pas justement à rester chez soi, protégé par
son écran ?
Alain Busson : Non, on n'est
pas dominé par la connexion généralisée. La multiplication des
objets de médiation, télé, walkman, ordinateur, ne crée pas une
société autiste. Correspondre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas
donne très vite envie de le rencontrer. Depuis trente ans, les
besoins de «socialité» se sont accrus, la fréquentation des
équipements culturels aussi. On n'a pas attendu Internet pour être
acteur de ses propres loisirs. On se produit soi-même, on fait du
théâtre, de la peinture, du chant...
Télérama :
C'est une manière de devenir un créateur ?
Alain
Busson : Pas forcément, mais la société en réseau remet en
question la notion d'oeuvre et d'artiste. A l'époque de la
Renaissance, l'artiste a un statut à part. Au début du XXe siècle,
Marcel Duchamp revient sur la nature de la création artistique. Pour
lui, il n'y a pas d'objet artistique en soi, il n'y a que des
intentions esthétiques, et c'est l'artiste qui les porte. Avec la
société en réseau, chacun participe à la création universelle. C'est
une autre manière de voir.
Il y a deux ou trois ans, je suis allé au
Louvre voir une expo pour laquelle on distribuait de manière
classique une plaquette rédigée par un conservateur. A la fin, il
écrivait à peu près ceci : «On vous a proposé des textes sur
l'art et les oeuvres, mais oubliez tout ça. Faites fi des discours
savants, laissez-vous aller à votre propre perception de l'oeuvre et
de l'artiste.» De la part du conservateur, c'était la négation de
son boulot. On peut y voir une analogie avec la société en réseau.
Dès que l'internaute est son propre producteur, qu'il participe à
des oeuvres artistiques, sociales ou politiques, tous les schémas
sont inversés. Paradoxalement d'ailleurs, alors que dans les réseaux
on remet en cause le statut de l'artiste, y compris sa prétention à
toucher des droits d'auteur, l'innovation artistique a de plus en
plus de valeur dans le monde industriel ! L'art et les
créateurs vont peut-être réinvestir le monde financier qu'ils ont
quitté il y a quatre cents ans.
Télérama : Comment
s'y reconnaît-on, alors ?
Alain Busson : Il
faut des défricheurs et des déchiffreurs. En priorité dans le
domaine de l'éducation. Je ne veux pas donner de leçons aux
enseignants, je sais les difficultés de leur métier, mais ça suppose
de leur part qu'ils ne soient plus des profs mais des médiateurs,
ceux qui possèdent les clefs de lecture face à la complexité du
réel. C'est sans doute plus difficile mais aussi plus valorisant et
plus que jamais indispensable. Je ne crois pas à la disparition des
enseignants, bien au contraire, je crois en l'intelligence partagée.
Il faut mettre le vivant au coeur de l'enseignement comme on doit le
mettre aussi au coeur de la ville. Il y a cent cinquante ans, à
l'avènement de la société industrielle, les deux priorités étaient
l'éducation et l'urbanisme. Ainsi sont arrivés Jules Ferry et
Georges Haussmann. A l'aube de la société en réseau, les priorités
sont les mêmes. Seulement, la structure n'est plus pyramidale,
chacun doit devenir acteur. Le risque individuel est plus grand,
mais c'est ainsi que la société deviendra
adulte. |