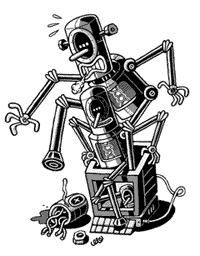



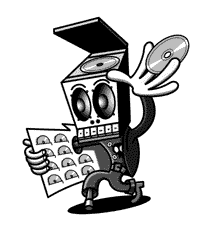


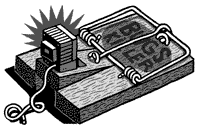
a. Jean-Paul Smets-Solanes et Benoît Faucon, Logiciels libres : Liberté, égalité, business , Edispher, 1999. [Le seul livre général — aussi bien technique que théorique — qui existe sur la question.]
b. Olivier Blondeau, « Genèse et subversion du capitalisme informationnel », La Pensée n°317, janvier-mars 1999 [disponible sur www.samizdat.net/cyberesistance et repris in (d)].
c. « Les logiciels libres : de
l’utopie au marché », numéro spécial de la revue Terminal ,
numéro 80/81, 1999.
c1. Bernard Lang, « Logiciels Libres et
Entreprises ».
c2. Nicolas Jullien, « Linux : la
convergence du monde Unix et du monde PC ? ».
c3.
Interview de Richard Stallman.
[Tous ces articles sont disponibles sur
le site http://www.terminal.sgdg.org/.]
d. Libres enfants du savoir numérique. Une anthologie du “libre” , dir. Olivier Blondeau et Florent Latrive, éditions de l’éclat, 2000. [Cette anthologie est primordiale pour qui s’intéresse à la question, même si la quasi-totalité des textes sont disponibles sur Internet, et si l’ordre suivi par les éditeurs n’est pas forcément convaincant.]
e. Tribune libre. Ténors de l’informatique libre, O’Reilly, 1999 [disponible sur http://www.oreilly.fr/].
f. Mélanie Clément-Fontaine, La licence publique générale GNU [logiciel libre] , mémoire de DEA, Faculté de droit de Montpellier, 1999 [disponible sur www.crao.net/gpl ; il s’agit d’une analyse juridique extrêmement détaillée de la GPL].
1. Le symbole de Linux est le pingouin : cet animal est devenu l’emblème du logiciel libre. [Retour au texte]
2. Parmi les langages : C, Perl, Python, HTML.[Retour au texte]
3. L’anecdote est relatée in (a) ; le texte de la lettre ainsi que la traduction par Michel Volle sont disponibles sur www.volle.com. [Retour au texte]
4. Craig Mundie, 01.net, 04.V.2001, et interview à 01.net, 03.VII.2001. [Retour au texte]
5. John Perry Barlow, « Vendre du vin sans les bouteilles », 1993, repris in (d). [Retour au texte]
6.Cf. Roberto di Cosmo, Le Hold-up planétaire, Calmann-Lévy, 1998. [Retour au texte]
7. Apple vend des ordinateurs qui tournent avec Mac-Os, Sun vend des ordinateurs qui fonctionnent avec Unix (ce qui correspond à deux systèmes d’exploitation propriétaires). [Retour au texte]
8. Olivier Blondeau, Le Monde, 31.I.2001. [Retour au texte]
9. Free Software Foundation, « Catégorie des différents logiciels libres et non libres », trad. française disponible sur www.april.org/groupes/gnufr/categories.html et reprise in (d). [Retour au texte]
10. Richard Stallman, « Le manifeste GNU », 1984, repris in (d). [Retour au texte]
11. Hurd comme Linux sont des systèmes d’exploitation « de type Unix », ce qui signifie qu’ils ont des fonctions et des façons de se comporter communes avec Unix (multi-tâches et multi-utilisateurs) tout en étant différents. [Retour au texte]
12. C’est pourquoi Richard Stallman insiste toujours pour que Linux soit dénommé GNU/Linux, en référence à son travail de pionnier, même si son Hurd n’a finalement jamais vu le jour (il est, à l’heure actuelle, encore en développement). [Retour au texte]
13. Il existe en France deux associations importantes : l’April (Association pour la promotion et la recherche en informatique libre), proche de la FSF de Stallman, et l’Aful (Association francophone pour l’utilisation de Linux et des logiciels libres), qui, à la différence de la première « ne défend pas le point de vue selon lequel tout logiciel doit être libre »(a). [Retour au texte]
14.Cf. le dossier dans Libération du 03.XI.2001, disponible sur http://www.liberation.fr/microsoft//. [Retour au texte]
15. GNU/Emacs est un éditeur de textes. [Retour au texte]
16.Logiciels et systèmes, n°59, juin 2001. [Retour au texte]
17. Conférence de presse du 26 novembre 2001 à Paris ; propos recueillis par Moïna Fauchier-Delavigne. Red Hat salarie dix des quinze plus importants développeurs de Linux. [Retour au texte]
18. Bob Young, Libération, 13.X.1999. [Retour au texte]
19. Traduction française « non-officielle » (la licence ne peut être utilisée qu’en anglais) de la GPL, disponible sur www.april.org/gnu/gpl_french.html. [Retour au texte]
20. Michael Stutz, « Appliquer le copyleft à de l’information de type non logiciel », disponible sur http://dsl.org/, et repris in (d). [Retour au texte]
21. Bernard Lang, « Internet libère les logiciels », La Recherche, n°328, février 2000. [Retour au texte]
22.Cf. (a) et Jean-Benoît Zimmermann, « Logiciel et propriété intellectuelle », in (c). Le site http://www.freepatents.org/ milite contre les brevets sur les logiciels en Europe. [Retour au texte]
23. En août 2001, L’Office européen des brevets a amendé la Convention sur le brevet européen de 1973 dans ce sens (cf. http://www.net-iris.com/). [Retour au texte]
24. Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie, 1763, rééd. Parangon, 2001. [Retour au texte]
25. Laurent Heynemann, Bulletin de la SACD , n°113, été 2001. [Retour au texte]
26. Sur la question des droits d’auteurs, voir le dossier de la revue Vacarme, n°15, printemps 2001, et notamment l’article de P. Mangeot. [Retour au texte]
27. Lire par exemple Olivier Blondeau, « Grande peur et misères de l’édition musicale à l’ère informationnelle », disponible sur www.samizdat.net/cyberesistance/ et repris in (d). [Retour au texte]
28. Voir le site : http://artlibre.org/. [Retour au texte]
29. Viviane Serfaty, « L’Internet, fragments d’un discours utopique », Communication et langages, n°119, 1999. [Retour au texte]
30.Libération, 23.VIII.1999. [Retour au texte]
31. Eric S. Raymond, « À la conquête de la noosphère » [la noosphère est le “territoire des idées”], disponible sur http://www.opensource.org/, cité in (a) et repris in (d). [Retour au texte]
32. Marcel Mauss, Essai sur le don,1923. [Retour au texte]
33. Maurice Godelier, L’Énigme du don, Fayard, 1996, cité in (d). [Retour au texte]
34. Richard Barbrook, « La liberté de l’hypermédia », 1996, repris in (d). Barbrook est le coauteur, avec Andy Cameron, de The Californian Ideology, 1995, disponible sur http://www.hrc.wmin.ac.uk/. [Retour au texte]
35. Andrew Leonard, Salon magazine, trad. Courrier International, 28.VI.2001. [Retour au texte]
36. Un “smiley” est un
petit signe typographique qui représente un visage placé à
l’horizontale.
Exemples : :-( ou :-)). [Retour au
texte]
Quelques définitions
Les logiciels (on peut dire aussi : programme, ou application) sont l’ensemble des instructions qui permettent à l’homme de communiquer avec la machine. Le mot logiciel a été créé en 1970 : « de logique, d’après matériel » dit Le Petit Robert. C’est l’équivalent du mot anglais software, qui s’oppose à hardware (le matériel, c’est-à-dire l’ensemble des composants qui forment l’ordinateur).
Au sein des logiciels, il faut distinguer entre les programmes simples (traitement de texte, tableur, navigateur Internet, jeux, etc.) et les systèmes d’exploitation. Le système d’exploitation est le “premier programme” de l’ordinateur : c’est lui qui sert d’interface entre l’utilisateur et les logiciels employés. Lorsqu’on allume un ordinateur, le système d’exploitation se lance, et c’est au sein de cet environnement que l’utilisateur fait fonctionner ses programmes, programmes qui sont conçus en fonction de ce système d’exploitation. Windows (et son ancêtre MS-DOS) est le système d’exploitation de Microsoft, fonctionnant sur les PC. Sur un Macintosh, le système d’exploitation s’appelle Mac-Os. Linux est un système d’exploitation qui peut fonctionner sur n’importe quel type d’ordinateur.
Les instructions d’un logiciel sont écrites dans un langage que l’ordinateur peut comprendre : le langage machine (ou langage binaire , ainsi appelé car il s’agit d’une suite de 0 et de 1). Ce langage est quasi-impossible à pratiquer pour un être humain. En revanche, il est possible de créer un logiciel en l’écrivant dans un langage informatique compréhensible par des humains[2], puis en le traduisant en langage binaire. Le logiciel qui permet cette transformation s’appelle un compilateur ; à l’inverse, décompiler, c’est transformer des instructions binaires en langage compréhensible. Lorsqu’il est compréhensible, le logiciel est sous forme de code source . C’est le cas des logiciels libres ; à l’inverse, lorsque vous achetez un logiciel qui n’est pas libre (un logiciel propriétaire ), il ne donne pas accès à son code source : il est donc uniquement sous forme binaire (cas des produits Microsoft). De plus, dans certains pays (notamment aux États-Unis, mais aussi au Japon pour les programmes américains), il est interdit de décompiler les programmes.
La licence d’un logiciel est un texte qui conditionne l’utilisation du programme (droit ou non de le copier, etc.). Dans le cas d’un logiciel propriétaire, il faut acheter une licence pour chaque ordinateur qui utilise le programme ; dans le cas du libre, cette licence sert juste à rappeler que le programme est libre.
En 1975, William et Paul, deux étudiants américains de l’université de Harvard, mettent au point un logiciel pour l’Altaïr 8800, un des tout premiers micro-ordinateurs. William découvre bientôt que son logiciel n’est pas acheté, mais copié et diffusé gratuitement sur le campus. Il publie une lettre ouverte dans la presse étudiante : « Est-ce honnête ? [...] ce que vous faites, c’est empêcher la production de bons logiciels. Qui peut se permettre de faire travailler des professionnels pour rien ? [...] Vous êtes tout simplement des voleurs. »[3] William, son diminutif c’est Bill : Bill Gates. Avec Paul Allen, il fonde, un an plus tard, Microsoft. Vingt-cinq ans après, les arguments n’ont pas changé. En 2001, Craig Mundie, numéro 3 de Microsoft, qui « mène une campagne contre le logiciel libre », déclare ainsi : « La protection de la propriété intellectuelle est un des moteurs fondamentaux de la croissance économique »[4]. Le logiciel libre est-il vraiment « une conception dangereuse pour tous les éditeurs de logiciels »[4] ?
§
Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?
Une des erreurs fréquentes concernant les logiciels libres vient du fait qu’en anglais, le mot free veut dire à la fois “libre” et “gratuit”. Or un logiciel libre n’est en rien nécessairement gratuit : dans n’importe quel magasin d’informatique, vous pouvez acheter un cédérom de Linux, le plus connu des logiciels libres. C’est pourquoi il faut entendre « “Free as in speech, not as in beer” : free speech signifie “liberté de parole”, et free beer, “bière gratuite”, donc “à l’œil” »[e].
Les deux caractéristiques principales du logiciel libre sont les suivantes : qu’il soit open source, et qu’il soit régi par une licence libre. Open source signifie que tout utilisateur du logiciel a accès au “code source” du programme, c’est-à-dire aux lignes de code qui font fonctionner le programme, son moteur [cf. introduction : Quelques définitions]. Ces lignes peuvent être changées selon les besoins de l’utilisateur, et non pas seulement selon le bon vouloir du fabricant. Exemple : au sein du système d’exploitation Windows de Microsoft, qui équipe plus de 90% des PC dans le monde, l’utilisateur peut modifier la barre des icônes, ou les options d’affichage, mais ne peut entrer dans le cœur du programme pour lui adjoindre telle fonction ou modifier telle autre. « Pour donner une analogie matérielle de portée forcément limitée, Microsoft se comporte un peu comme un fabricant de voitures qui, ayant acquis une position de monopole, interdirait à l’utilisateur d’ouvrir le capot de sa voiture et d’avoir accès au moteur »[b]. Non modifiables, les logiciels propriétaires (outre ceux de Microsoft, on peut citer ceux d’Adobe — Photoshop, Illustrator — ou encore ceux de Claris, de Lotus) sont également non copiables. Or, comme le rappelle un théoricien des logiciels libres, « le droit et la pratique sociale qui existent dans ce secteur sont déjà dangereusement opposés. Les lois concernant la reproduction sans autorisation des logiciels commerciaux sont claires, sévères... et rarement observées. Les lois contre le piratage des logiciels sont pratiquement inapplicables, et leur non-respect est devenu si socialement acceptable que seule une minorité de gens s’oblige, par peur ou par scrupule, à leur obéir. »[5] Mettre en conformité le droit et la pratique, faire sortir les outils informatiques du champ commercial, et les rendre plus souples pour les utilisateurs, voilà les fondements du mouvement Open Source (expression qui tend à se substituer à celle de logiciels libres, pour éviter la confusion du mot free anglais). Les trois caractéristiques concernant les logiciels libres sont donc : liberté de copie et de diffusion (j’ai le droit de copier le Linux qui est installé sur l’ordinateur de mon voisin), liberté d’utilisation (j’ai le droit de faire ce que je veux de mon Linux) et liberté de modification (j’ai le droit de modifier en partie ou totalement mon Linux).
Néanmoins, la simple opposition entre logiciel libre et Microsoft n’est pas forcément fondée. Certes, les tenants du logiciel libre dénoncent eux aussi les pratiques monopolistiques de Microsoft (deux exemples parmi d’autres : un PC est automatiquement fourni avec le système d’exploitation Windows préinstallé, même si l’acheteur ne le souhaite pas , et il est presque impossible[6] pour l’acheteur de se le faire rembourser s’il souhaite installer Linux à la place ; en créant un lien quasi-indissoluble entre Windows et Internet Explorer, le navigateur Internet de Microsoft, la société a fait en sorte que Nestscape Navigator, un navigateur concurrent, soit quasiment éradiqué des PC du grand public). Cependant, lors du procès contre la firme de Bill Gates pour position de monopole entamé à l’automne 1998 et conclu trois ans après, ce sont surtout les concurrents directs de Bill Gates (Apple, Sun, Netscape[7]) qui ont nourri l’accusation, bien plus que les gourous du logiciel libre : « Le monde du logiciel libre et en particulier Richard Stallman, son fondateur, ont toujours réfuté cette proximité, fût-elle conflictuelle, avec l’entreprise Microsoft. Pour Stallman, les logiciels libres et Microsoft sont deux choses radicalement différentes, qui ne supportent aucune comparaison. »[8] De fait, pour les purs et durs du logiciel libre (notamment Richard Stallman), les logiciels propriétaires ne devraient tout simplement pas exister : « La Fondation du logiciel libre suit une règle consistant à ne jamais utiliser un logiciel propriétaire sur ses ordinateurs, sauf à titre temporaire, et pour élaborer un remplacement de ce même logiciel. Exception faite de ce cas, il n’existe aucune excuse pour l’utilisation de ce type de logiciels. »[9]
§
La naissance du gnou
En lieu et place de Linux, c’est Hurd qui aurait dû être la star des logiciels libres. Hurd était le système d’exploitation que Richard Stallman, le père du logiciel libre, a commencé à mettre au point en 1984, au sein de son projet global GNU. Que signifie GNU ? C’est tout simplement la dénomination anglaise du gnou, « ainsi choisi parce que c’était le nom le plus bizarre que Stallman ait trouvé dans le dictionnaire »[a]. C’est surtout un acronyme qui se mord la queue : les trois lettres signifient Gnu’s not Unix (“Gnu n’est pas Unix”) — le G n’a donc pas de signification propre, puisqu’il relance le mot GNU. Unix était un système d’exploitation né en 1969, et développé par la société de télécommunications AT & T. Pour conserver son monopole dans les télécom-munications, AT & T avait, par le FCC Agreement de 1953, « renoncé à avoir une activité commerciale en informatique »[c2]. Dès lors, la société n’avait pas le droit d’empêcher les informaticiens (notamment dans les universités) d’avoir accès au code source du programme. En 1984, la Cour suprême américaine brise le monopole de AT & T (c’est la naissance des “baby bells”, les multiples petites compagnies de téléphone) : la société recouvre dans le même temps son droit de commercialiser des produits informatiques — Unix ne peut donc plus être librement copié et modifié. C’est alors que Richard Stallman (pour l’anecdote, on dit que c’est le fait de ne pas avoir accès au code source du programme pilotant sa nouvelle imprimante qui a été pour lui le déclic), décide de lancer le projet GNU en fondant la FSF (Free Software Foundation , Fondation du logiciel libre), en développant les concepts juridiques de copyleft et de licence GPL (General Public Licence), et en mettant sur pied un certain nombre de logiciels, dans un premier temps compatibles avec Unix. Stallman explique : « J’estime que la Règle d’or est que, si j’aime un programme, je dois le partager avec d’autres qui aiment ce programme. Les éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs, en interdisant à chacun de partager avec les autres. Je refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de cette manière. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, signer un accord de non-divulgation ou une licence de logiciels. »[10]
Alors même que le principe fait rapidement des émules et que de nombreux logiciels libres voient le jour, le système d’exploitation (donc la base de l’ensemble), Hurd, n’avance quant à lui que très lentement. Or, parallèlement, un étudiant finlandais, Linus Torvalds, passionné d’informatique et passablement agacé par « cette architecture minable avec ce système d’exploitation MS-DOS [l’ancêtre de Windows] minable »[a] des PC, met sur pied un système d’exploitation qu’il baptise Linux, contraction de son prénom et d’Unix[11]. Le 25 août 1991, il poste un message sur Internet annonçant la création de son système d’exploitation. Aussitôt, des centaines de développeurs du monde entier se joignent à lui, utilisant notamment les outils déjà mis au point par la Free Software Foundation[12]. En 1994 sort une première version aboutie de Linux ; en 1999, la version 2.2 est lancée.
§
Linux pour qui ?
En dix ans, Linux est devenu un outil incontournable : fiable (il est ainsi utilisé dans des secteurs sensibles, telle l’armée), puissant, conçu dans une logique Internet (au moins un tiers des prestataires d’accès à Internet sont sous Linux), et surtout... libre (avec tous les avantages que cela suppose, et notamment la gratuité des licences). Il existe une série de “clones” de logiciels propriétaires existant sous forme libre : ainsi le fameux Gimp, un programme de dessin et de manipulation d’images, similaire à Photoshop « mais en mieux »[a], mais aussi des traitements de texte, des logiciels de son, etc. Il existe aussi des logiciels propriétaires fonctionnant sous Linux : ainsi la suite bureautique (traitement de texte + tableur + base de données) StarOffice (offerte aux particuliers et dans l’enseignement) — car, paradoxalement, il est possible de concevoir des logiciels propriétaires fonctionnant sur un système d’exploitation libre. Linux est-il vraiment adapté aux particuliers, aux petites entreprises ? Les auteurs du livre Logiciels libres résument : « Fiabilitié, interopérabilité et richesse applicative font des solutions autour de Linux et des logiciels libres une alternative crédible à l’offre propriétaire dominante (Microsoft et Apple). Leur gratuité, ou leur prix peu élevé, font de ces outils une solution avantageuse pour les PME, les établissements d’enseignement, les instituts de recherche ou les collectivités locales, notamment pour l’informatique en réseau, les serveurs Intranet [ i.e. à l’intérieur d’une même entreprise] ou les postes bureautiques individuels. Mais les logiciels libres souffrent parfois de leur passé universitaire : certains outils nécessaires aux entreprises comme les progiciels de gestion ou les jeux éducatifs pour le grand public sont encore absents de cette offre. »[a]
Quittant le monde universitaire, les logiciels libres sont devenus un enjeu pour l’ensemble de la société. Comme les militants[13] du logiciel libre ne cessent de le rappeler, les services publics devraient obligatoirement fonctionner avec et proposer des ressources informatiques libres. On sait qu’en France, les textes légaux et les documents administratifs sont libres de droits — mais encore faudrait-il que les logiciels permettant de les lire le soient aussi. Or, aujourd’hui, une société ou une association « qui demande des subventions à l’Union européenne est contraint[e] en pratique d’utiliser la suite bureautique Microsoft Office, à l’exclusion de tout autre, pour communiquer avec les services administratifs traitant son dossier. »[a] D’autant qu’imposer un standard de fait qui soit propriétaire n’est pas exempt de risque, loin de là : si la société qui distribue ce logiciel fait faillite, le standard peut très bien disparaître — ce qui ne peut se produire avec un logiciel libre. Le cas de l’école est exemplaire. D’abord parce que cela permet de réduire les coûts. Au Mexique, dans le cadre d’un programme d’informatisation, 140 000 écoles primaires et collèges vont être équipés par Linux : « Un système [avec des produits Microsoft] serait revenu à environ $100 par poste pour les licences de logiciels. Avec Linux, il suffit d’acquérir un seul cédérom à $50 et de le copier en toute légalité sur tous les serveurs et sur tous les postes. »[a] Ensuite parce que cela permettrait de « garantir l’indépendance entre le programme scolaire et les stratégies marchandes des éditeurs de logiciels propriétaires »[a]. Les sociétés proposant des logiciels propriétaires font en effet de leur mieux pour conditionner, via l’école, les futurs consommateurs à l’utilisation exclusive de leurs produits ; tout comme elles font de leur mieux pour combattre les logiciels libres au sein des grandes entreprises. Il s’agit bel et bien d’un combat : « la suite bureautique Microsoft Office serait proposée à certaines multinationales françaises à moins de 8 euros par poste alors qu’une petite PME doit payer environ 600 euros. Dans ces conditions, probablement assimilables à du dumping, peu de grands groupes sont prêts à [...] participer au développement de la suite bureautique libre KOffice. Les grands groupes ayant un rôle de prescripteur, de nombreuses PME financent par leurs achats au prix fort la ristourne accordée aux grands groupes. »[a] Les enjeux économiques de l’informatique sont énormes, et les décisions politiques sont souvent dictées par des contraintes extérieures : il suffit de rappeler que l’arrêt, en novembre 2001, des poursuites de l’administration américaine engagées contre Microsoft pour pratiques anticoncurrentielles, a été motivé par les craintes de l’administration Bush d’affaiblir une entreprise performante dans un contexte économique américain morose[14].
Il faut le redire sans craindre de se répéter, les logiciels libres ne s’opposent pas, en tant que tels, au commerce. « Il y a toujours eu de la rémunération dans le monde du logiciel libre. Dès 1985 j’ai vendu des bandes de GNU/Emacs[15] pour $150. La rémunération est présente dans le développement coopératif depuis presque 15 ans »[c3], rappelle ainsi Richard Stallman en réponse aux questions qui se posent fréquemment concernant le développement de l’activité commerciale autour de Linux, qui ne cesse d’augmenter depuis quelques années. Si Stallman n’a vendu des programmes libres que dans le cadre non-lucratif de sa Fondation du logiciel libre, d’autres ont en revanche pour premier objectif les bénéfices. Prenons le cas de Red Hat, une société qui commercialise Linux — donc dont l’objet premier est de vendre un logiciel que vous pouvez tout aussi bien copier chez votre voisin en toute légalité. L’équation paraît absurde, et on a tendance à vouloir croire Craig Mundie de Microsoft, qui a, au printemps 2001, « décortiqué le système Open Source et l’a jugé peu viable économiquement en le mettant en rapport avec les échecs de certaines jeunes pousses [start-up] qui offraient gratuitement l’accès à leur contenu en vendant d’autres services »[16]. Or ce sont bien à ces propos que semble répondre Bob Young, le PDG de Red Hat lorsqu’il affirme fièrement que sa société a « 300 millions de dollars en banque, un public listing au Nasdaq, et 100 millions de dollars de chiffre d’affaires », lors d’une conférence de presse faite en France, à l’intitulé on ne peut moins “hacker” (« L’historique de l’Open Source / Les vrais enjeux économiques de cette controverse pour les entreprises / Les avantages chiffrés des infrastructures Open Source / Quelles sont les principales motivations des entreprises qui choisissent Linux ? / Pourquoi les grands du monde informatique (IBM, Compaq, DELL....) se rallient à Linux ? »)[17]. À la différence de Stallman, Bob Young s’oppose à l’idée que le logiciel libre n’a rien à voir avec le logiciel propriétaire, en assumant le fait que Microsoft est bien un concurrent pour Red Hat : « Je m’inquiète toujours de Microsoft. C’est une des sociétés les mieux dirigées, avec qui j’ai la malchance d’être en concurrence. Ils sont très brillants et très agressifs. » Mais Bob Young est aussi un businessman pas vraiment comme les autres, qui s’oppose à la brevetabilité des logiciels (cf. infra) en rappelant que c’est grâce à l’Open Source que l’innovation (pour Internet autant que pour Linux) a pu se manifester depuis une dizaine d’années.
§
Cathédrale vs bazar
Quel est l’intérêt des logiciels libres sur le strict plan de l’informatique ? En quoi un logiciel libre est-il plus fiable qu’un logiciel propriétaire ? Eric S. Raymond a proposé une théorie, reprise partout, pour démontrer cette supériorité : il oppose le « style cathédrale » à l’œuvre dans la conception des logiciels propriétaires et le « style bazar » , pour les logiciels libres. Comme l’explique Olivier Blondeau dans son analyse du texte de Raymond : « Le “style cathédrale” s’inscrit dans la logique traditionnelle de la division technique du travail, de sa planification et de son organisation rationnelle, qui privilégie l’approche centralisée et hiérarchisée. Dans cette conception, les logiciels doivent “être conçus comme des cathédrales, soigneusement élaborées par des sorciers isolés ou des petits groupes de mages travaillant à l’écart du monde”. La production est ici sérielle : l’ingénieur élabore, le développeur développe et le consommateur consomme. »[b] Lors de la fabrication d’un programme, trois versions se succèdent : la version alpha, le prototype, dont les informaticiens vont supprimer le maximum de problèmes (on dit : déboguer, un bogue — bug en anglais — étant une erreur du programme qui le fait “planter”, i.e. se bloquer) ; la version béta , qui est proposée à l’essai à diverses personnes proches de l’entreprise afin qu’ils signalent les problèmes éventuels ; enfin la version gold , théoriquement stable et qui sera commercialisée. L’ensemble de ces étapes prend du temps, et coûte cher aux entreprises — c’est pourquoi elles n’hésitent pas à en supprimer une : Olivier Blondeau explique ainsi le succès de Microsoft par le fait qu’elle se « contente de commercialiser la plupart du temps des versions béta, économisant ainsi le long et fastidieux travail de débogage de ses logiciels »[b]. À l’opposé, le style bazar “parallélise” le cycle de production, en fonction de la loi édictée par Eric S. Raymond sous le nom de “Loi de Linus” : « Étant donné un ensemble [...] de co-développeurs suffisam-ment grand, chaque problème sera rapidement isolé, et sa solution semblera évidente à quelqu’un » . Linux et ses épigones sont en libre circulation : il y a beaucoup plus d’utilisateurs de logiciels libres dans le monde que d’ingénieurs chez Microsoft. D’autant que le développement d’Internet a permis à tous ces utilisateurs d’être en contact les uns avec les autres. Il y aura donc plus de possibilités pour ces utilisateurs de repérer des défauts, et, surtout, de proposer des solutions, qui seront intégrées à la prochaine version.
Deux problèmes néanmoins se posent. D’une part, la cohérence d’un logiciel qui pourrait éclater en mille versions différentes (puisque chacun est libre d’en faire ce qu’il en veut). Bob Young, le patron de Red Hat, explique : « Jusqu’en 1994, j’étais persuadé que Linux allait exploser. Comme tout le monde disposait des secrets de fabrication, je pensais que les programmeurs partiraient dans des directions différentes, et que plusieurs versions totalement incompatibles entre elles apparaîtraient, signant l’arrêt de mort de Linux. Mais on s’aperçoit que c’est l’inverse qui se produit : quand il y a plusieurs projets concurrents, ils finissent par se regrouper. En fait, quand un projet est meilleur, les programmeurs préfèrent le rejoindre, et y ajouter leurs propres idées, plutôt que de travailler dans leur coin et d’écrire de nouveau des choses qui existent déjà. J’appelle ça “la théorie du programmeur fainéant”. »[18] Dans le monde du logiciel libre, même si la notion de communauté est primordiale, il existe une “hiérarchie” qui décide d’intégrer ou non les changements apportés dans la prochaine version mise en circulation. Pour Linux, c’est Linus Torvalds qui continue à tenir ce rôle (même si, depuis 1996, il s’est légèrement mis en retrait du développement du programme lui-même). Pour Apache, un logiciel qui permet de faire fonctionner les sites Internet (et qui est installé sur plus de la moitié des serveurs), c’est un collège de plusieurs membres (l’Apache Group) qui vote sur des améliorations qui peuvent être proposées par tous. L’avantage est que cette hiérarchie peut être modifiée sans grand dommage : même sans Linus, Linux ne s’éteindrait pas.
L’autre problème posé par le développement coopératif est celui de la divergence de plus en plus marquée entre deux façons d’être par rapport aux logiciels libres : au fur et à mesure que ceux-ci ont conquis le grand public, ils ont cessé d’être des outils réservés aux seuls informaticiens (l’un des problèmes de Linux a longtemps été d’être très difficile à installer pour un non-initié). Y a-t-il un risque de voir sans cesse croître le nombre des simples utilisateurs, qui s’opposent aux utilisateurs-développeurs des premiers temps ? Richard Stallman répond : « il n’y a qu’une communauté, qui contient deux genres d’utilisateurs. Les besoins sont différents mais nous faisons déjà des grands efforts pour les besoins des utilisateurs ordinaires non-hackers. La communauté peut continuer unie. »[c3]
§
Le copyleft
« Pour protéger vos droits, nous devons apporter des restrictions, qui vont interdire à quiconque de vous dénier ces droits, ou de vous demander de vous en désister »[19], explique le préambule de la GPL (General Public Licence), la licence mise au point par Stallman au sein de la Free Software Foundation . Il s’agit de détourner la protection habituelle du copyright pour créer un “copyleft” : jeu de mot subtil qui repose sur l’idée que l’auteur laisse (left) faire des copies ( left signifiant aussi “gauche”, l’opposition peut également s’entendre politiquement). Un logiciel sous licence GPL a un auteur dûment mentionné, mais celui-ci énonce sous le copyright que « ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier conformément aux dispositions de la Licence Publique Générale GNU »[19]. Le problème de la FSF était tout bête : protéger un logiciel dont la vocation est d’être libre — donc protéger la liberté. Car, sans cette protection, rien n’aurait empêché une entreprise de récupérer un logiciel libre, de faire quelques modifications, puis de le commercialiser sous forme propriétaire, brisant le cercle de la communauté du libre. Comme l’explique un tenant du logiciel libre, « la simple publication dans le “domaine public” [i.e. renoncer à tous les droits] ne marchera pas, parce que certains essayeront d’abuser de la situation à leur profit en privant les autres de la liberté. Tant que nous vivons dans un monde avec un système légal où les abstractions légales telles que le copyright sont nécessaires, en tant qu’artistes ou scientifiques responsables nous aurons besoin des abstractions légales, en bonne et due forme, du copyleft qui assurent nos libertés et les libertés des autres. »[20] Il ne faut donc pas se méprendre sur le sens du copyright de la FSF : il s’agit d’un pis-aller (ou comment se défendre avec les armes de l’ennemi), et certainement pas d’une défense de la notion de droit d’auteur en ce qui concerne les logiciels.
Car le credo des tenants du logiciel libre est que le copyright (l’auteur conserve ses droits et les concède aux usagers) et a fortiori le brevet (qui offre une protection encore plus forte : les inventeurs d’un procédé en conservent le contrôle pendant 20 ans), n’ont pas de sens pour un programme informatique — qui est comparé à un théorème mathématique (« la plupart des brevets [aux États-Unis et au Japon] sur le logiciel résultent plus d’une découverte d’une propriété mathématique, d’un algorithme ou d’une méthode d’organisation que de la mise au point d’un procédé industriel original et complexe »[a]). Or, comme le note Bernard Lang, « on imagine la frustration des mathématiciens si on leur disait tout à coup que les théorèmes sont une propriété privée, qu’il faut payer pour avoir le droit de les utiliser et que, en outre, les preuves étant secrètes, ils doivent donc faire confiance à la société qui les vend, tout en spécifiant qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs éventuelles. La confiance que l’on peut accorder à une théorie mathématique est le résultat d’un processus social fondé sur la libre circulation de l’information dans la communauté scientifique : elle se développe par la coopération, la critique, la concurrence, les ajouts et transformations, en étant à chaque étape soumise à l’appréciation et au contrôle des pairs. La preuve mathématique est en théorie un objet rigoureux, mais en pratique si complexe que seul ce processus en garantit la crédibilité. Il en va d’ailleurs de même pour bien d’autres disciplines scientifiques, et c’est aussi comme cela que se développent efficacement les programmes informatiques. »[21] La question des brevets dans l’industrie informatique est relativement complexe[22], notamment parce que ceux-ci sont autorisés aux États-Unis et au Japon mais, pour l’instant, interdits en Europe. Or les brevets permettent à des grandes firmes de verrouiller un certain nombre de fonctions utiles en informatique, ce qui empêche la fabrication de logiciels libres clones. Ainsi, aux États-Unis, « la fonction mathématique “ou exclusif” a par exemple été brevetée pour son application au procédé d’inversion des couleurs sur un écran comme celui qui est utilisé pour faire clignoter un curseur sur un écran. Or il s’agit d’un procédé connu et tellement élémentaire que personne n’avait osé déposer un brevet auparavant. [...] De nombreuses sociétés ont alors été attaquées pour contrefaçon parce qu’elles utilisaient la fonction “ou exclusif” dans des applications graphiques sans savoir qu’un brevet existait et ont dû accepter de verser des royalties au détenteur du brevet. »[a] Or l’Europe semble s’acheminer vers une brevetabilité des logiciels[23] (et sous l’intense lobbying des grandes entreprises de logiciels propriétaires, notamment américaines, qui pourraient alors déposer un maximum de brevets et bloquer ainsi l’innovation).
Le copyright n’est pas seulement remis en question dans le cas des programmes informatiques. Richard Stallman, dans un article intitulé « Copyright : le public doit avoir le dernier mot »[d], écrit : « le système du copyright s’est développé en même temps que l’imprimerie. Au temps de l’imprimerie, il était pratiquement impossible à un lecteur ordinaire de reproduire un livre. Une telle reproduction nécessitait que l’on disposât d’une presse à imprimer, et en général les lecteurs n’en avaient pas sous la main. En outre, il était absurdement coûteux de reproduire un livre de cette façon, à moins de le tirer à un grand nombre d’exemplaires — c’est pourquoi, de fait, seul un éditeur pouvait reproduire un livre sans se ruiner. Ainsi, en cédant aux éditeurs la liberté de reproduire les livres, le public leur a vendu une faculté qu’en réalité il ne pouvait pas mettre en pratique. » Diderot, qui, au temps où le public ne pouvait en effet pas mettre en pratique la faculté d’impression, écrivit sa Lettre sur le commerce de la librairie [le mot librairie à l’époque recouvre à la fois le domaine de la vente et celui de l’édition de livres], n’avait pas de mots assez durs pour ceux qui procédaient à des “contrefaçons” (i.e. qui ne respectaient pas le monopole de l’impression) : « Sévissez contre des intrus qui se mêlent de leur commerce [celui des libraires] et qui leur enlèvent leurs avantages sans partager leurs charges ; que ces intrus n’obtiennent point vos privilèges ; que les maisons royales ne leur servent plus d’asile ; qu’ils ne puissent introduire ni dans la capitale ni dans les provinces des éditions contrefaites ; remédiez sérieusement à ces abus »[24]. Près de deux cent cinquante ans après, il y a toujours des « intrus » : « L’avenir serait la gratuité, l’œuvre amortie pouvant librement, au nom d’une idéologie libertaire sympathique, être utilisée sans contrôle et sans rémunération à travers la planète. Certains fantasment même des auteurs délivrant gratuitement leurs créations... Payés par l’État ou forfaitisés par les groupes multinationaux, les auteurs seraient soumis à la subvention ou au contrôle... L’auteur qui ne peut plus jouer sa vie, sa carrière, dans une relation violente avec le public, qui n’espère plus lorsqu’il conçoit, écrit ou peint, le retour concret et matériel de son spectateur ou de son lecteur deviendra vite assujetti à la gratuité. »[25] Le plaidoyer pourrait convaincre s’il ne venait pas du responsable de la SACD, une “société d’auteurs” chargée de distribuer leurs droits et dont la gestion opaque a été maintes fois critiquée[26].
Le numérique ayant révolutionné la reproduction (la plupart des formes de création, et notamment l’écrit, le son, et l’image animée, peuvent dorénavant être reproduits numé-riquement, c’est-à-dire sous une forme duplicable à l’infini), la question du droit d’auteur est posée, par les tenants du libre, pour la musique (avec le format MP3 qui permet de facilement faire circuler des chansons par Internet)[27] ou pour les écrits. Et le copyleft est aussi un mouvement artistique qui prône la libre utilisation et distribution des œuvres[28]. L’ensemble de ces théories et pratiques s’enracinent dans l’idée suivante, développée par un théoricien avec la métaphore du vin et de la bouteille : jusqu’à présent, c’étaient les bouteilles (le contenant) et non le vin (le contenu) qu’on protégeait. « Or avec l’arrivée de la numérisation, il est désormais possible de remplacer tous les supports d’information antérieurs par une méta-bouteille, faite d’agencements complexes — et on ne peut plus liquides — de 1 et de 0. [...] Les improvisations de jazz, les one-man-shows, les représentations de mime, les monologues, les émissions non enregistrées, toutes ces manifestations sont dépourvues de la fixation sous forme “écrite” requise par la loi. N’étant pas fixées par la publication, les œuvres liquides de l’avenir ressembleront toutes à ces formes qui s’adaptent et se modifient continuellement, et seront donc étrangères au droit de reproduction. »[5]
§
Une société du don ?
Le modèle du logiciel libre fait glisser les habituelles frontières politiques plus encore peut-être que dans les domaines juridiques et économiques. Florent Latrive, dans l’introduction à son anthologie du “libre”, évoque les différents auteurs qui s’y côtoient : « Tous parlent de politique, dessinant une coalition improbable : néolibéraux, libertariens, tiers-mondistes ou encore protomarxistes. Richard Barbrook évoque même l’anarcho-comunisme »d. Dans cette coalition, l’utopie joue un rôle prépondérant : dans un article intitulé « L’Internet, fragments d’un discours utopique », Viviane Serfaty compare Internet aux discours utopiques, et notamment à celui de Thomas More. Internet est indissociable, on l’a vu, du mouvement des logiciels libres (parce que nombre des protocoles informatiques régissant le réseau sont libres, et parce qu’Internet a permis l’immense travail collectif du développement de Linux et consorts). La position des tenants des logiciels libres concernant une communication toujours ouverte est fondée sur la transparence, « notion-clé dans l’utopie, où tout doit être parfaitement intelligible, et où chaque élément — structure politique, organisation sociale, architecture, vêtements, alimentation — doit refléter le projet fondateur global. [...] De même que l’architecture de la cité utopique joue un rôle central dans la rupture avec le passé et l’instauration d’une société nouvelle, l’Internet est censé subvertir les configurations du pouvoir et les stratégies de domination traditionnelles. Dans cette optique, le fonctionnement décentralisé du réseau, dépourvu d’ordinateur-maître, ainsi que l’auto-régulation des forums de discussion, posée comme principe dès la création d’Usenet, indiquent la recherche de rapports humains fondés sur l’égalité plutôt que sur la domination de quelques-uns et créent tout un imaginaire de société égalitaire, décentralisée, non coercitive. »[29] On retrouve là l’exact fonctionnement du développement d’un logiciel libre.
Au-delà des motivations basiques (développer un programme pour répondre à un besoin personnel spécifique), pourquoi des informaticiens participent-ils bénévolement au développement des logiciels libres ? « Le facteur déterminant dans l’accélération des développements est sans doute ce que [Eric S.] Raymond appelle “Ego gratification” (la gratification de l’ego). “Pourquoi les peintres amateurs peignent-ils ? Parce qu’ils cherchent la reconnaissance de leurs pairs. Pour les développeurs de logiciels libres, c’est pareil”, résume John Hall, président de Linux International. »a Scott Ananian, un étudiant au MIT, programmeur pour Linux, surenchérit : « L’argent n’est pas ce pour quoi nous écrivons du code toute la journée. Je ne peux pas plus expliquer ce qui nous fait produire du code qu’un poète ne peut dire pourquoi il écrit. »[30] Eric S. Raymond a tenté de théoriser les rapports existant entre les linuxiens : « Il est très clair que la société des développeurs Open Source est en fait une société du don. À l’intérieur de celle-ci, il n’existe pas de pénurie de produits de première nécessité — espace disque, bande passante, puissance informatique. Le logiciel est librement partagé. Cette abondance crée une situation où la seule mesure valable de réussite face aux autres est la réputation qu’on se fait auprès de ses pairs. »[31] La référence au potlatch (l’économie du don[32]) qu’on trouve chez de nombreux théoriciens du libre n’est néanmoins pas innocente. Olivier Blondeau affirme qu’il s’agit d’un « contresens théorique », citant à raison Maurice Godelier : « Dans le potlatch , on donne pour “écraser” l’autre par son don. Pour cela, on lui donne plus qu’il ne pourra rendre ou on lui donne beaucoup plus qu’il n’a donné. [...] Le don- potlatch endette et oblige celui qui le reçoit, mais le but visé est explicitement de rendre difficile, sinon impossible, le retour d’un don équivalent : il est de mettre l’autre en dette de façon quasi permanente, de lui faire perdre publiquement la face, et d’affirmer ainsi le plus longtemps possible sa supériorité. »[33] Mais il se pourrait que ce ne soit justement pas un contresens, et que ce soit volontaire. « L’idéologie californienne, très présente dans la Silicon Valley, préconise un désengagement maximal de l’État au profit de l’initiative privée et de l’autorégulation des citoyens. Elle reprend les idées du petit Parti Libertarien, mélange d’anarchisme de droite pour le social et d’ultra-libéralisme pour l’économie. »[a] Or Eric S. Raymond est membre du Parti Libertarien, entre autres défenseur de la vente libre des armes à feud. Un des auteurs qui a défini la notion d’“idéologie californienne” explique : « La faillite idéologique des libertariens de la Côte Ouest est due à leur croyance, dépourvue de tout fondement historique, selon laquelle le cyberespace serait issu d’une “fusion de la gauche et de la droite, de la liberté et du marché” (Louis Rossetto, rédacteur en chef de Wired). [...] Le néolibéralisme a été accueilli par la “classe virtuelle” de la Côte Ouest comme un moyen de réconcilier l’anarchisme de la Nouvelle Gauche et le zèle entrepreneurial de la Nouvelle Droite. Et surtout, ce monstrueux hybride s’est renforcé en projetant les vieux mythes de la Révolution américaine sur le processus de la convergence numérique. »[34] Chez Raymond, le capitalisme est loin d’être nié : « Le verdict de l’histoire semble être que le capitalisme et le libre marché est une façon globalement optimale de coopérer pour engendrer une économie efficace. Peut-être que, d’une manière similaire, le jeu des réputations de la culture du don est la façon globalement optimale de coopérer pour créer (et contrôler !) un travail créatif de qualité. »[31] La société du don se fonde sur la compétition entre les individus : « c’est l’effet dominant du désir de compétition que de produire un comportement de coopération »[31]. Après cette phrase, les traducteurs rajoutent une note : « Cela n’engage que l’auteur »[d] — manière de montrer la gêne que peut provoquer ces propos chez des militants français en faveur du logiciel libre, souvent de gauche.
Même si l’on admet la compétition à l’œuvre dans le développement des logiciels libres, il faut noter que celui-ci a lieu en parallèle des circuits économiques traditionnels. Il nie ainsi la notion de valeur-travail, à l’image du manifeste de Richard Stallman lors du lancement du projet GNU, en 1984 : « À terme, rendre les programmes libres est un pas vers le monde d’après pénurie, quand personne ne devra travailler très dur juste pour survivre. Les gens seront libres de se consacrer à des activités ludiques telles que la programmation. [...] Nous avons déjà beaucoup réduit la quantité de travail que la société entière doit fournir pour sa productivité, mais seulement une petite part se traduit en temps de loisir pour les travailleurs, car beaucoup d’activités non productives sont nécessaires pour accompagner l’activité productrice. Les raisons principales sont la bureaucratie et la lutte isométrique contre la concurrence. »[10] En attendant, les développeurs des logiciels libres ont dû composer avec le travail traditionnel dans les entreprises — et Linux pourrait subir, par le jeu d’un coup de billard à plusieurs bandes, le contrecoup du ralentissement de la net-économie. Car les tenants du logiciel libre ont bénéficié de l’explosion économique de tout ce qui touchait à l’informatique en général et à Internet en particulier à la fin des années 1990 : « Durant cette période permissive, ils pouvaient sans problème installer leur système d’exploitation Linux sur le réseau de la société et travailler dessus selon leur bon vouloir. Mais aujourd’hui [...] les programmeurs victimes de l’écroulement de la nouvelle économie vont probablement devoir accepter des postes dans des institutions plus sages, comme les banques, où les systèmes Linux sont perçus comme risqués sur le plan de la sécurité, et où passer la moitié de la journée à discuter en ligne sur la liste de diffusion de Linux n’est pas considéré comme une utilisation rentable de leur temps. »[35] La rencontre entre le monde un peu “décalé” de l’informatique libre et le monde réel des entreprises peut être difficile. En 1999, une affaire assez problématique a ainsi secoué le monde des linuxiens. Red Hat, la principale société commercialisant des solutions Linux, est entrée en bourse. 13% des actions avaient été réservées aux 3500 programmeurs bénévoles qui ont participé au développement de Linux : « Le résultat fut catastrophique : nombre de programmeurs ont vu leur inscription au site de courtage boursier E-Trade (indispensable pour bénéficier de l’offre) rejetée parce qu’ils ne présentaient pas de garanties financières suffisantes. [...] Pour profiter de l’offre, il faut ouvrir un compte chez E-Trade et déposer au minimum 1000 dollars. [...] Les questionnaires d’admission visent à écarter ceux qui risquent la faillite personnelle par leur faible connaissance des mécanismes boursiers ou leur manque de fonds. »[30] Le mélange entre le capitalisme le plus traditionnel et les habitudes des développeurs bénévoles ne s’est pas fait en douceur, loin s’en faut.
Cela n’empêche pas Olivier Blondeau, un sociologue très nettement marqué à gauche, de déclarer : « Ne nous y trompons pas : par sa critique des monopoles fondés exclusivement sur des critères de rentabilité financière, le mouvement du logiciel libre interroge aujourd’hui les fondements mêmes du système capitaliste. [...] En décentrant la problématique de la valeur, la fondant ainsi sur la liberté de circulation et le partage communautaire du savoir et de la connaissance, il contribue à déstabiliser ces fameuses lois naturelles de l’économie et réactive peut-être cette vieille utopie de la libre association des producteurs. »[8] Dans son article paru dans la revue marxiste La Pensée , intitulé « Genèse et subversion du capitalisme informationnel »[b], il tente de mettre à jour la théorie de Marx sur la productivité (« Est productif pour Marx, tout acte de production créateur de plus-value, c’est-à-dire qui a “pour résultat des marchandises, des valeurs d’usages qui possèdent une forme autonome, distincte des producteurs et des consommateurs” »[b]), en faisant entrer dans son cadre le travail immatériel : « si un signe n’est pas matériel, il n’en devient pas moins une marchandise dès lors qu’il peut s’objectiver, circuler, s’échanger, et être vendu ». On assiste au développement d’une « économie de l’immatériel » : « ce processus de “dématérialisation” des moyens de production tend à bouleverser la logique traditionnelle du rapport salarial : de force de travail abstraite et interchangeable qu’il était, le salarié [ainsi un informaticien qui développe des progammes pour une entreprise] devient codétenteur, sinon copropriétaire de ces outils ». Or « ce brouillage du rapport capital/travail sur ces deux aspects de la question de la propriété incite le capital à opérer un rééquilibrage [...]. Le renforcement, sinon le verrouillage, de la propriété intellectuelle sur la marchandise est une des principales composantes de la stratégie du capital. » Après une analyse des logiciels libres, Olivier Blondeau conclut naturellement : « Linux et les logiciels libres portent en effet aujourd’hui la contestation au cœur des rapports de production capitalistes. Ils démontrent dans une pratique concrète que les logiques propres au mode de production du capitalisme informationnel sont profondément inefficaces et donc improductives. »[b] Ailleurs, il écrivait : « dans le monde du Libre, l’argent n’est pas un gros mot — et ce n’est pas là le moindre signe de sa maturité dans une société qui reste, pour quelques temps encore ;-) empreinte des valeurs du capitalisme. »[d] Le “smiley”[36] ;-) indique un clin d’œil : utilisateurs de PC, encore un petit effort.
§
Que représentent les logiciels libres pour notre société ? Pour des utilisateurs lambda qui ont pris l’habitude de copier illégalement les programmes informatiques (ce que nous sommes tous peu ou prou), la licence libre semble parfois n’être pas grand-chose. Mais l’on oublie ce simple fait : en théorie, il faut payer des droits pour avoir le loisir de taper son courrier sur son ordinateur. Les logiciels libres ont donc cette vertu première : remettre les programmes informatiques à leur vraie place, celle de simples outils, qui appartiennent à tout le monde (peut-on breveter des tournures de langage ?). Et aux zélotes de Microsoft qui parlent un peu vite de propriété intellectuelle, il convient de rappeler que Bill Gates n’a jamais rien inventé, se contentant d’acheter les idées les autres avant de les revendre aux consommateurs au prix fort.
Les logiciels libres sont aussi la réalisation concrète d’une utopie, où la propriété et l’individualisme sont abolis. C’est pourquoi ceux qui font de Richard Stallman un marxien convaincant n’ont probablement pas tort, et, aujourd’hui, l’on ne voit guère d’autre issue au monde capitaliste que la voie suivie par les milliers d’informaticiens pratiquant les logiciels libres. Un petit pas pour leur ordinateur, un grand pas pour l’humanité.
R.M.
Comme le rappelle Bernard Lang dans « Le nouveau protectionnisme est intellectuel »[d], « la loi protège automatiquement et implicitement toutes les œuvres de l’esprit par le droit d’auteur. La mise à disposition d’une œuvre, notamment sur l’Internet, doit donc être un acte volontaire et explicite. » Pour cette mise à disposition, il a mis au point une licence, la Licence de Libre Diffusion des Documents : c’est dans le cadre de cette licence que cet article sera donc librement reproductible.
Cet
article (ci-après : “le document”) peut être librement lu, stocké,
reproduit, diffusé, traduit et cité par tous moyens et sur tous supports
aux conditions suivantes :
- Tout lecteur ou utilisateur de ce
document reconnaît avoir pris connaissance de ce qu’aucune garantie n’est
donnée quant à son contenu, à tout point de vue, notamment véracité,
précision et adéquation pour toute utilisation ;
- Il n’est
procédé à aucune modification autre que cosmétique, changement de format
de représentation, traduction, correction d’une erreur de syntaxe
évidente, ou en accord avec les clauses ci-dessous ;
- Des
commentaires ou additions peuvent êtres insérés à condition d’apparaître
clairement comme tels ; les traductions ou fragments doivent faire
clairement référence à une copie originale complète, si possible à une
copie facilement accessible.
- Les traductions et les commentaires ou
ajouts insérés doivent être datés et leur(s) auteur(s) doi(ven)t être
identifiable(s) (éventuellement au travers d’un alias) ;
- Cette
licence est préservée et s’applique à l’ensemble du document et des
modifications et ajouts éventuels (sauf en cas de citation courte), quel
qu’en soit le format de représentation ;
- Quel que soit le mode de
stockage, reproduction ou diffusion, toute personne ayant accès à une
version numérisée de ce document doit pouvoir en faire une copie numérisée
dans un format directement utilisable et si possible éditable, suivant les
standards publics, et publiquement documentés, en usage.
- La
transmission de ce document à un tiers se fait avec transmission de cette
licence, sans modification, et en particulier sans addition de clause ou
contrainte nouvelle, explicite ou implicite, liée ou non à cette
transmission. En particulier, en cas d’inclusion dans une base de données
ou une collection, le propriétaire ou l’exploitant de la base ou de la
collection s’interdit tout droit de regard lié à ce stockage et concernant
l’utilisation qui pourrait être faite du document après extraction de la
base ou de la collection, seul ou en relation avec d’autres documents.
Toute incompatibilité des clauses ci-dessus avec des dispositions ou contraintes légales, contractuelles ou judiciaires implique une limitation correspondante du droit de lecture, utilisation ou redistribution verbatim ou modifiée du document.
© Raphaël Meltz, 2002 : la diffusion de cet article est protégée par la licence LLDL-v1, Licence de Libre Diffusion des Documents, reproduite à la fin du document et disponible sur : http://pauillac.inria.fr/~lang/licence/v1/lldd.html.