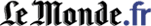 |
lundi 23 décembre 2002 |
| Horizons | |
|
||||||||
| Rechercher un article |
|
• LE MONDE |
23.12.02 | 12h20
Esclaves chez nous
Fondé en 1994, le
Comité contre l'esclavage moderne est menacé de disparition. Pourtant, les
esclaves existent toujours bel et bien en France.
La voilà. Là, derrière le
comptoir du magasin. "Zut, la patronne est avec elle. C'est mauvais
signe, elle n'est jamais là à cette heure-ci. J'ai peur qu'elle se méfie
de quelque chose." On va se cacher dans le restaurant d'à côté. Il y a
une table très pratique, un poste d'observation impeccable pour ne rien
rater des allées et venues dans le magasin. Attablée devant ses sushis,
les yeux rivés à l'autre côté de la vitre, Céline Manceau, 33 ans,
responsable juridique au Comité contre l'esclavage moderne, mène son
enquête. On guette le moment où "l'employée" sera seule.
La voisine est dans le coup. Elle vient nous prévenir que la patronne est partie. L'employée est derrière le comptoir. Elle a une drôle de figure, de l'eczéma autour des lèvres, une sorte de pelade dans la chevelure, des croûtes sur les lobes des oreilles, un gros hématome au milieu du front. On lui demande si ça va, elle dit oui, ça va. On parle gâteaux, chiens et chats, météo. Et puis, sans transition : "Vous recevez des coups ?" Là, elle vous regarde fixement, sans rien dire, une bonne minute de silence, les yeux droit sur vous. "Elle veut pas que je parle", finit-elle par répondre. Elle dit ensuite, l'air de réciter par cœur, qu'elle s'est cogné toute seule la tête contre la porte du four. Que les lobes des oreilles et les cheveux arrachés, "non, ça, c'est pas ça". Quoi, "ça" ? De nouveau, les yeux fixes. "Je peux pas parler, poursuit-elle, sinon elle va m'en flanquer une comme hier." Handicapée mentale légère, elle raconte le reste tout à trac. Qu'elle est française, la cinquantaine, insultée et sacrément cognée presque tous les jours (la porte du four semble trouver un usage répété), qu'elle travaille de 6 ou 7 heures du matin à 22 heures, week-ends et jours fériés compris, corvéable à merci sans la moindre rétribution –"Tu parles que je suis payée, tiens." Les gens qui voudraient l'aider, les policiers qui viendraient l'interroger, elle se méfie. Confiance en personne. La patronne lui a pris son sac avec ses papiers. Où elle irait, d'abord, sans ses papiers ? Pas la peine. De toute façon la patronne la retrouverait pour lui en flanquer une, "vous la connaissez pas, comme elle est mauvaise". Ça se passe en France, dans une très grande ville. Chez nous. Au grand jour. Vous n'y croyez pas ? En 1994, quand elles ont fondé le Comité contre l'esclavage moderne, dans une soupente et sans moyens, les journalistes Dominique Torrès et Sylvie O'dy n'y croyaient pas non plus. Du moins pas à ce point-là. Soupçonnant "un ou deux cas par an chez des diplomates, point barre". Elles n'en demandèrent pas plus pour s'indigner et brandir cette notion non juridique, "l'esclavage moderne". Cela fit bien rigoler. Mesdames, l'esclavage est aboli en France depuis belle lurette. Et de pouffer en aparté : vous avez vu ces deux hystériques qui veulent de l'argent pour combattre les esclavagistes dans notre République ? Les policiers non plus ne soupçonnaient rien du fléau. Ni les services d'urgence des hôpitaux, ni le Samu social, ni les commerçants ou les voisins. Ils leur ont avoué depuis : "On voyait arriver des filles avec le visage en sang qui ne parlaient pas français, on les renvoyait chez leurs patrons sans comprendre." Maintenant, ils comprennent. De plus en plus, ils savent, appellent le comité, signalent. Les esclaves surgissent de toutes parts. Des centaines ou des milliers, on n'imagine pas. Pour cette seule année et pour la seule région parisienne, de janvier à octobre, deux cent cinquante cas ont été signalés au comité sur lesquels, après enquête des juristes de l'association, deux par mois en moyenne sont pris en charge (soit parce que les autres cas sont réorientés – traite sexuelle, violence domestique, exploitation, et non pas esclavage ; soit parce que les victimes refusent d'engager des poursuites contre les employeurs). "On a fait des tas d'erreurs au début, raconte Céline Manceau, on ne savait pas s'y prendre. Maintenant, on enquête sur chaque signalement et les dossiers qu'on envoie au parquet sont en béton. On ne peut pas se permettre d'être ridicule." A force d'entêtement, le comité a conquis sa crédibilité. En huit ans, il a pris en charge près de trois cents dossiers et obtenu une trentaine de procès, dont tous ont abouti à une condamnation des employeurs. Ils sont cinq salariés et demi – une directrice à mi-temps (Zina Rouabah, que l'on connut à la tête de Libération puis de l'agence Vu), trois juristes, une assistante sociale, un secrétaire général et cent soixante avocats bénévoles – à se battre comme des lions avec les questions judiciaires, sociales, administratives : pour recueillir les signalements, enquêter, rédiger les conclusions destinées au parquet, rester en relation avec les policiers, affronter les employeurs (dangereux), suivre psychologiquement et matériellement les victimes (les mettre à l'abri des représailles, les soigner, les aider, les nourrir, les habiller, les orienter vers des formations professionnelles, protéger éventuellement la famille restée au pays). Sans compter les pressions continues pour informer, sensibiliser, modifier les lois. Un boulot de titan, une mission humanitaire que rien ni personne en France, pas une association, n'assume en dehors d'eux. "Sur l'utilité du comité, on battrait le référendum de Saddam", résume Dominique Torrès. Mais voilà : le Comité contre l'esclavage moderne va disparaître. Du moins si les subventions ne sont pas reconduites à l'identique, et c'est bien cela qui se dessine, en cette fin de décembre. Sur les sept ministères qui soutenaient habituellement le comité, deux n'ont pas renouvelé leur aide (Ville et Service des droits des femmes), la plupart des autres ayant alloué des sommes très inférieures. "On a tapé les copains, obtenu un découvert bancaire, avancé notre fric pour payer les salaires de juin", note Sylvie O'dy. Reste à trouver près de 60 000 euros pour boucler le budget 2002. Sinon, le Comité ne passera pas le printemps. Qui s'occupera des victimes ? Celles qui sont déjà protégées seront mises à la rue ? Et les autres ? En attendant, il faut bien faire comme si. Continuer le boulot pour eux, les esclaves modernes. Pour cette jeune Togolaise, par exemple, qu'on accompagne au tribunal correctionnel de Versailles, jeudi 12 décembre. Dans la salle des pas perdus, visiblement terrorisée, elle aperçoit ses anciens "patrons", d'origine togolaise eux aussi. Elle évite leur regard, sourit timidement, avoue : "J'ai un peu peur, la tête me tourne." Elle a eu le courage de porter plainte, ce qui n'est pas une mince affaire. La plupart des esclaves domestiques refusent de poursuivre leurs patrons. Un drôle de mélange : peur de l'avenir, conditionnement, syndrome de Stockholm, résignation par respect des traditions locales. La peur surtout. Une peur panique. Peur de se retrouver à la rue ou en prison, ce qui n'est pas à exclure, surtout sans papiers. Peur des représailles sur leur famille. Peur que les patrons, à quelque endroit de la planète, les retrouvent pour leur faire la peau. L'histoire de cette jeune Togolaise est une affaire banale, le quotidien du Comité contre l'esclavage moderne : un abus de vulnérabilité pour des services non payés. Pas de sévices (excepté quand elle a cherché à s'enfuir), pas de viol, juste une mise en servitude doublée d'humiliations, et, bien sûr, aucun salaire. On voit passer de tout, au Comité. Jusqu'à la mort d'une jeune Malgache séquestrée, torturée, battue, obligée d'offrir son corps aux invités, morte de ses blessures, pour laquelle une commission rogatoire internationale est lancée. Jusqu'à cette Marocaine, tabassée et violée par son patron, tombée enceinte à la suite du viol et qui a abandonné son enfant (affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel pour coups et blessures, le viol n'ayant pas été retenu). Jusqu'à la disparition totale de la domestique d'une personnalité étrangère surpuissante, mystérieusement "envolée" après avoir été renversée par une Mercedes noire, et sur laquelle l'enquête est en cours. Il y eut aussi le célèbre cas Vincent Bardet, fils du cofondateur des humanistes éditions du Seuil et alors directeur de la collection "Points-Sagesse", poursuivi avec son épouse pour avoir exploité une Togolaise en situation irrégulière et mineure au moment des faits (l'affaire, passée en cassation, sera rejugée). Il y eut le cas des employeurs de Menja, jeune Malgache. Condamnés en appel et si bien sous tous rapports, ce couple d'employeurs : elle, gérante d'une société d'export de fruits de mer, lui, ingénieur-géologue chez Elf. Les nouveaux esclavagistes présentent bien, la plupart du temps : un air comme il faut, éduqués, employés ou cadres supérieurs. Monsieur et madame tout le monde, quoi. De la femme de ménage africaine qui exploite plus pauvre qu'elle au coopérant de haut niveau marié à une locale, en passant par le banquier de province. Ils disent souvent la même chose. Qu'ils ne voient pas où est le mal. Que la victime a bien de la chance d'avoir trouvé un toit chez eux. Qu'elle fait partie de la famille, travaille sans déplaisir du petit matin à la nuit, dimanche et jours fériés inclus, est rémunérée par une "cagnotte" invisible. Qu'elle dorme par terre dans la salle de bains, mange à part sur un coin d'évier, ait les mains en lambeaux ou des traces de coups sur le corps trouve toujours justification. "Jamais, pas une fois, on n'a vu un employeur avoir des remords", s'étonne encore Sylvie O'dy. Quant aux esclaves, on y trouve aussi de tout. Même des hommes. Même des Français. Même des majeurs. Même si la majorité sont des femmes, jeunes, étrangères, asservies par des employeurs issus de la même communauté. LE problème, c'est que l'esclavage n'existe pas. Du moins selon la justice française : on n'inscrit pas dans le code pénal une réalité abolie. Quant à la définition du Robert, "soumission à une autorité tyrannique", elle signifie trop de choses pour faire une loi. Faute de mieux, deux articles du code pénal (225-13 et 14) rassemblent des éléments d'infraction autour de l'abus de vulnérabilité ou de dépendance d'une personne : est délictuel d'obtenir d'elle la fourniture de services non rétribués, de la soumettre à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Mais la vulnérabilité, comment l'établir à coup sûr quand la victime est majeure, et si elle n'a pas été séquestrée ? La réponse est un subtil micmac psychologique. Il y a le déracinement. L'isolement. La perte des repères. Et surtout, encore et toujours, la peur. Alors, souvent, les esclaves pourraient s'enfuir et ils ne s'enfuient pas. Voilà qui suscite parfois les sarcasmes. L'incompréhension du magistrat. Au cours des procès, Céline Manceau en a entendu, de ces magistrats qui ricanaient. Dites-moi, pourquoi n'a-t-elle pas quitté ses tortionnaires alors qu'elle avait les clés ? Sous-entendu : une petite qui fait la bonne sans être payée, c'est qu'elle doit y trouver son compte. Et d'ailleurs, où est le mal ? Condamnés, les esclavagistes encourent deux ans d'emprisonnement et 76 000 euros d'amende. Des peines qui se réduisent généralement à quelques mois de prison avec sursis. De quoi indigner les battants du comité. Céline Manceau : "Les atteintes aux personnes sont souvent moins fermement sanctionnées que les atteintes aux biens. Si vous chourez une mob ou une radio, ce n'est pas du sursis que vous prenez." L'un des espoirs du Comité, dans la foulée du rapport de la mission parlementaire présidée par Christine Lazerges (décembre 2001), est de faire adopter un amendement à la loi sur la sécurité intérieure : si la notion de traite des êtres humains est introduite dans le code pénal, la lutte contre l'esclavage moderne aura marqué un pas. Mais qui saisira la justice ? En ce moment, le comité reçoit près d'un signalement par jour. Tout le monde est débordé. De moins en moins de moyens, de plus en plus de victimes. Derrière le comptoir de la boutique, l'employée du début de l'histoire a toujours un hématome au milieu du front. Son dossier est entre les mains du substitut du procureur. L'audience où devaient comparaître les patrons de la jeune Togolaise, au tribunal correctionnel de Versailles, a été reportée au mois de mars 2003. D'ici là, si rien ne se passe, le Comité contre l'esclavage moderne aura fermé ses portes. Les victimes ne seront pas gênantes, on n'en parlera plus. Marion Van Renterghem • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU
24.12.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droits de reproduction et de diffusion réservés © Le Monde 2002 Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions. Politique de confidentialité du site. Besoin d'aide ? faq.lemonde.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||