Dans les nombreuses
conférences et autres communiqués de presse complaisants
traitant des rapports entre la musique et l’internet, non seulement
l’impact du piratage sur les ventes semble une évidence qui n’est
presque plus remise en question (« les gens échangent des
fichiers MP3... “donc” ils achètent moins de disques »), mais
surtout deux autres questions très importantes sont carrément
occultées :
— Quel est le lien entre le processus industriel
du disque (et notamment le rôle de la maison de disques en tant
qu’agent économique) et la création musicale ? La disparition
des agents économiques tels que nous les connaissons aujourd’hui
implique-t-elle la disparition de la création musicale (via la
disparition des artistes eux-mêmes) ?
— Quelle place doit occuper ce processus
industriel à l’heure de l’internet ? Qui doit faire quoi ?
Qui doit être rémunéré pour quel service ?
Ces questions, dans le cadre de la production
musicale, sont assez pénibles à traiter : la confusion est
savamment entretenue autour des chiffres, les artistes
« signés » ont du mal à imaginer une autre façon de
produire de la musique que celle qui les relie aux majors, le public
est saturé d’amalgames répétés mille fois, d’informations
approximatives, et le tout baigne dans une ambiance de passions qui
ne facilite ni la réflexion ni la discussion.
Le présent article se propose d’aborder ce sujet en le
déplaçant dans un secteur de l’industrie culturelle où les débats
sont un peu plus calmes : le secteur du livre.
L’industrie du livre
Les questions précédentes, que les maisons de disque
répugnent à poser, sont nettement plus faciles à aborder lorsqu’il
s’agit du livre. Sans doute parce que la diffusion de livres publiés
par des éditeurs sur l’internet, que ce soit de manière légale ou
illégale, n’est pas encore un phénomène massif (même si, par
ailleurs, la diffusion d’œuvres littéraires originales y est
omniprésente, mais hors cadre marchand).
Le livre en France représente, en 2002, un chiffre
d’affaires de 2,4 milliards d’euros (source : Syndicat national
de l’édition). C’est-à-dire à peu près :
— deux fois
celui du disque,
— quatre fois celui du cinéma,
— un cinquième de celui de la presse.
Le site du SNE propose un tableau
récapitulatif pour l’année 2001, et les chiffres de 2002 sont
très similaires.
On trouve sur les réseaux de peer to
peer quelques bandes dessinées au format PDF, généralement des
mangas, et sur des sites personnels, des particuliers proposent des
listes d’ouvrages en vue d’échange ou de troc
(généralement là aussi de la bande dessinée). Pour la littérature
blanche ou noire, quelques particuliers proposent au téléchargement
des textes classiques (par exemple : Faust de Goethe). Côté institution, signalons l’ABU : la
Bibliothèque Universelle qui, avec l’aide d’une équipe de
bénévoles, numérise les textes tombés dans le domaine public ;
enfin côté marchand, on trouve foultitude de bouquineries on line,
spécialisées dans le livre ancien ou rare, qui publient leur
catalogue.
Devant cette rareté de livres numérisés disponibles en
téléchargement [1], et
l’aspect extrêmement marginal de l’échange de livres
« piratés », on peut comprendre l’absence de grandes
diatribes générales contre l’internet de la part des maisons
d’édition. Cette relative indifférence face aux (terribles) menaces
pour la création est également due à l’absence de diffusion sur
l’internet par les éditeurs eux-mêmes : ces derniers ne
fournissent pas de livres au format numérique, justement par crainte
de voir ces fichiers échangés par la suite sur le réseau. On a donc
probablement un secteur industriel qui évite d’explorer de nouveaux
moyens de diffusion, par crainte du piratage qui est perturbation du
monopole.
Nous verrons que cette question du « piratage de
livres », si elle est facile à mettre en avant pour se donner à
la fois bonne conscience et une bonne image (rendre son combat
populaire auprès du public et de ses représentants élus), n’est pas
le seul enjeu, car d’autres questionnements, nettement moins
gratifiants, attendent les éditeurs passant à la diffusion
numérique.
War against photocopillage
Si la situation du livre (peu de copies numériques)
semble très différente de celle du disque (assassiné comme chacun le
sait par les graveurs de CD…), il faut se souvenir tout de même du
glorieux épisode de la guerre contre le « photocopillage »
(on cherche encore comment des gens de lettres ont pu accoucher d’un
néologisme aussi indigne).
Au début des années 1990, le Syndicat national de
l’édition annonce la baisse des ventes de livres. Le chiffre n’est
remis en cause par personne, car annoncé par le SNE lui-même ;
sachant que le SNE est le syndicat corporatiste des patrons de cette
industrie, les chiffres méritent d’être cités avec une certaine
réserve.
Cause immédiatement désignée de cette
catastrophe : la photocopie ! La presse, avec un goût
inhabituel pour l’investigation, le débat critique et la mission
citoyenne, reprend sans trop se poser de questions toutes les
théories du syndical patronal : la photocopie, massive, tue la
création littéraire en France !
L’alibi culturel de l’argumentaire est pourtant tout
relatif : en effet, la littérature, si elle est la façade
médiatique du secteur de l’édition, ne représente que 20% de son
chiffre d’affaires. De plus la moitié des ventes (en volume comme en
chiffre d’affaires) est réalisée par les réimpressions... Ainsi les
invités de Bernard Pivot représentent moins de 10% du secteur de
l’édition, et sans doute beaucoup moins dans les manques à gagner
supposés provoqués par la photocopie.
Toujours est-il que la campagne médiatique est
rondement menée, avec la mise en avant de la défense de la seule
création culturelle. Le tout débouchant sur des mesures
particulièrement symboliques en matière de défense et de promotion
de notre identité culturelle : TVA réduite sur le livre, taxe
sur les photocopies, rémunération au titre du prêt en
bibliothèque [2]
Enchaînement très classique : baisse supposée des
ventes (en tout cas, sur la seule foi des chiffres fournis par les
industriels eux-mêmes), mise en avant d’un alibi culturel,
dénonciation d’une hypothétique « piraterie » qui tue la
culture, finalement obtention d’une série de mesures de subvention,
d’aides à la création et à la diffusion du secteur industriel tout
entier au détriment du contribuable.
Notons que l’on retrouve dès 1997 des spécialistes de
l’Internet sur cette question puisque, lors des rencontres
de l’Internet Society à Autrans, parmi les propositions,
figurait celle-ci : « L’État pourrait mettre
sur un serveur la liste complète des sources de subventions
disponibles pour l’édition sur l’Internet et proposer un guichet
unique afin d’y déposer un dossier. Il serait possible que la liste
des subventions accordées, ainsi que celle des bénéficiaires, soit
publiée. Serait-il concevable, enfin, qu’une fraction significative
de ces subventions soit réservée aux nouvelles
entreprises ? ».
En voilà une belle mutation sociétale ! Il est
toujours plaisant de constater que la défense et la promotion de
l’art-qui-n’est-pas-une-marchandise passe systématiquement par des
taxes nouvelles, des incitations fiscales et des subventions.
Le prix du livre
En matière de musique, il semble indécent de demander
pourquoi il faudrait maintenir une industrie aux processus
obsolètes, qui continue à ponctionner un revenu énorme sur la
création, alors que l’internet permet de créer de nouveaux circuits
de diffusion de cette création.
Concernant le livre, ces questions ne choquent
pas :
— le relatif calme de la situation (les ventes
de livres progressent tous les ans) autorise à poser ce genre de
question ;
— entre eux, les éditeurs se les posent.
Nous utiliserons ici une donnée très
intéressante : la décomposition moyenne du prix d’un livre
(source : SNE).
— auteur : environ 10%,
— éditeur : environ 15%,
— prépresse, papier,
impression, façonnage : environ 20%,
— diffusion : environ 8%,
— distribution : environ 14%,
— détaillant
(libraire) : environ 33%.
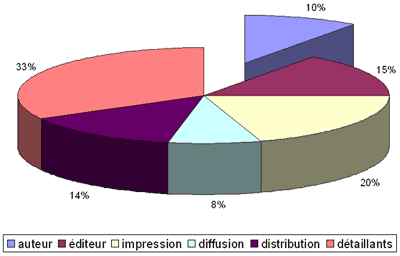
Pour le client final, ajouter encore une TVA de 5,5%.
Ces frais sont très variables en fonction du type de
livre et du nombre total d’exemplaires vendus. Une partie des frais
est fixe ; notamment la fabrication du « prototype »
(prépresse) ; le coût de cette création est beaucoup plus élevé
dans certaines catégories de livres que d’autres (par exemple, le
prototype d’un manuel scolaire scientifique coûte beaucoup plus cher
que la composition d’un livre de littérature générale). La part de
ces frais fixes diminue en pourcentage lorsque le tirage augmente
(même investissement, que le livre se vende à 300 exemplaires ou à
30 000).
Dans la logique de l’action de lutte contre le
photocopillage, notons qu’il est particulièrement savoureux de
mettre en avant le risque qu’il fait peser sur les seuls auteurs de
littérature : la littérature ne représente que 20% du secteur
de l’édition, la moitié seulement de ce secteur est consacrée à la
production de nouveaux livres et, là-dedans, le poids des auteurs en
tant qu’agents économiques est de 10%. On peut tout aussi bien
affirmer que le photocopillage nuit moins aux auteurs de littérature
qu’une hausse du prix du tabac !

Un sujet qui préoccupe les Français
Pour Jean-Claude, la crise de
l’édition est principalement due au premier amendement de la
constitution de ces putains de yankees. Heureusement le Prix
Unique et Jack Lang nous
protègent. |
Une autre bizarrerie semble ne choquer personne. Les
frais de fabrication d’un livre ne cessent de baisser. La PAO a
réduit le coût de la création du « prototype » dans des
proportions énormes, notamment pour les livres
« compliqués » (ouvrages techniques, livres en couleur,
etc.) ; dans le même temps, le recours aux services d’ateliers
dans des pays en développement (la mondialisation heureuse en Inde,
Afrique du Nord, au Vietnam), facilité par la baisse des prix de
l’informatique, l’accès aux compétences informatiques et l’échange
de fichiers par le réseau, ont fait chuter les prix de la
composition, dans tous les domaines (aussi bien composition
« simple », telle la littérature, que la composition plus
complexe des ouvrages techniques). Les coûts de validation du
prototype (épreuves numériques, disparition des « films »
d’impression…) baissent constamment. Quant aux frais liés à
l’impression, ils baissent également (depuis quelques temps, les
coûts des petits tirages suit une baisse impressionnante).
Dans le processus de fabrication du livre, aussi bien
les frais fixes que les frais variables baissent. Même les frais
liés à l’activité des éditeurs eux-mêmes baissent, depuis les années
80, avec l’application de techniques de gestion et d’organisation
plus efficaces héritées des autres secteurs industriels.
Donc, la plupart des coûts intervenant dans le prix
d’un livre baissent, certains dans des proportions qui n’existent
dans aucune autre industrie. Pourtant, le prix des livres n’a pas
baissé (et surtout pas dans ces proportions). On a donc le maintien
du revenu fixe de tous les agents économiques du livre, alors que
tous leurs coûts diminuent énormément. Le seul acteur dont les coûts
n’ont aucune raison de baisser, c’est l’auteur.
Voilà notre bizarrerie fort peu morale : malgré
cela, les droits de l’auteur sont toujours les mêmes qu’au début du
siècle... C’est le seul intervenant dans la chaîne du livre dont le
revenu n’augmente pas et dont les coûts ne baissent pas ; tous
les autres voient leurs coûts chuter pendant que leurs revenus sont
maintenus constamment. Dit autrement : non seulement ceux qui
achètent des livres ne profitent pas de la baisse des coûts de
production, surtout le seul acteur auquel le maintien du prix du
livre malgré la baisse des coûts ne profite pas, c’est l’auteur.
Sans vouloir procéder par une analogie trop rapide, on
invitera simplement ici le lecteur à voir si cette évolution n’est
pas rigoureusement similaire pour le disque : des coûts de
production en chute libre, les seuls agents économiques du système
qui n’en profitent pas étant l’artiste et le client.
L’avenir d’un processus industriel obsolète
La situation actuelle est celle de l’émergence d’une
nouvelle technique, l’internet, qui permet de remplacer certaines
méthodes des industries culturelles. Pour le dire simplement :
un auteur peut diffuser son œuvre de lui-même via l’internet, et
même se faire payer directement par ses lecteurs [3]. De la même façon, un musicien peut distribuer sa
musique en ligne et se faire payer directement.
Reprenons la décomposition du prix d’un livre, et
voyons ce que cela donne, rapporté à cette situation nouvelle.
 Création du
prototype
Création du
prototype
On peut considérer que la composition et le maquettage
d’un livre, que ce soit pour l’internet ou pour le papier, sont des
processus identiques, donc que les frais ne changent pas. Dans
l’absolu, c’est vrai. Dans la pratique, pas tout à fait : la
préparation d’un document pour l’internet est nettement moins
exigeante que pour l’impression, tant en termes de complexité des
formats, de définition nécessaire, de maîtrise de techniques.
N’importe qui peut diffuser des textes illustrés d’images en couleur
sur l’internet ; préparer des images en haute définition pour
la quadrichromie nécessite encore des compétences professionnelles.
De plus, l’idée étant ici, tout de même, de répercuter
une baisse des coûts auprès du client final, on peut admettre que
les exigences du client seront moins élevées car le produit est
vendu nettement moins cher ; et réaliser une document
simplement « propre » coûte beaucoup moins cher qu’un
document « professionnel » à la mise en pages extrêmement
soignée.
D’autres frais fixes baissent lors du passage de
l’impression au tout numérique : absence d’épreuves de contrôle
imprimées, pas de création de films ni de plaques d’impression,
absence de machines professionnelles spécialisées coûtant très cher.
 Impression,
façonnage
Impression,
façonnage
Les coûts d’impression et de façonnage disparaissent
totalement du prix de vente. Ils sont remplacés par l’hébergement
(comprenant généralement un forfait de bande passante), pour des
prix incomparablement plus bas.
On peut pousser le raisonnement plus loin : ces
frais sont carrément pris en charge par le client lui-même. Qu’il
imprime le document chez lui ou qu’il grave un CD de musique, il
prend sur son propre temps pour réaliser une opération qui était
auparavant réalisée lors du processus industriel, et il utilise le
matériel qu’il a lui-même acheté, avec les
« consommables » (encre, papier, support de stockage)
qu’il paie.
Ceci impose une petite remarque : les solutions
destinées à « soutenir » les industries culturelles sont
toutes basées sur un système de taxation sur les consommables et
l’activité de reproduction. Il est très amusant de voir que le
principe consiste à ponctionner les nouvelles techniques, utilisées
par le client, alors que justement ces techniques rendent inutiles
les anciens procédés industriels. Le jour où ces industries
culturelles décideront d’utiliser ces nouveaux processus - vente
directe en ligne de contenus sans support matériel -, le client
se trouvera en situation d’acheter le contenu, de réaliser avec ses
propres moyens l’opération de reproduction, tout en étant taxé pour
soutenir un processus industriel que cette nouvelle chaîne
économique aura totalement rendu obsolète. Le client se retrouve
donc à payer pour soutenir une activité qu’il effectue
lui-même [4]. Il
semble difficile dans ces conditions d’appeler à une
reponsabilisation des pratiques du client.
 Diffusion,
distribution, détaillant
Diffusion,
distribution, détaillant
Cette partie énorme du prix du livre (plus de la
moitié de son prix) est rendue totalement injustifiée dès lors que
l’auteur vend directement à ses lecteurs-clients (ou que l’éditeur
en ligne vend directement).
Il reste donc la rémunération de l’auteur (10% du prix
de vente d’un livre « papier ») et la rémunération de
l’éditeur (15%). Mathématiquement, un livre vendu directement sur
l’internet, sans support physique, ne devrait plus coûter que 25% de
son prix en librairie.
Malgré le risque d’une analogie encore trop facile, on
peut considérer que la musique vendue (légalement) en ligne devrait
elle aussi coûter près de quatre fois moins cher qu’en magasin.
Alors que tout le monde se réjouit du succès des ventes
en ligne de musique par Apple, chaque « chanson »
étant tout de même vendue 1 dollar (ce qui fait encore bien cher
l’album complet), on voit qu’il reste du chemin à faire vers une
véritable « moralisation » des pratiques commerciales des
industriels de la culture.
Le cas du livre est d’autant plus exemplaire, puisque
chacun constate à quel point imprimer le livre chez soi peut être
plus long et plus cher que l’acheter en librairie. Pourtant, c’est
bien le même principe lorsque l’on grave un CD : le
« client » a lui-même récupéré le morceau (tout le circuit
de distribution disparaît), il a acheté le matériel de reproduction
(il n’y a plus d’industriel pour réaliser l’opération à sa place) et
il utilise ses propres « consommables ».

Le comble de l’horreur masquée
Le terrible spectre du
photocopillage menace en pleine rue un auteur innocent.
[Collection privée]. |
Cela tient de l’évidence pour le livre : les
éditeurs sont bien conscients qu’ils ne pourront pas vendre des
livres en ligne sans une division des prix par trois ou quatre. Et
qu’ils devront évidemment remonter le pourcentage des droits des
auteurs (logiquement, ces droits passeraient à quasiment 50% du prix
de vente) [5]
Cette évidence économique est certainement l’une des
raisons de leur peu d’empressement à investir un tel marché (s’il
existe). À moins d’une campagne de communication aussi éhontée que
celle de l’industrie du disque, on ne voit pas ce qui permettrait,
de toute façon, de convaincre les clients d’une logique inverse.
Les analyses publiées au sujet du livre numérique
semblent d’ailleurs se focaliser sur des produits spécifiques. On
constate cependant que la question du prix est centrale :
« Le coût unitaire est beaucoup moins
élevé que celui des versions papier, dans un rapport de un à quatre.
Introduit en 1995, le premier CD-Rom de ce type a d’emblée dépassé
les ventes de la version papier : 100 000 CD-Rom vendus en
trois ans (soit une moyenne de 30 000 par an), les ventes
annuelles de la version papier étant passées de 20 000 à
5 000 ou 6 000 exemplaires. On voit à la lecture de ces
chiffres que le numérique pourrait élargir de façon significative le
marché des encyclopédies et qu’il constitue, dans ce segment, un
substitut au livre papier. » Ce même rapport aborde le cas
exemplaire de 00h00 (maison d’édition en ligne), mais occulte le
problème de la répartition des droits : « On peut citer le
cas de 00h00, dont les trois-quarts des commandes enregistrées
jusqu’à présent ont porté sur les versions électroniques des
ouvrages. Le coût de celles-ci s’établit, selon le cas, entre 35 et
70% de celui des versions papier. » (
Rapport
de la commission de réflexion sur le livre numérique, mai 1999)
De fait, tous les éditeurs (nouveaux ou anciens) qui
se sont intéressés à la vente de livres sans support physique (i.e.
sans papier) en ligne ont été confrontés à cette épineuse
question : à quel prix vendre un livre en ligne ? D’un
côté, plus grand-chose ne justifie de vendre par exemple un roman à
20 euros, la disparition des frais de fabrication et du circuit
commercial ne permettant pas de justifier un prix supérieur à,
disons, 5 euros ; de l’autre, dans la psychologie supposée du
lecteur-client, que « vaudrait » un livre vendu aussi peu
cher ?
Curieusement, cette évidence ne semble pas exister
pour la musique. Le lien entre la vente physique des disques et la
rémunération des artistes semble indiscutable, et la remise en cause
d’un processus industriel obsolète est totalement niée. Comme si la
question ne se posait pas. Comme si elle n’allait jamais se poser.
Se passer de l’éditeur
Dans la partie précédente, on a vu qu’au moins 75% des
coûts justifiant le prix du livre étaient rendus injustifiables par
une diffusion sur le réseau. Seule les parties « auteur »
(10%) et « éditeur » (15%) relèvent de
« services » qui existent encore (les autres sont
remplacés totalement par l’utilisation du réseau).
Imaginons la suite logique : l’auteur se
débarrasse de l’éditeur. Analogie avec le disque : le musicien
se débarrasse de la maison de disques. L’état actuel de la technique
(et sa simplicité) rend ce choix déjà parfaitement possible (et
utilisé par certains).
 Le maître
d’œuvre
Le maître
d’œuvre
Si une certaine image des éditeurs est celle de quasi
intellectuels lisant des manuscrits et servant de thérapeutes à des
artistes maudits, la réalité du métier est largement celle d’un
maître d’œuvre coordonnant les différents prestataires de service
intervenant dans la fabrication d’un produit manufacturé et sa
commercialisation.
Dans l’optique d’une diffusion en ligne, nous avons vu
que ces prestataires devenaient inutiles. Ce rôle de maître d’œuvre
de l’éditeur disparaît ainsi ; en tout cas, ce qu’il en reste
peut être assuré par un agent moins gourmand, voire être totalement
pris en charge par l’auteur (des millions d’individus le font depuis
des années, un auteur peut bien s’y mettre dans l’espoir acquérir
plus d’autonomie, d’indépendance, de liberté et même, de parts de
droits d’auteurs).
 L’entremetteur
L’entremetteur
La justification classique du métier de l’éditeur (et
donc de sa rémunération) est de faire se rencontrer un auteur et son
public. Il est utile ici de rappeler le chiffre fourni par le
SNE : le tirage moyen d’un livre est de 8 200 exemplaires.
Cette moyenne rend compte de situations extrêmement diverses :
— la littérature tire en moyenne à 10 300
exemplaires ;
— les ouvrages techniques, la
documentation, les livres de droit, de sciences économiques, de
sciences humaines… ont des tirages situés en moyenne (best sellers compris) entre 2 500 et 3 500
exemplaires ;
— ces tirages sont tirés à la hausse par
une poignée de best sellers dans chaque
catégorie ; ces livres tirés en dizaines ou centaines de
milliers d’exemplaire font monter ce chiffre moyen. L’immense
majorité des 60 000 titres produits chaque année se cantonne à
des tirages beaucoup plus modestes (un millier d’exemplaires par
exemple).
Si l’on compare ces chiffres aux fréquentations des
sites Web, on constate qu’il est nettement plus facile pour un
auteur de « toucher son public » via le réseau qu’au
travers d’un livre. Du strict point de vue « culturel »
(la diffusion des créations culturelles auprès des lecteurs), le
choix du « tout internet » se justifie totalement.
 Le
sélectionneur
Le
sélectionneur
Une autre justification du métier d’éditeur réside
dans la sélection des meilleurs. Toutes les œuvres ne trouvant pas
leur public, le rôle de l’éditeur serait, par la sélection (par sa
renommée et sa cohérence), de présenter au public un choix d’œuvres
qui l’intéressent ou qui méritent de l’intéresser.
Depuis des siècles, ce rôle extrêmement gratifiant est
cependant critiqué lorsqu’il s’agit de livres. D’une part, les
« erreurs » de jugement des éditeurs font partie des
anecdotes que tout le monde raconte (les grands auteurs refusés
partout, les œuvres charcutées par des éditeurs…). D’autre part, la
prétention d’une activité économique reposant sur la promotion des
œuvres de qualité est, pour le moins, contredite par la simple
visite d’une librairie ou par l’observation des chiffres des ventes.
Citons Jean-Marc Roberts (« Entretien avec
Jean-Marc Roberts, éditeur », Drôle
d’époque) parlant de son métier d’éditeur :
« Je pensais qu’en tant que conseiller
littéraire ou éditeur dans une maison d’édition, je pouvais
tranquillement imposer mes goûts, mes choix ; en fait non. Même
si j’y parvenais, je faisais ce travail pour un patron, pour une
maison qui m’employait et qui me demandait des résultats, mais d’une
manière beaucoup plus perverse qu’un groupe ou qu’une banque. Stock
est effectivement une filiale d’Hachette, mais quand Le Seuil a des
comptes à rendre, il les rend à des banquiers, donc ça se rejoint
quand même. Je parle de perversité parce que, quand j’étais éditeur
de littérature au Seuil, chez Gallimard ou chez Julliard, on me
demandait des résultats : c’est-à-dire de trouver des livres
qui se vendent sans me laisser vraiment la possibilité de publier
des livres qui ne se vendaient pas. Je schématise, mais finalement
le problème est là. »
L’image des maisons de disque, qui est celle de
personnages arrivistes, incultes et insupportables, ne fait pas
l’objet des mêmes moqueries liées à de dramatiques erreurs de
sélection, ni à une censure inadmissible. Les maisons de disque ont
une mauvaise image, mais l’idée demeure que le système permettrait
globalement de faire connaître ce qui doit être connu (les bons
musiciens finissent par percer, les autres ne sont pas bons) ;
à l’inverse les éditeurs seraient des gens cultivés, sympathiques et
intelligents mais qui sont passés à côté de Proust. Ainsi le rôle de
sélection par les maisons de disques n’est que rarement remis en
cause (étouffer des génies méconnus), alors même que ce rôle de
l’éditeur de livre est constamment critiqué. [6]
 Le
camelot
Le
camelot
La promotion fait également partie des justifications
du « coût » des éditeurs. Remarquons encore que la réalité
des prestations contredit largement cette revendication.
Non seulement les maisons d’édition ne consacrent que
très peu de moyens à cette promotion (quelques encarts dans la
presse, puisque la publicité audiovisuelle est interdite
contrairement au disque), de plus celles qui en ont les moyens les
consacrent à une partie infinitésimale de leur catalogue (en général
le poulain pour la course aux concours).
La promotion commerciale des livres par les maisons
d’édition est dans les faits une partie marginale de leur activité
comptable, et lorsqu’elle existe on peut discuter de son efficacité
pour la grande majorité des auteurs.
Cette promotion est, de plus, traditionnellement
largement prise en charge par les auteurs eux-mêmes : si les
éditeurs peuvent organiser des événements, le gros de
l’investissement se fait sur le temps des auteurs (signatures,
conférences, présentations…). Chose amusante quand on y songe :
voilà encore un coût, pour l’auteur lui-même, qui n’est généralement
pas intégré dans le prix du livre, puisqu’un auteur ne se fait pas
payer ses nombreuses journées de signatures et de présentations,
alors qu’un éditeur qui achète un encart publicitaire dans la presse
répercutera cet investissement sur le prix du livre.
Face à la très relative efficacité de la promotion
traditionnelle assurée par les éditeurs, on peut opposer la vitalité
des liens sur le réseau. Souvent présenté comme
« horizontal » (tout se vaut sur le Web, le bon et le
médiocre sont au même niveau...), le réseau dispose en réalité
d’outils et de méthodes qui facilitent la mise en avant des œuvres
originales par les usagers eux-mêmes.
Le Réseau permet des choses inconcevables dans
l’édition : il permet à chacun de s’exprimer directement (sans
sélection préalable par des entreprises), il permet de construire
une renommée sur la durée (rien de comparable avec un premier roman
envoyé au pilon au bout de quelques mois), mais aussi il offre des
outils et des méthodes collectives qui font ressortir les créations
originales. Et cela sans aucun frais de promotion.
D.I.Y.
Avec le Réseau, l’intérêt du recours à un éditeur perd
de son évidence. Même la mise en place d’une structure de paiement
pour assurer la rémunération de l’auteur peut se passer de l’éditeur
- dont c’est traditionnellement une des activités (les systèmes de
paiement en ligne utilisables directement par des vendeurs
indépendants se multiplient).
On peut se demander si, face à cette perte totale de
légitimité (économique et sociale), le chahut organisé par les
maisons de disque n’a pas pour but de s’attribuer un nouveau rôle
social : celui du pouvoir de nuisance. En
grossissant le trait et en formulant le discours implicite :
« Regardez comme nous pouvons faire beaucoup de bruit, regardez
comme nous obtenons des subventions, regardez comme nos avocats sont
pénibles : artistes, nous seuls sommes capables de défendre vos
droits, si vous décidez de vous passer de nous, vous ne pourrez plus
bénéficier de cette force de frappe. »
Pour un auteur, une nouvelle possibilité peut
désormais être envisagée : réaliser lui-même, pour un coût très
faible, son propre document (intégrant la mise en page et la mise en
ligne), le diffuser lui-même et le vendre.
Auparavant, il était un acteur économique dans la vie
de son propre ouvrage à hauteur de 10% du prix de vente. Seul, il
peut envisager exactement la même rémunération, pour lui-même, soit
en réussissant à vendre son livre au même prix à 10 fois moins de
monde, soit en vendant son livre dix fois moins cher à dix fois plus
de monde. (Évidement, il y a de la marge entre ces deux extrêmes...)
Se poser ces questions au sujet du livre ne semble pas
totalement indécent. Curieusement, les mêmes interrogations, au
sujet du disque, sont totalement occultées du champ des
possibilités. Hors des maisons de disque, point de salut… Qu’est-ce
qui justifie pourtant que les artistes confient leurs droits et leur
image à des intervenants qui ponctionnent 90% du prix de vente, à
l’heure où un nouveau processus de distribution émerge dans tous les
pays développés (c’est-à-dire, soyons réalistes, là où se trouvent
les clients solvables qui assurent leur revenu) ? Est-ce que
taxer les nouveaux outils de distribution culturelle pour
subventionner des procédés industriels obsolètes répond à une
logique saine ?

Une note d’espoir
L’autoproduction et la libre
publication déclenchent l’enthousiasme de la jeune
génération. |
Concluons par un constat qui, s’il préserve pour un
temps le secteur industriel du livre, minore l’habillage culturelle
de son autojustification : le principal élément qui limite la
distribution totalement dématérialisée des livres, c’est l’aspect
infiniment plus pratique du livre-papier par rapport au livre sans
support : non seulement cela revient souvent moins cher que
d’imprimer chez soi, de plus le livre relié est plus pratique qu’un
paquet de feuilles A4 reliées à la va-comme-j’te-pousse dans un
atelier de reproduction pour les étudiants. Ainsi l’existence de
l’industrie du livre se justifie essentiellement par la fabrication
des produits industriels manufacturés que sont les livres
imprimés.

