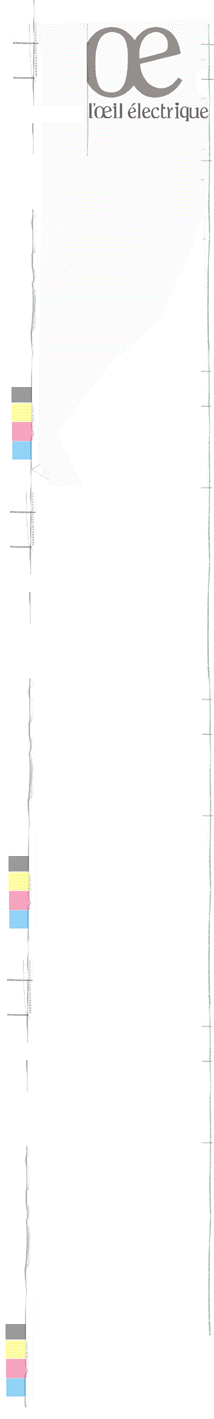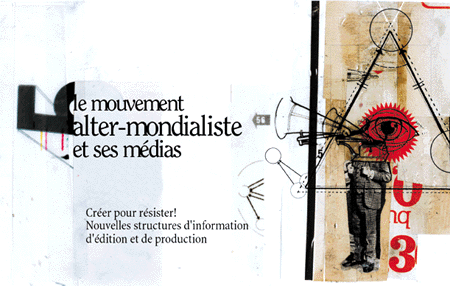|
Par Dominique Cardon, Fabien Granjon.
Illustrations : Patsh.
En peu de temps, Internet est devenu le principal espace de
visibilité des réflexions et des actions du mouvement alter-mondialiste.
Même si son audience reste limitée à une nébuleuse ouverte de militants et
de journalistes intéressés, la couverture sur le Web des contre-sommets
(Seattle, Prague, Québec, Gênes, Porto Alegre, Florence, etc.) tranche
sensiblement avec celle assurée par les médias traditionnels. Cette
production alternative d'information en ligne est en effet plus
documentée, plus illustrée, plus polémique et beaucoup plus focalisée sur
les enjeux de la critique de la globalisation que celle produite par les
médias dominants (peut-on d'ailleurs raisonnablement s'informer sur ces
sujets en regardant TF1 ou France 2 ?).
Au sein du mouvement
alter-mondialisation, la critique des médias est centrale. Elle constitue
une des sensibilités les mieux partagées par les militants. Leur méfiance
inspire d'ailleurs la création d'influents "scrutateurs", comme FAIR
(Fairness and Accuracy In Reporting), ONG effectuant une surveillance de
la couverture journalistique des actions militantes. De nombreux organes
de presse (Le Monde Diplomatique, Charlie Hebdo, Politis
qui font partie des membres fondateurs d'Attac …) développent
eux-mêmes des positions critiques à l'égard du fonctionnement du monde
journalistique. On peut alors penser que si l'Internet joue un rôle
important dans la constitution du mouvement mondial de résistance au
néo-libéralisme, c'est notamment parce qu'il offre un terrain expérimental
sur lequel peuvent s'édifier des dispositifs de publication cherchant des
alternatives aux pratiques médiatiques les plus critiquées.
Un contre-pouvoir
Au sein de la mouvance alter-mondialiste,
les militants ne font pas tous les mêmes reproches aux médias, ce qui les
amène à produire des contenus différents sur Internet. Un premier type de
critique, dont Le Monde diplomatique est le représentant attitré en
France, peut être appelé anti-hégémonique (1). Ce courant s'attache à
mettre en lumière la fonction propagandiste des "appareils idéologiques
de la globalisation" que sont les médias et appelle à la création d'un
"contre-pouvoir critique". Fort de nombreux succès d'édition
(Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, Serge Halimi, Ignacio Ramonet…), il
dénonce pêle-mêle l'allégeance des entreprises de presse au monde
politico-économique, la clôture de l'espace journalistique sur ses enjeux
professionnels, la recherche du profit et le sensationnalisme. Selon cette
critique, les journalistes sont appelés à reproduire la pensée dominante
par idéologie, par connivence ou par l'effet des contraintes qu'exercent
sur eux les conditions de production de l'information. Alors, pour
proposer une alternative aux pratiques dénoncées, la critique
anti-hégémonique avance un modèle de travail journalistique très proche de
celui du chercheur en sciences sociales : distanciation maximum, temps
long de l'investigation, rupture avec les formats courts et les formules.
Le discours anti-hégémonique a décidé de produire une contre-expertise.
Les sites, relevant de la critique anti-hégémonique et ayant repris le
principe de la contre-expertise sont nombreux. Certains sont des
"webzines" militants comme Les Pénélopes ou Cybersolidaires
(sites féministes), Place publique (site de l'Internet citoyen)
ou Mediasol, le portail de l'économie solidaire. D'autres sont liés
à des groupements associatifs et militants (Attac, No
Pasaran, Les Amis de la terre…) ou à des moments de la
mobilisation comme la "Farandole internationale de l'information
indépendante" (La Ciranda) créée pour mutualiser les différentes
productions journalistiques et militantes du Forum social mondial de Porto
Alegre. Ces sites se posent parfois dans une logique de concurrence avec
l'espace public des médias de masse, notamment pour la couverture des
manifestations et des contre-sommets. Mais ils se définissent surtout
comme des espaces de contre-expertise proposant sur des questions
spécifiques un discours mêlant spécialisation et indignation. Sur les
thèmes de l'eau, de la dette, des femmes, des inégalités Nord/Sud ou de la
brevetabilité du vivant, ils accueillent la production éditoriale des
universitaires, des intellectuels et des militants qui se sont impliqués à
différents degrés dans le mouvement alter-mondialiste. Ils opèrent une
surveillance parfois extrêmement technique des activités des organismes
internationaux (comme les "Brèves OMC" publiées par le groupe Traités
internationaux d'Attac-Marseille). Ils exercent une pression continue pour
obtenir documents et informations de la part des entreprises et des
institutions. Enfin, ils produisent des archives en réunissant des
informations habituellement dispersées (comme sur le site
transnationale.org qui cartographie les liens capitalistiques des
multinationales) et exercent un droit de suite en questionnant avec
ténacité leur cible.
Mais cette pratique
n'est elle-même pas exempte de critiques. En effet, ces sites militants
risquent de reconduire sur la scène de l'Internet un nouveau débat
d'experts entre intellectuels proches des organisations et militants
aguerris, fermé sur lui-même et difficile d'accès pour les nouveaux
entrants.
Une parole libérée
Une autre démarche critique,
d'inspiration libertaire, refuse l'accaparement de la parole par les
professionnels, les porte-parole et les experts. Beaucoup moins focalisée
sur la question de la vérité que sur celle de l'expression des
subjectivités, elle s'attache principalement à défendre et à promouvoir
les droits du locuteur. Elle puise son inspiration dans les manifestes
militants de défense des médias communautaires, alternatifs ou radicaux et
s'incarne plus récemment dans les positions autonomes de Michaël Hardt et
Toni Negri avec leur thématique de la multitude (cf. encart). Elle
entretient par ailleurs d'étroites affinités avec les positions défendues
par les militants politisés du logiciel libre. Cette critique qu'on peut
qualifier de perspectiviste (2) revendique l'instauration de dispositifs
de prises de parole ouverts. Elle s'oppose à l'usage médiatique actuel qui
tend à privilégier ceux qui maîtrisent les règles d'intervention dans les
médias au détriment de tous les autres.
Considérant que les médias
dominants se caractérisent par leur esprit centralisateur, conformiste et
autoritaire, les sites média-activistes proposent des espaces de diffusion
alternatifs, auto-organisés, souples, libérés a priori de toute
censure.
Né en novembre 1999 lors du sommet de Seattle autour du
Direct Action Network, le réseau Indymedia (Independant Media Center)
incarne cette culture de l'autonomie dans l'espace du Web militant. Il n'a
pas de responsables attitrés, dispose d'une structure organisationnelle
souple et discrète. Les 80 comités Indymedia répartis dans une vingtaine
de pays fonctionnent sur une base auto-organisée et décentralisée.
D'autres sites média-activistes peuvent lui être comparés, comme le Centre
des médias alternatifs du Québec (CMAQ). La principale caractéristique de
ces médias est de soutenir le principe de la publication ouverte (open
publishing) permettant à l'ensemble des individus qui le désirent de
publier en ligne, quasi-instantanément et en différentes langues, tous
types de documents (textes, sons, images fixes ou animées). La plupart du
temps, appliquant un principe de stricte transparence, les animateurs se
refusent à exercer un contrôle éditorial (3). Se défiant des procédures de
délégation, de représentation et de vote, les média-activistes s'en
remettent au principe du consensus. Ils entreprennent aussi de mettre les
informations directement à disposition de l'action militante (tracts,
lieux de rendez-vous, suivi en ligne en direct des manifestations, etc.),
en se méfiant des formes hiérarchiques de contrôle et de cadrage des
mobilisations.
Certaines prises de parole s'émancipent alors des
conventions de l'écriture experte, journalistique ou militante et
endossent une forme très subjective. Contrairement aux médias
contre-experts qui offrent finalement assez peu d'espaces de débats, les
dispositifs média-activistes s'appuient largement sur des listes de
diffusion et des forums (non orientés vers la prise de décision) où sont
discutés, souvent dans une cacophonie de points de vue, de la pertinence
et de la teneur des contributions. Sans doute cette variété de formats
d'énonciation est-elle, en principe, nécessaire à l'ouverture d'un espace
de parole à des non professionnels. Il faut cependant constater que là
encore, dans la majorité des cas, ces espaces de parole sont restreints,
notamment du fait du niveau élevé de politisation et de radicalité des
propos. Le modèle de l'open-publishing laisse par ailleurs ouverte
la voie à des provocations comme l'infiltration de textes antisémites qui
a déclenché le gel par ses animateurs du site français d'Indymedia. Sans
en contester le principe, les débats de la communauté média-activiste,
remettent aujourd'hui en cause les effets indésirables de l'open
publishing pour essayer d'établir des règles de modération et de
contrôle collectif des formats de publication.
Le réarmement de la parole critique
Les médias de la
contre-expertise, en facilitant le déploiement d'une rhétorique de la
preuve, de la vigilance et de l'investigation, ont redonné force à
certains formats d'énoncés alors que les média-activistes ont exploré des
formats d'énonciation encourageant le témoignage, l'appel à la
mobilisation et la colère. Le débat aujourd'hui au sein du mouvement
alter-mondialiste est de savoir s'il faut concevoir ces médias militants
comme une alternative à l'espace médiatique conventionnel, cherchant à le
concurrencer, le réformer ou lui imposer un nouvel agenda. Ou bien si ces
nouveaux lieux d'expression doivent être envisagés comme des "médias
citoyens" cherchant à favoriser les expériences de mise en récit des
engagements et à faire de la question de la "démocratisation de
l'information" un enjeu spécifique à chacune des luttes engagées.
(1)En référence aux travaux d'Antonio Gramsci, penseur marxiste italien
(1891-1937). Avec le concept d'"hégémonie", Gramsci souligne le caractère
idéologique (et plus seulement répressif) de la domination
capitaliste.
(2) En référence au relativisme radical nietzschéen qui
considère qu'il n'y a pas de faits mais seulement des interprétations et
qu'en conséquence il existe des régimes de vérité multiples.
(3) A cet
égard, le site média-activiste français de Samizdat (voir interview
dans ce numéro), d'inspiration autonome, fait exception en refusant le
principe de l'open publishing pour préférer se constituer en centre
de ressources militantes et assurer une couverture des mobilisations par
des cercles affinitaires de correspondants.
Le concept de multitude
Le concept de multitude tel qu'il est repris actuellement dans de
nombreux mouvements est d'abord un concept de Spinoza. Il a été
"réactualisé" par Antonio Negri, philosophe italien et Michael Hardt,
professeur de littérature nord-américain dans Empire (Exils
éditeur). La multitude voudrait dépasser le concept de classe ouvrière qui
n'enveloppe qu'une partie des travailleurs, acteurs en lutte. Opposée à la
notion de peuple, qui sous-entend son unité, la multitude est définie
comme un ensemble de singularités, de subjectivités porteuses de liberté
qui sont non représentables. Ces singularités qui se mettent en réseau
selon l'approche développée par Negri et Hardt sont aussi marquées par
l'évolution du monde du travail. La production est en effet de plus en
plus immatérielle et amène à de nouvelles formes de coopérations
intellectuelles. La multitude, selon les auteurs d'Empire tire
alors de son travail immatériel et intellectuel une force qui peut
s'opposer à l'exploitation capitaliste.
(*) Une version longue de ce texte a été publiée sous le titre
"Peut-on se libérer des formats médiatiques ? Le mouvement
alter-mondialisation et l'Internet" dans la revue de sciences sociales
Mouvements (# 25, janvier-février 2003, p. 67-73). Le texte initial
a été raccourci et remanié par Muriel Bernardin.
Quelques sites de l'alter-mondialisation
Sites de contre-expertise :
Attac : http://attac.org/
Les Cybersolidaires : http://www.cybersolidaires.org/
Les
Pénélopes : http://www.penelopes.org/
Mediasol
: http://www.mediasol.org/
InterActivist
Infos Exchange : http://slash.autonomedia.org/
Transnationale
: http://www.transnationale.org/
Sites média-activistes :
Carta : http://www.carta.org/
Centre des
médias alternatifs du Québec : http://www.cmaq.net/
Independant Media
Center : http://www.indymedia.org/
Nodo50 :
http://www.nodo50.org/
|