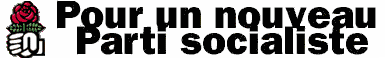Libération - Rebonds
Pas de ligne Maginot sur le Net
L’avenir de la culture et la défense des créateurs ne passent
pas par la chasse aux pirates
Article publié le jeudi 5 février 2004
La croisade contre le
« piratage » des oeuvres musicales et cinématographiques,
c’est le Prozac des industries culturelles en crise, qui
investissent plus dans d’interminables guérillas juridiques que dans
leur adaptation urgente à l’univers numérique. Prendre l’Internet en
otage serait la pire réponse à cette crise. « Droit
d’auteur » contre « piratage » : trop
simple ! Faut-il en effet criminaliser les pratiques de
millions d’internautes qui accèdent à la musique sur le
réseau ? Pourquoi transformer leurs fournisseurs d’accès en
shérifs privés ? Comment tirer les leçons de la révolution
numérique sans être accusé d’abandonner les créateurs, les auteurs,
les interprètes ? Le débat public qui s’enflamme fait
apparaître des enjeux politiques trop longtemps refoulés. Là où
beaucoup rêvaient d’un consensus bien ordonné, émergent désormais
des intérêts et des conflits que la puissance publique n’a pas
appris jusqu’ici à réguler. Il y a donc urgence à éclairer les choix
démocratiques.
Prenons-en acte : la révolution
numérique modifie brutalement les modèles économiques des industries
culturelles. On imagine la stupeur des moines copistes devant
l’irruption de l’imprimerie... C’est la situation des majors
d’aujourd’hui. D’abord, tous les économistes en conviennent, en
modifiant la chaîne de création, de production et de diffusion, la
mutation technologique transforme le rôle, la valeur ajoutée et le
bénéfice de chacun, pour le cinéma et encore plus pour la musique.
Pour les oeuvres musicales, en effet, les technologies numériques
rendent possibles la copie multiple sur des supports vierges, le
stockage sur des baladeurs et des disques durs, l’achat en ligne sur
des plates-formes ou des portails, ou encore, grâce à ceux-ci,
l’écoute gratuite et légale. Demain, le déploiement des réseaux à
haut débit étendra au cinéma ces bouleversements dont le DVD n’est
qu’une première étape.
Ensuite, les pratiques qui chamboulent
aujourd’hui le marché de la musique et réduisent ses ventes résident
dans les réseaux d’échange direct de fichiers musicaux « de
pair à pair » (P2P). Ces téléchargements concernent en France
des millions d’internautes et quelques centaines de millions sur le
réseau mondial. Plus encore, là où Napster concernait seulement les
fichiers musicaux, les logiciels P2P permettent de télécharger tous
les contenus numériques (vidéo, images, logiciels, jeux, etc.).
Ces usages de masse, dont le
développement s’accélère et qui font partie de la vie quotidienne de
millions d’Européens, obéissent à plusieurs logiques qui ne se
limitent pas à un effet d’aubaine. Le consommateur n’est pas dupe.
Il sait ou devine que dans l’univers numérique, la chaîne de
production et de diffusion change et que les coûts sont comprimés.
Il résiste aux excès du marketing musical et au durcissement de la
protection des droits. C’est pourquoi paraissent dérisoires les
batailles d’arrière-garde juridiques ou techniques, les guerres de
retardement face à des évolutions irrésistibles dont on mesure
encore à peine les effets.
La dernière trouvaille technique réside
dans le verrouillage des CD, les rendant illisibles pour une partie
des lecteurs. La dernière parade juridique prend la forme
d’amendements flibustiers à la future loi sur l’économie numérique.
Sans rien protéger, ils provoquent des dégâts collatéraux :
obligation de surveillance et filtrage dénaturent l’Internet
français sans apporter de réponses durables. Pour autant, la liberté
de l’Internet n’est pas le culte de la gratuité totale.
Réaffirmons-le, il n’y a pas de création culturelle sans
rémunération des artistes. Quelles sont les responsabilités de
chacun, celles des citoyens, des acteurs du marché et celle du
législateur ?
D’abord, nous devons refuser les
« lignes Maginot numériques », les bricolages improvisés
sous la pression d’intérêts particuliers au mépris de la recherche
d’une voie juste et équilibrée. Pour cela, il est impératif de
provoquer de vrais choix publics, sans renvoyer aux catacombes des
millions d’usagers de Kazaa. Ensuite, nous devons reconnaître,
négocier et défendre une pluralité de modes de rémunération et les
régulations juridiques. Les pistes sont légion. De la crédibilité de
ces réponses alternatives et déjà émergentes pour la rémunération
des créateurs dépend la culture dans la cité numérique. Rien
n’oblige à renoncer à des systèmes mutualisés de répartition des
droits, à condition de les moderniser et de les alimenter.
La redevance pour copie privée (sur les
CD ou d’autres supports numériques de stockage) a déjà permis
d’expérimenter une nouvelle forme de répartition des droits.
L’extension de la licence légale, à laquelle deux sociétés de
gestion des droits des artistes interprètes se sont ralliées, va
dans le même sens. L’adaptation de l’offre marchande doit insister
sur la qualité des services et l’innovation.
La première aurait dû être de proposer
une offre commerciale attractive, à prix raisonnable, de musique en
ligne et greffant des services sur les contenus, comme y invite
l’économie numérique dans tous les secteurs. Le recours à des
rémunérations forfaitaires ou à des abonnements (Canal + n’a pas tué
le cinéma...) participe de cette attractivité.
Mais chacun le perçoit, il faut aller
plus loin. En reconnaissant que des formes nouvelles de production,
voire d’autoproduction, ne cessent de se développer sur les réseaux,
rompant la chaîne des intermédiaires traditionnels, et offrant même
à une partie des artistes la possibilité d’être mieux diffusés et
rémunérés. En rappelant que la liberté essentielle de l’artiste,
c’est aussi de choisir son mode de diffusion. Désormais, les canaux
sont multiples. La diversité culturelle en sera renforcée. La
révolution numérique ne change pas seulement la diffusion des biens
culturels, elle transforme radicalement la création et l’économie de
la culture dans son ensemble.
Cet effort pour bâtir de nouvelles
règles du jeu se double d’une revendication appelée à devenir notre
manifeste politique : bâtir une coalition des biens publics
informationnels. Sur d’autres fronts que la création culturelle (les
brevets, les logiciels, les médicaments ou les semences
agricoles...), la question de la propriété intellectuelle et des
biens communs est également devenu un enjeu politique majeur. Dans
la cité numérique, faisons reconnaître une place immense pour
l’accès libre aux savoirs, pour de la gratuité et pour des contenus
publics. Une part conséquente du patrimoine culturel en fait d’ores
et déjà partie. Le mouvement pour le logiciel libre a conquis sa
place.
Oui, je crois, comme Daniel Cohen, que
« la propriété intellectuelle rompt avec le schéma de la
propriété tout court ».
Christian PAUL, député PS
de la Nièvre et président de la fondation les Temps
nouveaux.
Derniers ouvrages parus de Christian
Paul : Du droit et des libertés sur l’Internet, la
Documentation française, 2000, et Vers la cité numérique, fondation
Jean-Jaurès, 2002.
|