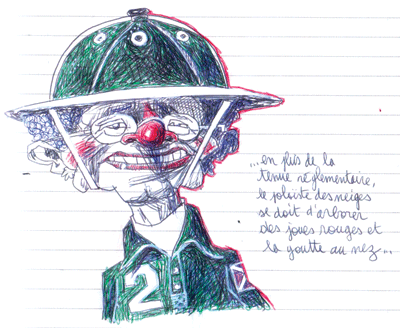
jeudi 1 novembre 2012
11:26
Voyage au sommet de l’oligarchie : La France de tout en haut
Par François Ruffin, 25/10/2012 , N°49 (02-2011)
Après les Zones industrielles picardes, Megève. Après les prolos, la France de tout en haut – et son tournoi de polo. On y allait comme le chrétien part en Terre Sainte : dans l’attente d’une révélation. Ici, l’exploitation allait se montrer à nue. Ici, nous allions découvrir leur secret, on titrerait genre « Le Mystère des Riches enfin résolu ! » Mais c’est justement l’inverse : Megève fonctionne comme un masque. Cette ville offre un négatif de la vie qu’ils imposent aux autres, ailleurs…
« Ici, Norbert Dentressangle est en train de se faire construire un énorme chalet. Ça doit valoir dans les 5 millions d’€, même plus… Sur votre droite, on passe devant chez Filipacchi, l’ancien patron d’Hachette… De l’autre côté, vous avez Givenchy… Et dans les parfums toujours, Lindsey Owen Jones, l’ex-PDG de l’Oréal… Tiens, c’est la famille Pollet. Mais si, vous connaissez : La Redoute… De ce côté-ci, les Rotschild installent tout un complexe de grand luxe… »
Sur les hauteurs de Megève, dans sa Panda 4x4, Anne-Catherine (on a changé le prénom, elle tient à sa réputation) nous offre un tour de CAC 40, les résidences d’hiver des grandes fortunes. Elle les connaît bien. Parce qu’elle en est, à moitié : unique héritière d’une boisson gazeuse, cédée à un groupe japonais. Parce qu’elle leur en a vendu, surtout, des villas perdues dans la montagne.
« J’ai tenu une galerie de tableaux. Ils achetaient des tableaux, des tableaux de merde, des tableaux italiens, qui étaient moches… C’est là que j’ai découvert que, vraiment, y avait beaucoup d’argent. Ensuite, j’ai ouvert une agence immobilière, plutôt spécialisée dans le standing. Je m’étais trompé : de l’argent, y en avait pas beaucoup, mais beaucoup beaucoup beaucoup. Je me souviens d’un jour, à midi moins le quart, je vois arriver une voiture de location, avec un mec en imperméable tout crade, une grosse bonne femme :
“- Est-que nous pourrions voir trois quatre logements ?
- Revenez cette après-midi, je leur dis, je vous montrerai tout ça.”
Le soir, une amie, dans la concurrence, m’appelle : “T’as eu des clients vers midi, aujourd’hui. Tu les as mal reçus ?
- Oh c’était rien, des fauchés…
- Ouais, eh bien, tes fauchés, c’étaient les Mulliez. Ils m’ont acheté un immeuble avec dix appartements.”
En dix minutes, ils avaient lâché plus de 20 millions de F de l’époque… »
Ça ferait plaisir aux caissières de Auchan, sans doute, de découvrir ce bout de paradis. Même si, au fond, y a pas grand-chose à voir. Juste des portails électriques qui coulissent, des grands murs, des bâtisses de bois.
« Les grosses familles, elles ont des gros chalets, avec piscine, tout le luxe, donc elles font la fête à l’intérieur. Alors qu’avant, c’étaient des plus petits chalets et ils sortaient, on les croisait au village. Maintenant, ils mènent leur vie entre eux, ils reçoivent à domicile. »
C’est tout le problème, pour un reportage chez les riches : pas facile de les approcher. Y a des digicodes à l’entrée, et quand on sonne, c’est une bonne à la peau brune et à l’accent du sud qui ouvre : « Monsieur n’est pas disponible ». Y a des carrés VIP où on doit montrer “pass” blanc avant de pénétrer. Y a des « chargés de com’ », qui vous tiennent à distance avec courtoisie. Y a, en plus, que votre porte-monnaie ne suit pas : pas question de les accompagner dans leur restau favori (vous mangez sur le parking une tranche de jambon Petit Casino), encore moins dans leur hôtel préféré (vous logez dans un Formule 1 en bas, du côté de Cluses).
333 € la minute…
« Bienvenue à la douzième édition du Polo Masters de Megève, hurle le commentateur dans sa sono. Les conditions climatiques ne sont pas bonnes, les températures sont très élevées… Voilà pourquoi notre tournoi s’est réfugié sur la patinoire… »
On n’a pas choisi notre week-end au pif, en cette mi-janvier : c’est le Polo des Neiges, avec ses hautes figures.
« Monsieur Laurent Dassault, aux couleurs du Mont d’Arbois, de la famille Rotschild, fait un tour d’honneur en ce moment, poursuit le commentateur. Face à lui, l’équipe JetFly. » En tant que reporter sportif, fan d’équitation, on compte bien causer de leur passion…
Une passion qui « coûte cher », admet Sébastien.
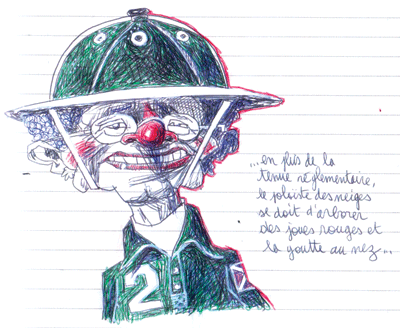
Au bar, après un coup de crosse (on dit « maillet ») pendant un match, ce promoteur immobilier, du côté d’Aix, se colle un bout de pansement sur le bout du nez : « Le budget moyen, c’est entre 15 et 25 000 € par tournoi. » Comparé à Laurent Dassault (le fiston des avions), ou à Philippe Charriol (le PDG des montres de luxe), lui fait presque figure de prolo du polo. Qu’on aborde la question financière ne le choque donc pas : « Celui de Megève, ça monte minimum à 30 000 €. Sur trois jours. Pour les autres, ici, vous doublez, vous triplez…
-Combien ça fait de la minute de jeu, alors ?
-Ça fait beaucoup. » Amusé, il sort son portable et tapote : « Trois parties de trente minutes, soit 333 € la minute de jeu. » Heureusement, il détient une recette pour diminuer les coûts : « On peut défiscaliser à hauteur de 60 % quand on est sponsorisés par sa société. » C’est donc l’État, ouf, nous tous, qui régalons aux deux tiers pour cet amusement. Pardon : cet investissement… Mais 30 000 € – Sébastien a aperçu nos yeux ronds – jamais on ne parviendrait à les claquer en trois jours ! Faut en bouffer à la truelle, des kilos de caviar ! Plonger dans des baignoires de Dom Pérignon ! « Mais 30 000 €, ça correspond à quoi ?
-Les femmes se rasent assez vite des passions des hommes. Donc aller à Deauville, à Megève, La Baule, à Saint-Tropez, ça fait passer la pilule. Avec une offre de services à côté. »
Un joli euphémisme, « offre de services », pour causer des hôtels quatre étoiles et autres boutiques Hermès. Reste que, 30 000 €, ça en fait des sacs à remplir de fourrures…
« Surtout, poursuit Sébastien, faut payer les chevaux, les joueurs, les petiseros… »
Faut saisir ça, cette différence : sur un terrain de foot, ou de rugby, ou de hand, tous les coéquipiers sont égaux, les barrières sociales tombent le temps d’une rencontre, seules comptent les qualités physiques. Pas au polo. Qui est un sport extrêmement hiérarchisé : la haute ne l’affectionne pas par hasard. Ici, au sommet, se trouve « le patron » - son vrai nom, je n’invente rien, la sociologie se livre à nu. Amateur, c’est le moins doué, mais il fait office de capitaine. C’est qu’il paie ses coéquipiers, des professionnels, souvent argentins - la patrie du polo - pour galoper à ses côtés. Le dernier échelon, c’est le « petisero » : le palefrenier, le valet d’écurie (mais ça fait plus classe en espagnol), qui ramasse le crottin des canassons et leur apporte les croquettes.
« Ce qui est bien, conclut Sébastien, c’est que dans ce milieu, on est en contact avec toutes les classes sociales. » Et ce qui est encore mieux, c’est que chacune reste à sa place…
« Le Polo Masters s’est réfugié sur la patinoire… mais même ici, même avec du produit, il a fallu beaucoup d’efforts pour faire geler la neige… » Tandis que les chevaux tournoient dans la gadoue, le commentateur poursuit sa complainte du climat : « J’espère que la nuit sera fraîche… Pourvu que la température descende de quelques degrés avant la finale demain… J’ai l’impression que malheureusement la surface est en train de s’abîmer un petit peu… » Autour du terrain, on assiste à une exposition de 4 x 4 – dont un Honda sera offert au gagnant. Et la sono fait entendre ce cri d’effroi de l’organisateur : « Quand va-t-on retrouver un climat de saison ? », avant de recommander, dans la phrase d’après, la compagnie « JetFly » - qui sponsorise une équipe.
Le match s’achève. Laurent Dassault « fils du sénateur, frère du député et petit-fils du grand avionneur qu’était Marcel Dassault » sort du terrain. De la buée remplit ses lunettes. De la sueur coule long de sa tempe.
« Je porte le maillot du Mont d’Arbois, de la famille Rotschild. Ce sont des amis à moi, de longue date, et je suis très fier de porter leurs couleurs. D’autant plus que nous avons un vin en commun en Argentine, qui s’appelle Fetcha de los Andes, et c’est un lien de plus qui nous unit à la famille Rotschild. » Une imbrication des dynasties capitalistes jusque dans les loisirs. « Je joue à Bagatelle en juin, à la Baule avec mon ami Jean-François Decaux [héritier des sanisettes et des panneaux Decaux], il m’arrive de jouer à Deauville. J’ai joué dans le désert, sur le sable, dans l’Emirat d’Abou Dhabi. J’ai joué en Argentine, au Chili, au Brésil. J’ai joué en Arabie Saoudite. Chaque fois que je peux jouer, j’emmène mes bottes. C’est un sport à la portée de chacun, tout le monde peut prendre un maillet et taper une balle. »
Et se payer trois quatre chevaux.
Ça sent le crottin sous la tente.
« Je m’occupe de la diversification du groupe, l’immobilier, le vin, les participations à l’étranger. Et je m’amuse beaucoup. Si vous ne vous amusez pas dans votre métier, ça ne sert à rien… » Il me traitait gentiment, sans arrogance, me guidait vers le salon VIP : comment le dépeindre en exploiteur ?
C’est la vérité, pourtant.
La froide observation des faits.
Il suffit de lire la presse du mardi 20 mai 2008 : « La crise semble épargner l’aviation d’affaires. Après un excellent cru 2007 et malgré un pétrole cher, elle continue de bien se porter. » C’est Le Figaro, le quotidien du groupe Dassault, qui nous en informe dans ses pages saumon : « Ces quatre mois, DassaultAviation a connu une activité commerciale assez bonne… 2007 avait été une année record avec 212 commandes de jets… “40 % des commandes sont passées par des entreprises et des particuliers qui ne possédaient pas d’avion” explique Alain Aubry, directeur des ventes de Dassault Aviation ».
Mais Le Figaro omet un détail l’actualité aéronautique. Il faut lire Les Échos, alors, toujours ce mardi 20 mai : cette « production qui va augmenter de 50 % d’ici trois ans » chez Dassault s’accompagne d’une « seule ombre au tableau », « une amplification des délocalisations ». Que confirme le PDG, Charles Edelstenne : « Les délocalisations constituent une arme décisive et nous allons être contraints d’y avoir de plus en plus recours… La démarche naturelle va être la délocalisation dans des zones dollar ou à bas coût, comme cela à été fait par l’industrie automobile… »
Ils construisent ce monde où la délocalisation, la quête planétaire des plus bas salaires, est présentée comme « naturelle » – même lorsque « Dassault Aviation enregistre une forte progression de son bénéfice net de 46 % au premier semestre ». Derrière ce « naturel », masqué, sans cesse, il faut révéler tout le « social » au contraire, tous les rapports (lointains) de domination – qui font de Laurent Dassault, gentil ou pas, arrogant ou pas, un exploiteur, avec son père, ses frères, ses pairs. Avec les camions Dentressangle, avec les hypermarchés Auchan, qui tous s’enrichissent sur le travail en miettes, sur les dimanches ouvrés, sur les temps partiels contraints, sur les salaires rognés, sur les pauses décomptées, sur la Pologne, la Chine, l’Inde moins chères, sur les exonérations fiscales, et les spéculateurs autour qui s’enrichissent sur l’enrichissement, sur l’art en hausse, l’immobilier en hausse, le luxe en hausse, tous les marchés de l’inutile qui prospèrent sur l’inégalité.
Mais il faut se forcer pour rétablir ce lien.
On va se forcer…
Leur décor…
Des chevaux, de l’écologique, du luxe rustique… Voilà l’univers enchanté que décrivent les amateurs de Megève. L’image qu’ils souhaitent avoir d’eux-mêmes.
« C’est une grande marque internationale… Il y a quatre-vingts boutiques Charriol à travers le monde, plus de 3000 magasins… J’ai d’ailleurs créé une montre Megève il y a une petite dizaine d’années. » J’ai l’air d’un con. « Charriol », je ne connaissais pas : je ne prête pas assez attention aux pages de pub du Nouvel Observateur (la plus modeste des breloques chiffre 499 € sur prixrikiki.com). Et c’est son PDG lui-même qui, en dégustant un thé, d’une voix lasse, me décrit son empire - m’accordant dix minutes comme un mauvais moment à passer.
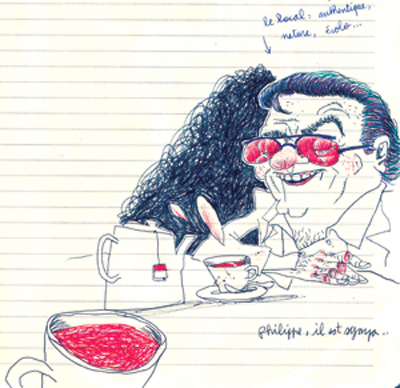
« Depuis douze ans, je suis un sponsor fidèle du Polo des neiges. C’est qu’à Megève, il existe une culture du cheval… Avec ma famille, d’ailleurs, pendant quinze ans, nous avons pratiqué l’art de se servir de calèches : l’été, les calèches étaient tirées par des trotteurs, et l’hiver par des traîneaux russes à quatre chevaux.
-Tout ça au milieu des 4 x 4 !, je le félicite.
-Le cheval peut passer là où le 4 x 4 ne passe pas. Le cochet attendait. Je montais au ski en calèche. Le mariage de ma fille s’est déroulé avec toutes les calèches, la grande calèche avec six alezans blancs… Nous étions écologiques avant l’heure. Notre chalet, de cinq étages, est tout en chêne. Nous avons un vrai goût de l’étable, on en trouve tout autour. »
A l’entrée de la ville, les panneaux « Megève » sont en bois. Le palace où Nicolas et Carla ont résidé, pour leur Saint-Valentin 2009, se nomme modestement « Les Fermes de Marie », avec des murs décorés (nous l’avons visité) d’antiques semoirs, de tamis paysans - mais avec des suites royales aux jets d’eau multidirectionnels et tout le bataclan. « Authentique », « naturel », ces adjectifs reviennent dans toutes les bouches et dans toutes les boutiques. Une étrange alliance, un oxymore, « luxe rustique » définit parfaitement, sans doute, cette place forte de la bourgeoisie. Car ils veulent tout, et ils ont tout.
Le luxe, bien sûr, les salles de bains avec hammam, les masseurs à portée de main, le champagne à volonté, les petits fours sur commande, les Blackberry dans chaque poche, toute la panoplie des hautes technologies. Et à côté de ce luxe, les signes du rustique. Les signes de la simplicité. Les signes de la pauvreté. Les signes, même, du populaire. Qu’on ne les enferme pas dans une identité sociale, de « gros riche ». Que ces businessmen, âpres au gain, champions des tableaux Excel, s’offrent une autre image d’eux-mêmes, le temps des vacances : « proches des traditions », soucieux de « l’artisanat local », comme l’énonce Philippe Charriol, vivant « au rythme de la terre, avec lenteur, et donc la traction hippomobile s’y prête parfaitement ».
« Le rythme de travail, c’est le contraire. Avion, hélicoptère… C’est pour cette raison, au passage, que j’ai choisi Megève comme villégiature. J’habitais souvent à New-York, à Hong-Kong, à Shanghaï, avec un système de multi-résidences, un pied sur chaque continent, qui me permet de suivre mes affaires et le soleil. J’ai étudié les approches aériennes en provenance d’Asie, d’Amérique, et j’ai conclu que Megève était un bon point de chute. C’est très pratique : j’atterris à Genève, et en trente minutes je suis dans mon chalet. »
Voilà la marque des nouvelles élites : leur mobilité. A l’inverse des vieilles fortunes, ancrées sur un territoire, eux n’appartiennent à aucune patrie, ne sont attachés à aucun lieu - sinon, à la rigueur, leur lieu de vacances. C’est un mode de vie ordinaire chez les dirigeants - que le designer Philippe Starck pousse jusqu’à l’absurde : « Je cumule souvent deux cheminées dans chaque chambre de mes vingt et une maisons. Pour aller d’un endroit à un autre, on a un avion dans lequel on habite. Nos vingt-sept motos sont réparties dans le monde, le même modèle, la même couleur, avec la même clé. On peut aussi en embarquer deux dans l’avion. »
Comment s’étonner, dès lors, que le moindre volcan qui fume au-dessus de l’Europe, ou des pistes d’aéroport bloquées par la neige, ou un Eurostar en retard sous le Channel, fassent aussitôt la Une des radios et télés ? Que les médias, les ministres, jusqu’à la Commission européenne, en soient scandalisés, commandent des rapports, réclament des sanctions – bien plus que, par exemple, les 190 000 foyers qui, en 2010, se sont fait couper le gaz et se chauffent à la bougie ? C’est qu’ici, on attente à une valeur clé de l’oligarchie : le déplacement. Le bougisme – qu’ils nous instillent. Rester mobile, sans obstacle, sans frontière : voilà qui devrait être ajouté à la Déclaration des Droits de l’Homme Blanc…
« Et depuis quand vous êtes installés à Megève ?
-Depuis l’époque où François Mitterrand est arrivé au pouvoir : y avait un grand down-turn dans l’immobilier en France, en particulier dans les endroits comme ici. On a acheté ce chalet magnifique, avec beaucoup de salles de bain, une piscine. Mais la station, elle, déclinait un peu. Ensuite, dans les années 90, nous avons participé au renouveau de Megève avec le polo, les calèches, les sculptures… Yes ? » Il décroche son téléphone : « Oui, j’arrive… Je suis en train de finir mon interview… » Il raccroche, remet son manteau : « Je vais y aller parce que mon équipe va bientôt jouer… » Dans sa poche, il cherche un portefeuille.
« Laissez, je vais régler.
- Très bien. » Il me salue. « Au revoir. »
Ce serait tellement plus simple s’ils se montraient méchants, hargneux, arrogants. Ils répondraient à nos stéréotypes, et on les détesterait d’emblée.
Mais là, non. Juste une pointe de sécheresse.
Je retourne l’addition : pffff.
Vu les tarifs, je vide entièrement ma théière. Je lape ma tasse jusqu’aux dernières gouttes, en relisant mes notes : « les calèches », « l’avion », « l’authentique », je suis déçu. Pas de grande révélation, non. Mais qu’attendrait-on ? Même en entrant dans le carré VIP, même en assistant à leurs dîners privés, même dans leurs chambres à coucher, pas sûr que j’obtienne de grandes confessions. Lève-t-on un coin du voile, au moins, avec ces discussions ? A peine. Au contraire, même.
Oui, au contraire !
Une intuition perce en moi, en cet instant : je venais ici pour découvrir comme un secret, pour résoudre « Le Mystère des Nantis », pour affronter de près le visage hideux de l’Exploitation. Mais c’est l’inverse, justement, qui se passe : à approcher les riches, surtout durant leurs loisirs, on ne comprend rien de leur enrichissement. Megève fonctionne comme un masque, comme un voile pudique posé sur leur extorsion. Et c’est tout l’intérêt, alors : cette ville offre un négatif de la vie qu’ils imposent aux autres, ailleurs.
...et son envers
Derrière le décor, maintenant, se cachent pollution et exploitation. Les deux mamelles de leurs fortunes. _
C’est-à-dire ?
Leurs chalets sont nichés dans un repli de la montagne, avec vue sur ce paysage escarpé, un silence troublé par le « floc… floc… floc… » de la neige qui fond aux fenêtres : un grand bol d’air frais, du « 100 % naturel » comme ils disent. Mais quel monde construisent-ils, sinon, pour se rendre au plus vite de Paris à Tokyo, de Madrid à Nairobi ? Il faut des aéroports, des lignes à grande vitesse pour cette clientèle pressée et prisée : « Jets privés : ne vous en privez plus ! » titre Le Figaro. « Les very light jets se vendent par centaines », « les villes françaises déroulent de plus en plus le tapis rouge aux avions privés », « l’hélicoptère est devenu le complément de l’avion d’affaires et même du TGV grâce au projet d’implantation d’une hélisurface près de chaque gare », etc. Et surtout, des autoroutes.
Des autoroutes partout, les « 12 000 kilomètres de voies rapides » réclamés par le patronat européen (voir Fakir n°40), et vite accordés par la Commission, plus des trous dans les Pyrénées, dans les Alpes, sous la Manche. Et pourquoi déverser tout ce béton ? Pas pour le rapprochement entre les peuples, non. Pour que les industriels, les grands distributeurs, fassent produire leurs marchandises plus loin, moins cher, dans les « PMO » comme ils disent, les « Pays à bas coût de Main d’Œuvre », et ramènent ces chargements dare-dare vers les marchés de consommation. Leurs profits naissent de là, de ce défilé de camions.
Dans nos campagnes, après ça, autour de nos cités, allez admirer le paysage, écouter le chant du vent, respirer un grand bol d’air pur : des tranchées bétonnées déchirent tout le pays. Tout le pays ? Non : un petit bourg des Alpes résiste... Et qui y voit de l’ironie ? Les Mulliez résident ici, les Dentressangle également – eux dont les poids lourds sillonnent l’Europe. Sans aucun risque qu’une autoroute ne passe sous leurs fenêtres…
Voilà pour l’écologie.
Mais le social, également, doit se lire à rebours. Que de courtoisie, ici ! C’est un univers sans saillance, tout douillet, comme si nous étions entourés de coton, avec des voix douces, une ambiance douce, une musique douce, des visage doux, rien qui accroche, tout glisse, tout lisse. Tandis qu’au dehors, ils bâtissent un monde de violence.
La semaine dernière, dans un foyer d’urgence à Bourg-en-Bresse, je rencontrais un routier international : « Il me reste plus que ça, me montrait-il dans sa chambrette : une commode et de l’informatique… Je faisais l’Espagne, l’Allemagne, les pays de l’est. Je dormais très peu, du lundi au dimanche. Dès que c’était férié dans un pays, je passais dans un autre. J’ai jonglé comme ça durant des années. Le patron me réclamait ça, sinon “les étrangers étaient plus rentables” il me prévenait… Et puis, avec la fatigue, j’ai déprimé… des hallucinations sont venues… Je conduisais dix minutes et je stoppais net : j’avais l’impression qu’un monstre était monté dans ma cabine… J’ai fait arrêt maladie sur arrêt maladie, et maintenant j’ai tout perdu. » Ces dernières années, Norbert-Dentressangle fait pression, avec succès, auprès des gouvernements, auprès de l’Europe, pour accroître le tonnage des camions, les horaires de travail, leur flexibilité. Et il écrème ses routiers nationaux, leur préfère des slaves moins coûteux, ou des auto-entrepreneurs qui s’auto-exploitent. Et qui, pour certains, s’auto-suicident : deux la même semaine…
« On peut l’enlever, ce bazar à la con. On peut même le jeter au feu… »
Nous voici dans le Nord, désormais, près de Roubaix, au centre de l’empire Mulliez. Un conflit s’achève chez les Pimkie : les filles de l’atelier démontent la tente, le brasero s’éteint, et de dépit, Mado y jette le badge qu’elle portait sur sa poitrine. « Y avait Gérard sur un tas d’or… et c’était inscrit : “Les Mulliez doivent casquer”. Mais ils ne vont pas casquer, ils ont encore gagné. On n’a pas un jour de grève de payé. Sur les 190 licenciements, y aura pas un reclassement. » C’est la peur qui se lit, ici, la peur du lendemain, pour soi, pour ses enfants.
D’après un expert, le taux de profit, chez Pimkie, voisinait les 20 %. Chaque employée versait, chaque année, l’équivalent de 7 600 € en dividendes aux actionnaires Mulliez, plus de sept mois de salaire net. Encore insuffisant : déplacée en Pologne, la logistique reviendra moins cher. Et à aucune de ces petites mains, ce fort chrétien patron n’a offert de place comme vendeuse, dans les Boulanger, Gémo, Décathlon, Auchan, du centre commercial de Tourcoing, juste à côté. Où une caissière témoigne à son tour : « Pendant sept ans, ils nous ont payés en dessous du SMIC. On avait beau accepter les temps partiels, les coupures le midi, ça ne suffisait pas : il fallait encore que, sournoisement, ils rognent sur notre paie. La CFDT a fini par s’en apercevoir, mais on a perdu toutes ces années. »
Megève, maintenant. Autour de moi, dans cette salle, par la vitrine, nul reflet de cette peur, de ces combines, de ces conflits. Ils sont brutaux, quotidiennement. Impitoyables, indirectement. Mais ce lieu est fait, justement, pour dénier cette violence. Pour cacher leur tyrannie. Pour purifier leurs fortunes. Pour leur laisser l’âme tranquille, avec au cœur la certitude d’un monde apaisé.
Ça fait penser aux portraits que publient d’eux la presse – ou aux livres à leur propre gloire. Les nababs ne se montrent plus, sérieux, derrière leur bureau, ou devant un paperboard, préparant une OPA, fermant un site, encaissant leurs stock-options. Non, Jean-Marie Messier s’affiche un sandwich à la main et un trou à la chaussette – et dans les premières lignes de son autobiographie, Mon vrai journal, il caresse un loup au fin fond du Canada… Quel romantique ! Et le banquier allemand Rainer Engelke, le voilà qui s’exhibe, pour Le Monde 2, dans sa position habituelle : allongé dans la paille… Et de quoi parle Bernard Arnault, dès les premières lignes de sa « Passion créative » ? De musique ! « Quand je joue du piano, ma femme trouve toujours mes tempi trop rapides. » Et la quatrième de couverture dévoilait toutes les qualités de ce « personnage captivant » : « pianiste, il a joué avec Seiji Ozawa à Tokyo ; mécène, il aide des causes humanitaires ; amateur d’art, il vient de racheter l’enseigne de vente aux enchères Phillips. » Quant à Daniel Bernard, l’ex-PDG de Carrefour, « débarqué » avec 38 millions d’€ d’indemnités, désormais conseiller chez Mc Kinsey, vice-président de Kingfisher le n°3 mondial du bricolage, siégeant au conseil d’administration de Cap Gémini, dirigeant sa société d’investissement Provestis, consultant pour le gouvernement chinois, etc., c’est en vérité un homme d’esprit qui nourrit bien des « rêves » : « Comme celui d’écrire un ouvrage sur Wagner et Eschyle afin de comparer les dramaturgies nordiques et grecques. Ou encore, dénicher une forêt sans château. Mais le comble du luxe serait d’arriver à créer un jardin qui donnerait des fleurs toute l’année... » Ainsi relèguent-ils à l’arrière-plan leur richesse, presque secondaire, anecdotique - que l’on oublie la cruauté de cette appropriation, que l’on oublie Marie, par exemple, caissière à Carrefour, en temps partiel contraint, 30 heures pour « 837 euros et 63 centimes », à qui on offre une boîte de chocolat à 2,50 € en guise de treizième mois, au moment où l’ancien PDG (wagnérien fleuriste) ramassait le pactole. Le temps d’une photo, le carnassier se déguise ainsi en bohème.
Megève remplit la même fonction : cette station, c’est l’image qu’ils veulent se donner d’eux-mêmes. Et ils y croient. En toute bonne foi : à Paris, on aperçoit la tour Eiffel de partout – sauf, justement, perché sur la tour Eiffel. De même, ici, on n’aperçoit rien de l’Exploitation : on est assis le cul dessus.
Le supplément d’art
Dans l’oligarchie comme ailleurs, Dieu est mort. Tant bien que mal, l’art le remplace alors : voilà la nouvelle passerelle vers un ordre supérieur, spirituel. Qui nettoie des péchés de l’argent.
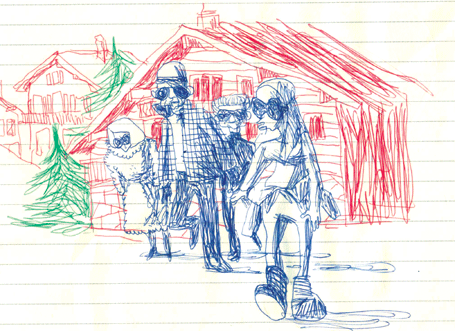
« Là, vous avez une planche à repasser, un objet qu’on met d’habitude dans un placard… mais aujourd’hui, je l’expose. Donc c’est une transgression sociale. » Ce soir, c’est le vernissage de l’exposition « Blanc comme neige » à la Ipso Facto Gallery, avec champagne, petits fours et artistes « transgressifs » à volonté. Moins que le mois dernier, néanmoins : « Le 17 décembre, c’était l’inauguration de la galerie. Y avait tout Canal + ce soir-là, on a fait une super-fête. »
La vitrine affiche des tableaux à 18 000 € (« abordable », donc…). Mais Chrystele ne s’est pas installée ici pour le fric, mais pour l’Éducation du Peuple : « On a l’intention de faire un peu bouger la station en terme d’art, d’éduquer les gens dans le regard, m’éclaire-t-elle. On avait notamment une pièce, des toilettes coupées en deux avec de la presse au milieu et les gens d’ici, ça les a énormément choqués. » Mais ça ne la décourage pas, au contraire, ce « choc » : c’est qu’elle est sur le bon chemin. « On a un rôle pédagogique par rapport aux locaux. Les touristes, italiens, arabes, russes, hollandais, qui viennent en vacances, ils ont l’habitude de voir des galeries d’art partout dans le monde, donc ils ne sont pas surpris. Mais les locaux… »
Les Mégevans sont restés des paysans, vite enrichis – qui font passer leur estomac avant leur âme : « On a eu un ennui : on a pris la place d’une boucherie, qui est partie, et c’était la seule boucherie dans le centre du village. Donc, on a eu un accueil un petit peu froid… » Les commerces de proximité sont remplacés par des antiquaires, des magasins de déco, des bijouteries. Et les « locaux » préfèrent un bon bifteck à un « bleu » d’Yves Klein…
« La plupart de ces oeuvres, je les aime tant, quand elles ne sont pas vendues, je les conserve.
-Mais ça doit vous coûter cher, non ? » je m’exclame bêtement. Le propos est malvenu, et Chrystele – qui a épousé le proprio des « Fermes de Marie », le mécène du lieu – montre de la gêne : « On n’a pas 50 passions dans sa vie. Moi c’est la mienne, je pense que ça vaut la peine. »
Au milieu des coupes qui s’entrechoquent, des rires qui éclatent, Olivier livre sa « part de vérité » : « L’inspiration, c’est vouloir exprimer une grande joie, une explosion d’insouciance, une libération, une rupture avec les entraves, c’est “nique le quotidien”. Et en fait Alzheimer, le nom que j’ai donné à cette oeuvre, à un moment, on peut dire “merde” aux gens qu’on connaît très bien. Au fond notre vie c’est Alzheimer, on est complètement incohérents. La liberté est une pesanteur. »
Je peine à retrouver mes idées dans ces fulgurances.
« Mais enfin, ton Alzheimer, il coûte quand même 40 000 €… A ce tarif-là, moi aussi, je peux avoir une grande joie et niquer le quotidien…
-L’argent, je ne sais jamais quoi en faire. C’est une vraie difficulté. »
Lui si loquace se tait. Son visage grimace, il hésite.
« Et être exposé à Megève ?
-Cette histoire de classes sociales, qu’est-ce que ça change ? » Ça change ça, peut-être : quelle « part de vérité » aperçoit-on, vu d’ici ? Il faudrait un peintre d’une autre trempe, je songe alors, il faudrait une fresque géante pour illustrer ça : ces euros arrachés avec des lanières de cuir aux mains des tisserands du Bengladesh, et qui ruissellent vers l’Europe, vers ces sommets, et qui se transforment en chalets, en sculptures, en champagne, en pitreries, en un faste même pas joyeux, en une opulence ennuyée.
« Le blanc est une couleur, indique un panneau, dans un coin. Utilisée dans la symbolique occidentale depuis la nuit des temps pour, à la fois, la pureté, l’innocence, l’éternité, la paix, il en est devenu un code universel. »
Comment traduire, ou trahir, plus clairement le rôle de l’art, ici, aujourd’hui ? Auparavant, c’est l’Église qui aidait les riches à se laver de leurs péchés, qui leur apportait une conscience tranquille – contre la menue monnaie des « indulgences ». Mais dans l’oligarchie comme ailleurs, Dieu est mort. Tant bien que mal, l’art le remplace alors : voilà la nouvelle passerelle vers un ordre supérieur, spirituel. Le passe VIP pour un au-delà, sinon éthique, du moins esthétique. Le supplément d’âme garanti. L’élévation, au-dessus de l’argent, de la matière, des basses œuvres – comme un anoblissement. Et quel lapsus, non, que cette galerie d’avant-garde, à Megève, dans cette place forte de la bourgeoisie, choisisse « Blanc comme neige » pour thème de sa première exposition ? Ce symbole de « pureté », d’ « innocence » - que les possédants se paieront contre un gros chèque…
Cette fonction de l’art m’a frappé, un matin.
Je me souviens.
En 2006.
J’étais actionnaire de LVMH, le premier groupe de luxe mondial, dirigé par Bernard Arnault (qui, lui, préfère Courchevel). Toute sa fortune, il faut le rappeler, il faut sans cesse le rappeler, s’est bâtie sur un mensonge. En décembre 1984, il s’engageait à sauver l’empire Boussac-Saint Frères, au bord de la faillite : « Le souci du plan Férinel est de maintenir l’emploi », garantissait-il dans un document adressé à l’Etat. Et devant un syndicaliste, il posait la main sur le coeur : « Vous pouvez avoir confiance en moi, Monsieur Deroo. Je vais garder le textile. » Mais ces belles promesses ne passeront pas l’hiver. Tout fut dégagé. Sauf Dior. Une « pépite endormie ».
De cette époque, Lounis – fils d’ « un Saint-Frères » – a conservé un souvenir cuisant : « L’usine a fermé, et on a couru à la mairie pour des bons d’alimentation. Il fallait quémander quasiment, s’agenouiller devant les secrétaires, fournir des justificatifs et des justifications, elles en redemandaient, refaire la queue… Toutes ces vexations pour 50, 100, 200 F. Les Restaurants du Cœur, tout le monde a vécu ça, sa file honteuse, ses plateaux-repas. Ça me révoltait : tant de sacrifices, déjà, et mon père qui doit sacrifier sa dignité aussi. »
Le facteur est passé.
Une enveloppe a rebondi sur le carrelage.
A l’intérieur, sur papier glacé, Apartés, le magazine du « club des actionnaires LVMH ». Avec quoi à sa Une ? Pas l’affaire Boussac-Saint Frères, évidemment. Pas même notre dividende en hausse. Non : « Yves Klein. Corps, couleur, immatériel. » Et Bernard Arnault éditorialisait, en page 2 : « Avec le Centre Pompidou, LVMH rend hommage, cet automne, à la vision d’un artiste total, moderne, contemporain, Yves Klein, dont l’œuvre d’une densité quasi spirituelle suscitera certainement l’émotion et la communion d’un très large public. »
En mai 2007, l’usine ECCE de Poix-du-Nord allait fermer ses portes. On y produisait les costumes Kenzo - qui revenaient à 80 € en sortie d’usine, tout compris, matière première et main d’œuvre. Et qui étaient revendues 990 € dans les magasins parisiens : voilà qui laissait une marge appréciable… mais encore insuffisante. Car les dirigeants de LVMH avaient calculé ça : en déplaçant la confection en Pologne, on passerait de 80 € à 40 €. Restait donc à « mettre en œuvre la solution industrielle ». Avec Marie-Hélène Bourlard, la déléguée CGT, nous sommes alors intervenus en Assemblée Générale : « Y a les 147 salariés qui sont là, lançait-elle au PDG, j’aimerais que vous les voyiez, que vous osiez les voir, là, dehors, en face, et leur dire : “Je ne veux plus travailler avec vous.” » Bernard Arnault ne renonça pas : « Je suis désolé des problèmes que ça peut poser aux personnes, mais le problème de fond, c’est la différence de coût de revient, pour un certain nombre de métiers, dont la confection, entre la France et nos voisins de l’Europe. »
Quelques semaines plus tard, le facteur est passé.
Une enveloppe a rebondi sur le carrelage.
A l’intérieur, sur papier glacé, Apartés, le magazine du « club des actionnaires LVMH ». Avec quoi à sa Une ? Pas la fermeture de Poix-du-Nord, on s’en doute. Plutôt : « L’atelier d’Alberto Giacometti ». Et Bernard Arnault éditorialisait en page 2 : « Cet automne, au Centre Pompidou, LVMH est heureux de contribuer à la révélation du monde secret de Giacometti, artiste majeur d’une force quasi spirituelle, ce qui ne manquera pas de susciter émotion et dialogue avec le plus large public. »
Les ramasse-miettes
Derrière les nantis, y a de la concurrence pour arracher des euros. Des serviteurs pas malheureux, non : ils ont trouvé une « place », au bon endroit, assez près des riches pour ramasser les miettes du gâteau, les éclats de leur gloire.
« Mais qu’est-ce qui fait, lui, avec son sac à dos ? Oh ça va pas lui ! Ça va pas, non, il prend des photos ! J’ai l’exclusivité ici ! On va voir le directeur… »
On s’est tapé l’incruste à une soirée privée, au Palo Alto, la boîte branchée de Megève. Novice dans la haute, un peu isolé, on suit Philippe - le « photographe officiel » du lieu. Lui sourit, remet sa carte aux invités, courtoise onctueusement. Jusqu’à repérer un concurrent dans le noir là-bas, un autre « filmeur », mais officieux, pas attitré, avec une tronche de « Chinetoque », et Philippe appelle le videur, et il appelle le directeur, pour que l’intrus dégage :
« Putain, ils font pas leur boulot, les videurs ! Ils vont se faire virer ! Ce mec-là se fait passer pour un photographe de presse…
- Une dame m’a dit : “toi peux venir”, rétorque l’autre artiste.
-Te fous pas de ma gueule : toi Chinois, mais toi comprendre français. Et tu connais la règle : c’est ma place ici. Si tu veux venir, c’est sans l’appareil. Dépêche-toi de ranger, moi j’ai un timing là. (Se tournant vers moi, il ironise :) On est un peu comme des chiens, on pisse autour de son territoire. » Oui, comme des toutous qui se disputent leur bout de riches.
Y en a plein les rues, ici, plein le tournoi de polo, au bas des pistes, de ces « filmeurs » : « On mitraille comme des paparazzi », reconnaît Samsaï – le “Chinois”. Toutes les gonzesses y passent, elles sourient devant l’objectif, les petites filles surtout – dans l’espoir qu’elles achèteront le cliché, une fois développé. Philippe, lui, ne fait pas le trottoir : il a ses entrées. Dans les night-clubs, dans les restaus aussi. Et il m’emmène avec lui dans sa tournée.
Le plein de gloire
Devant « Chez Nano », un jeune gars se les gèle dans son anorak. Il vient du Nord, ça nous rapproche. Il exerce comme « voiturier » - il m’explique. Il a de l’ambition : « Hors saison, je voudrais m’associer avec la Maison du Caviar, à Paris, mais les places s’achètent. » Je l’accompagne sur le parking : il passe d’une BMW à une Safrane pour faire tourner les moteurs, pour dégivrer les vitres, pour réchauffer les intérieurs…
« Comme ça, je l’interroge, quand ils remontent dans leur caisse, ils n’attrapent pas de rhume.
-Voilà. »
Il est fier de son boulot, du moins il paraît : « J’ai conduit la voiture d’Alain Prost…
-Chapeau.
-De Simeone aussi…
-Ah ouais… (Après réflexion :) C’est qui, en fait ?
-Celle qui présentait la météo sur Canal +.
-Waouh, la vache. _ -J’ai vu Dany Boon, au refuge Le Délire… »
Le casting de rêve ne s’arrêterait pas là, sans doute, mais son talkie-walkie grésille : « 59… 59…
-OK, c’est parti », répond le groom. Il replace le bonnet sur son crâne, et saute dans un 4*4 Mitsubishi.

Valet version Borloo
Philippe reprend la route pour le prochain trois étoiles, à l’écart du bourg.
Sous les feux des phares, dans la montagne, des ombres s’activent dans des tenues de cosmonaute. À la lueur des camions, ces hommes déchargent de la neige artificielle, dament les pistes à coups de pelles – pour que les riches skient heureux, demain, « malgré les températures très élevées ».
Dans cet univers, je songe, y a pas de classe moyenne (je préfère : « intermédiaire »). Juste les maîtres et des serviteurs. Entre ces deux extrêmes, rien. Rien au milieu. Et le plus gênant, évidemment, pour nous, le plus navrant, le plus mystérieux, c’est cette acceptation chez ces domestiques domestiqués – lorsqu’on souhaiterait de la révolte. Pire : cette joie de servir.
Eux ne sont pas malheureux, non : ils ont trouvé une « place », au bon endroit, assez près des riches pour ramasser les miettes du gâteau, les éclats de leur gloire. Et ils annoncent ce monde où il faudra servir ou croupir, le larbinat comme promotion : tous laquais, tous morpions, tous dans les « services à la personne » - version euphémisée, encouragée, défiscalisée, borlooisée du valet.
Le majordome du château
Enfin, « la joie de servir », pas partout.
Pas au « Chalet des neiges d’antan » (nom modifié).
Je m’y suis rendu, le lendemain, pour une visite. Ses tarifs m’avaient intéressé : pourquoi pas offrir ce petit plaisir à la famille pour les prochaines vacances, ou le départ en retraite de mon père ? 30 000 € la semaine, ça restait abordable…
« Tout n’est pas compris, prévient d’emblée Jérôme. En sus, vous comptez l’alimentation, les boissons, la cave des vins, avec la bouteille de Mouton Rotschild à 1400 € en cas de soif… Je vais vous demander d’enlever vos chaussures. » Il ouvre la « salle de massage » avec « intervenant extérieur sur demande : ça c’est dans les extras. »
« Moi, je suis là, à votre service, quasiment 24 heures sur 24. Une ampoule de grillée, vous m’appelez. Je vérifie le pH de la piscine, l’eau à 29 °, le jacuzzi à 36, je mets vos bottes à chauffer. Vous voulez du homard ? Je ferai 20, 30 kilomètres, mais j’irai le chercher. La dernière fois, un Américain, en pleine nuit, il réclamait des pistaches, je me suis débrouillé… »
Sous l’escalier, il indique « l’ascenseur tout boisé : les clients s’en servent facilement, même pour un étage. » La chambre des adultes, maintenant, avec « un écran plat un peu plus grand que dans les autres pièces » – toutes ont la télé.
« Ils ont des manies, aussi, je m’adapte : une grand-mère espagnole, son thé de cinq heures, c’est pire que la messe : faut faire chauffer de l’eau, refaire bouillir l’eau, un truc de fou, ça dure jusqu’à six heures. Un gamin, à quinze ans, il fumait des cigares comme des barreaux de chaise, et il buvait le champagne à la paille dans le hammam.
-Mais ils sont sympas, quand même ?
-Jamais. T’existes pas, pour eux. T’es transparent, ils me claquent du doigt, bientôt ils me siffleront. Des journées entières tu te décarcasses, pour la cuisine, pour un tour en montgolfière, pour louer un hélicoptère, tout, et ils partent sans un merci, sans un “au revoir”, sans connaître ton prénom.
-Mais t’es bien payé, au moins ?
-Même pas. 1300 € par mois, le SMIC hôtelier. Le seul avantage, c’est que je suis hébergé gratuit.
-Tu peux presque te payer une bouteille…
-Ouais. Mais mon patron, il m’engueule quand j’allume le feu avec trois brindilles : soi-disant que je gaspille…
-Il doit y avoir des jolies nanas, alors…
-Je suis homo. Mais non, y a pas de quoi se rincer l’œil…
-Je pensais que les riches étaient beaux…
-Ah non, pas sur mon échantillon. L’été, je travaille dans un village naturiste au Cap d’Agde. Là-bas, c’est une autre ambiance. Tout le monde est un peu chaud bouillant, et comme je pratique l’échangisme... Ici, c’est coincé. Faut pas faire un bruit, rester invisible. »
La visite s’achève par le garage, où des quads promettent une balade pétaradante.
« Bref, conclut Jérôme, je suis le majordome du château. »
De lui-même, avec ironie, il se réfère au XIXème siècle, à l’Ancien Régime.À un passé qui, si nous ne luttons pas, pourrait bien se conjuguer au futur.

Je retourne ma veste
« On a des prix modestes, pour toutes les bourses : 800 €, 1000 €, pour une veste. » La Maison Allard pratique un « luxe abordable » : « Jusqu’à ce pull, évidemment, c’est la Rolls : il vaut 1300 €. Mais vous avez la garantie d’être original : on ne veut pas que tout Megève soit avec le même pull, donc on fait des séries de vingt maximum. Si jamais vous retourniez en Australie, et que vous découvrez le même pull, vous ne seriez pas contents… » Le patron avance dans sa boutique, et m’étale cette trouvaille, « le col de vison amovible » : « Si jamais vous êtes à Megève, vous mettez le col vison. Lorsque vous revenez à Paris, vous l’enlevez… Touchez un peu ici, c’est de l’orilag, un croisement de lapin et de chinchilla… Vous avez vu comme c’est doux, il y a 11 000 poils au cm2, et là encore le col est amovible. » Et dans ses rayons, ça n’est pas sa seule tenue « amphibie » : « À Megève, évidemment, vous voyez beaucoup de manteaux de fourrure. Ici, vous le montrez, vous le mettez à l’extérieur. Mais quand vous rentrez, que vous présidez un conseil d’administration, vous laissez le luxe à l’intérieur. Comme ça, vous savez que vous avez du luxe sur vous, un vison rasé blanc, blanc cassé, qui est magnifique, mais il ne faut pas montrer trop le luxe, si vous voulez, il ne faut pas provoquer. C’est ça, la philosophie Megève : on a des gens riches mais qui ne l’affiche pas. -Mais les poches, quand vous retournez votre veste, vous n’avez pas les poches qui pendent à l’extérieur ? -Non non non, tout est réversible. »
À grands gestes, et à l’anglais approximatif, un client russe réclame un manteau en peau de loup. Mon hôte s’éloigne, puis revient avec « une écharpe en cadeau ». Quand je reviendrai à Megève, je mettrai l’étiquette Allard bien en évidence. Mais je la planquerai soigneusement sur les Zones industrielles en Picardie…
« Oligarchie », le mot revient à la mode. Voilà vingt ans, pourtant, qu’elle a pris ses aises. À Megève comme ailleurs, « dans les années 90 ». De quoi en faire une rapide histoire, au doigt mouillé.
Avant d’écrire ce papier, je réécoute les bandes.
Je transcris des passages.
Je m’arrête sur une phrase de Philippe Charriol : « Dans les années 90, nous avons participé au renouveau de Megève avec le polo, les calèches, les sculptures… »
Ça me fait tilt.
La petite histoire, discrètement, rencontre ici la grande.
Deux livres viennent de paraître, dernièrement : Le Président des riches, sous-titré « Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy », de Michel et Monique Pinçon-Charlot (La Découverte). Et L’Oligarchie ça suffit, vive la démocratie, de Hervé Kempf (Seuil). Je les ai lus dans la même semaine, et la présence de ce mot, « Oligarchie », sur les deux couvertures, m’a intrigué.
J’ai appelé la sociologue Monique Pinçon-Charlot :
« C’est la première fois que vous parlez d’oligarchie ?
-C’est vrai, jusqu’ici on ne l’utilisait pas tellement. D’habitude, on disait “haute bourgeoisie”, “classe dominante”, “beaux quartiers”, en variant pour ne pas trop se répéter. Ce qui se passe, en ce moment, c’est la rencontre heureuse entre un vocabulaire marxiste et l’intuition des citoyens. Les gens se sentent violentés, et comme chez un thérapeute, on vient mettre ça en mots.
-Mais y a une différence entre “haute bourgeoisie” et “oligarchie”. On n’est plus seulement dans la domination sociale, ça devient un système, qui suppose une emprise politique presque totale.
-Tout à fait.
-Quand est-ce que vous est venu à l’esprit, puis sous la plume, ce mot “Oligarchie” ? _ -À la fin des années 90, c’était pas tellement dicible, ni audible, parce qu’on avait un gouvernement soi-disant “de gauche”. On a commencé à prendre des notes à partir de Raffarin, de 2002. Mais l’histoire s’est accélérée, évidemment, avec Nicolas Sarkozy : il a rendu l’oligarchie visible. Il vend la mèche tout le temps. Soit c’est son frère, son ami, son pote, à qui il confie des bouts de la Sécu, une régie publicitaire, EDF, etc. Ça devenait flagrant. _ -Il me semble, mais dites-moi si je me trompe, une autre étape, dans la découverte de cette oligarchie, c’est le référendum de 2005. Tous les grands médias, tous les grands partis, tous les grands patrons font campagne pour le oui. Le peuple vote non. Et c’est pourtant le oui qui est validé. Ça prouvait bien qu’il existe des convergences d’intérêts supérieures à la démocratie…
-C’est extrêmement juste. D’ailleurs, on revient toujours à ce référendum. C’est rare, un pareil vote de classe, avec les ouvriers, les chômeurs, les employés contre. Et derrière, une trahison du Parti socialiste – dont tous les candidats supposés à la présidentielle, au passage, étaient partisans du oui… _ -Ça, c’est la prise de conscience de l’oligarchie. Mais quand est-ce qu’elle s’est constituée, cette oligarchie ? _ -Eh bien… » Elle hésite, passe de « la chute du mur de Berlin, en 1989 » à « la prise de contrôle du MEDEF par le baron Ernest-Antoine Seillière de la Borde, en 1997, présenté comme un “tueur”, le retour des maître de forges. » En gros, donc, « dans les années 90 ».

Il faudrait écrire, sérieusement, tranquillement, une Histoire de l’oligarchie, de son « renouveau ». Au doigt mouillé, je vais l’ébaucher à grands traits.
Années 85-95 : le basculement
L’argent, d’abord, nerf de leur guerre. Entre 1983 et 1989, après une décennie 70 sur la défensive, le Capital a reconstitué ses forces. Les taux de profits atteignent des sommets. La part des dividendes, comparé à la masse salariale, triple rapidement. On en a fini avec les « conquêtes sociales » en série (SMIC, allocations chômage, retraites à 60 ans, etc.) qui grèvent les bénéfices – tandis qu’à l’inverse, les facilités fiscales se multiplient.
La quiétude politique, aussi. Quelques temps plus tôt, François Mitterrand menaçait encore « les maîtres de l’argent, l’argent, l’argent, les nouveaux seigneurs, les maîtres de l’armement, les maîtres de l’ordinateur, les maîtres du produit pharmaceutique, les maîtres de l’électricité, les maîtres du fer et de l’acier, les maîtres du sol et du sous-sol, les maîtres de l’espace, les maîtres de l’information, les maîtres des ondes. Nous ne ferons pas payer cher le malheur de tant de siècles. Mais pour l’argent, l’argent, toujours l’argent, alors c’est vrai : il ne faut pas trop qu’ils y comptent. » Le même, à l’Élysée, prône désormais une « paix des classes » : plus aucun renversement n’est inscrit à l’ordre du jour, plus aucune force – parti, syndicat – n’est à même de le porter.
L’élite de l’État, ensuite, se convertit au business. Des pans entiers de l’économie glissent entre les mains d’une coterie : Saint-Gobain, Paribas, Alcatel-Alstom, la Société générale, Matra, Suez dès le gouvernement Chirac (1986-88). Le reste des bijoux de la nation suivra (Elf-Aquitaine, Renault, Péchiney, Airbus, etc.). Avec ces privatisations, on n’offre pas seulement de nouvelles cagnottes : voici que les Inspecteurs des Finances eux-mêmes passent au privé avec la caisse – et la vident, à l’instar de Jean-Marie Messier (Vivendi), Philippe Jaffré (Elf), Michel Bon (France Télécom), Pierre Bilger (Alstom), Jean-Charles Naouri (Moulinex). En retour, plus tard, les dirigeants du CAC 40 géreront directement leurs affaires, deviendront ministres de l’Économie : Francis Mer (Usinor) et Thierry Breton (France Télécom). S’opère une union, au sommet, entre les hauts fonctionnaires et les grands patrons - deux élites qui, auparavant, se fréquentaient bien sûr, mais qui désormais fusionnent. L’oligarchie politico-économique ne fait plus qu’une.
Et médiatique : en 1987, l’État confie TF1 à Francis Bouygues. La Générale des eaux, alias Vivendi, récolte Canal +, et la Lyonnaise des eaux M6. Les radios commerciales colonisent la bande FM. Jean-Luc Lagardère s’approprie Europe 1 – et se partage magazines et journaux avec l’autre marchand de canons, Serge Dassault : à l’un Le Monde, à l’autre Le Figaro. Bref, les idées qui se fraieront un chemin jusqu’aux masses seront bien triées, filtrées, tamisées, avec juste la dose d’insolence qu’il faut. Sans compter que l’étoile rouge a pâli, qu’elle ne fait plus envie.
Cette oligarchie nationale, enfin, s’est adossée, solidement, à une oligarchie mondiale. Sous la houlette du (si peu) socialiste Jacques Delors, guidé par le patronat européen (voir Fakir n°40), l’Europe de la libre concurrence se bâtit par-dessus les peuples : grand marché, monnaie unique, critères de convergence… Ces caps fixés, voilà qui limite, voire interdit, les soubresauts nationaux : « Les entreprises, surtout internationales, se félicite Bernard Arnault, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis, en Europe, la capacité de jouer la concurrence entre les Etats. (…) L’impact réel des hommes politiques sur la vie économique d’un pays est de plus en plus limité. » Et de conclure lui-même : « Heureusement. » Tous ces organismes internationaux, CEE, FMI, OMC, tempèrent, ou annulent, les crises de la populace – désormais résignée.
Assurée de son hégémonie, voire d’une « fin de l’histoire » tout à son avantage, l’oligarchie peut jouir sans entraves.
Années 95 - 2005 : la jouissance
En 1997, la société informatique Cap Gémini et la banque d’affaires Merrill Lynch publient le premier World Wealth Report - « Rapport sur la richesse mondiale ». D’année en année, ces documents se succèdent, avec un constat qui varie peu : « une augmentation du nombre d’individus à très hauts revenus – High Net Worth Individuals (HNWIs) – autour du globe et une augmentation de la valeur de leur patrimoine », « 9,5 millions de personnes possèdent un patrimoine supérieur à 1 million de dollars, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2005 », « la population des individus à très hauts revenus a crû de 17,1 % pour atteindre les 10 millions de personnes en 2009 », etc. Si, une nouveauté : en 2003, sont inventés les « Ultra-HNWIs » - les ultra-hyper-friqués, « ceux dont le patrimoine est supérieur à 30 millions de dollars » - et dont la « fortune croît », on s’en doute, « plus vite encore » que celle des « HNWIs ».
C’est le temps – toujours pas achevé – des parachutes dorés.
Des stock options.
Des golden boys.
Où, comme l’écrit Newsweek, « les vraiment riches se mettent à l’écart des simples millionnaires, derrière des portes fermées ».
Bref, la prospérité est en au rendez-vous. Et comme aucun péril ne menace, on peut l’afficher sans complexe : « Grande plaisance : la course au luxe », titrent ainsi Les Échos. « J’ai l’habitude de dire : au-dessus de 50 m, c’est un million de dollars du mètre, évalue Vincent Laroque, le « production manager » (ça veut dire « directeur ») de Monaco Marine Group. Donc 50 m, ça fait 50 millions de dollars. Après, ça dépend de l’équipement. L’été dernier, par exemple, on a reçu Octopus, qui est un 126 m. Eh bien dedans, vous avez un sous-marin, un hélicoptère, c’est bourré de jouets… C’est une période faste qui dure. On était à 5000 yachts dans les années 2000-2002, et on doublera en 2010. En sept ou huit ans, on aura doublé. »
Voilà qui vaut pour les bateaux. Mais également pour l’immobilier : « Les hôtels particuliers ont la cote » grâce à « la mondialisation [qui] crée de plus en plus de multimillionnaires », notait la même édition des Échos. Et tout le haut de gamme, les fourrures, les alcools, les parfums, les bijoux, les montres, etc. explose – pour la plus grande joie de LVMH, qui « a de nouveau enregistré une progression à deux chiffres de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2007 », ou encore de L’Oréal qui « connaît une croissance du bénéfice à deux chiffres pour la dix-neuvième année consécutive ».
C’est « dans ces années 90 », donc, que Megève connaît un « renouveau » : il n’y a pas de hasard. Sans doute fallait-il des hommes, dynamiques, pour y « participer », avec « le polo, les calèches, les sculptures », mais à peine semée, la graine ne demandait qu’à germer. Les capitaux étaient disponibles. Les mécènes, assez opulents pour déverser leurs bienfaits. Et assez confiants pour ne pas cacher leur fortune. Les professionnels du luxe, prêts à envahir la station – de boutique Hermès en galeries d’art, des antiquaires aux promoteurs des « chalets rustiques de standing ».
La petite histoire, locale, microscopique, rencontre bien la grande, la globale – celle qui répartit richesses et pouvoirs. Celle qui voit le triomphe d’une oligarchie, avec ses ghettos.

Années 2005-…. : la révolte ?
La prise de conscience d’un phénomène a souvent un wagon de retard, voire plusieurs trains, sur le phénomène lui-même. Sur cette « oligarchie », qui s’épanouit pourtant depuis vingt ans, les Pinçon-Charlot ne posent ce mot qu’aujourd’hui. Mais les aurions-nous écoutés, avant ? Ou les aurions-nous qualifiés de « démagogues », « populistes », cherchant à ranimer une antique « guerre des classes », des originaux à ranger dans la fraction minoritaire de l’extrême-extrême gauche ?
Car autre chose, encore, a ralenti – voire interdit – cette prise de conscience. Avec le naufrage soviétique, le bébé marxiste fut jeté avec l’eau du bain stalinienne. Tout un vocabulaire, toute une lecture du monde, toute une division en « riches » et « pauvres » devenaient tabous, jusqu’au nom d’ « ouvrier »…
Il a fallu des expériences, et des échecs, pour que l’idée se fasse jour, lentement, dans quelques esprits, pour qu’elle redevienne « dicible et audible », se répande dans d’autres cerveaux. À quoi ont servi toutes les protestations, à Gênes, à Davos, à Seattle, nées à la fin des années 90 – et qui s’épuisent aujourd’hui ? Elles n’ont qu’à peine troublé l’ordre économique, certes. Elles n’ont guère empêché la baisse des barrières douanières par l’OMC, la mise en coupe réglée de l’Afrique par le FMI, la marchandisation du vivant. Elles ont encore moins abouti à la taxation des transactions financières – et on peut les enregistrer comme autant de défaites. Mais ces manifestations ont allumé une lumière, dans une décennie morose : ils décident sans nous.
L’aventure du 29 mai 2005, en France, suivie du Traité de Lisbonne a renforcé, étendu cette conviction – l’a rendu majoritaire. Et le sans-gêne de Nicolas Sarkozy, dès ses premières heures de présidence, de sa Nuit du Fouquet’s à son odyssée sur le Paloma, ont déchiré le voile : pour beaucoup, l’oligarchie – ce vocable hier interdit – est devenue une évidence. Que le journaliste du Monde Hervé Kempf, guère bolchevique, pas même marxisant, en fasse sa cible, voilà qui signale une radicalisation possible du pays.
Et même des pays. « Income inequality seen as the great divide. » « L’inégalité de revenus est regardée comme le grand clivage. » C’est un titre, non de L’Huma Dimanche, mais du Financial Times : « L’opinion publique à travers l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis est significativement homogène pour considérer que le fossé entre riches et pauvres est trop large, et que les riches devraient payer plus d’impôts. L’inégalité des revenus a émergé comme une question politique hautement conflictuelle dans beaucoup de pays, pendant que la dernière vague de la mondialisation a créé une “super-classe” de riches. Des majorités nettes dans tous les pays s’accordent à dire que les impôts devraient être augmentés pour les riches et diminués pour les pauvres… » (19/05/08). À coup sûr, ce sondage n’aurait pas obtenu les mêmes résultats, il y a dix ans, ou vingt ans – avec cette aspiration égalitariste. Et à coup encore plus sûr, la bible des financiers ne l’aurait pas commandée, publiée…
À nous de jouer, maintenant. À nous, de retrouver des forces – des partis, des syndicats – pour leur crier, toujours plus haut, plus fermement, à ces « maîtres de l’argent, l’argent, l’argent », à ces « nouveaux seigneurs », à ces « maîtres de l’armement, maîtres de l’ordinateur, maîtres du produit pharmaceutique », que « nous ne ferons pas payer cher le malheur de tant de siècles. Mais pour l’argent, l’argent, toujours l’argent, alors c’est vrai : il ne faut pas trop qu’ils y comptent. »
À nous de les faire descendre de leur Olympe alpin, eux que l’argent a fait dieux.
Fakir, 9 rue de la Hotoie 80000 Amiens | dossier CNIL n°1036912 | webmaster | contact
Fakir 2002-2011 | Le site fakirpresse.info (textes, dessins, sons, videos...) est sous licence Creative Commons.