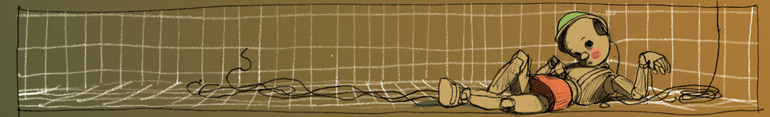Les révélations de la Cour des comptes prennent en effet une autre dimension si on relie les faits incriminés à la vision néolibérale de l’éducation qui caractérisait le [projet du triumvirat Descoings-Pébereau-Casanova (Lire « L’Ecole libre des sciences politiques », Le Monde diplomatique, 25 octobre 2012). La transformation avait été entamée par Alain Lancelot qui ne cachait pas ses convictions politiques. L’arrivée de Michel Pébereau à la présidence du Conseil de direction en était aussi un signe manifeste. Inspecteur des finances, ce dernier avait été en 1986, dans le cabinet d’Edouard Balladur, un artisan des privatisations du gouvernement de cohabitation mené par Jacques Chirac. Alors qu’il n’était pas un ancien étudiant de Sciences Po, son intérêt pour cette institution ne s’est pas démenti puisqu’il a occupé cette fonction sans discontinuer depuis 1988, soit durant vingt-quatre ans. Tout en étant PDG des banques qu’il avait privatisées, le CIC puis la BNP (devenue sous son égide BNP-Paribas). Or, cet homme aux solides convictions néolibérales a soutenu la politique de privatisation de Sciences Po, rejoint en 2007 par un autre néolibéral affiché, l’économiste Jean-Claude Casanova, président du Conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) (Lire « Poker menteur à Sciences Po », Le Monde diplomatique, 5 novembre 2012).
Privatiser Sciences Po, cela était difficile sans précautions spéciales. Il revenait à Richard Descoings d’inventer la formule pour y parvenir. Avec sa réputation d’école des élites, Sciences Po ne pouvait subir une transformation renforçant le sens élitaire sans soulever la réprobation. La grève de 1995, provoquée par l’augmentation des droits d’inscription, sonna comme un avertissement. Alain Lancelot, directeur contesté, fut avantageusement reclassé au Conseil constitutionnel. Richard Descoings, son directeur adjoint, reprit le flambeau avec subtilité. Sciences Po allait faire du social en corrigeant son image par la distribution de bourses et surtout en créant le dispositif de discrimination positive par le recrutement dans des lycées de ZEP. La conférence de presse habilement montée en février 2001 inaugurait sa stratégie de communication. Les journalistes présents écoutèrent le directeur, puis les proviseurs des premiers lycées concernés. Sortant dans la rue, ils découvraient dans le kiosque la une du journal Le Monde consacrée à l’initiative de Sciences Po. Ce coup médiatique réussit au-delà de toute espérance : Sciences Po devint presque synonyme d’une politique sociale d’avant-garde. Plus personne ne pouvait ignorer la signification de l’acronyme ZEP, et plus personne ne pouvait attaquer la sélection sociale à Sciences Po. Descoings devint une star médiatique adulée par les étudiants, les journalistes et les politiques. Sans qu’il contrôle tout à fait son succès.
Richard Descoings affichait régulièrement son ambition d’augmenter le financement privé de son école, afin qu’il dépasse le financement public. A coup d’augmentations des frais d’inscription et des effectifs, d’ouvertures de succursales, d’emprunts (même toxiques) et d’appels réguliers à la générosité des anciens élèves. Echec. Le financement de l’Etat est resté majoritaire et le total des financements publics est supérieur à 70 %. La conviction néolibérale ne saurait être désintéressée et, sauf contradiction, on ne fait pas autant d’efforts si ce n’est pour en profiter soi-même. Descoings d’abord, et ceux qui le secondaient ensuite. Il faut bien acheter les loyautés. L’équipe de direction a donc bénéficié d’augmentations de leurs rémunérations, primes et avantages divers. « Ce n’est tout de même pas Goldmann Sachs », se défendait un dirigeant, trahissant ainsi son univers de référence. Les salaires et les primes des dirigeants auraient été plus légitimes, si l’objectif d’un financement privé avait été atteint. Or financées par de l’argent public, la Cour des comptes pouvait alors contrôler ces rétributions par anticipation.
Si les reproches du rapport de la Cour ont été reconnus par le président de la FNSP Jean-Claude Casanova, qui est censé contrôler la gestion du directeur de Sciences Po, il devrait en toute cohérence démissionner (Lire « Rapport sur Sciences Po : une forte ambition, une gestion défaillante », Cour des comptes, 22 novembre 2012). Avec Michel Pébereau, dont la mission à la tête du Conseil de direction était similaire. S’ils ne le font pas, c’est que l’entreprise néolibérale ne saurait céder aux impératifs d’une morale de l’honneur. Irresponsables à leurs propres yeux, ils ont donc opposé leur arrogance à la ministre de l’enseignement supérieur Geneviève Fioraso. Ils ont procédé à l’élection discrétionnaire du nouveau directeur. Contre la demande de la ministre. Affirmant l’inverse lors de l’élection : le ministère a aussitôt démenti. Affirmant aussi que la Cour des comptes avait donné l’assurance qu’il n’y aurait pas de poursuites judiciaires — autre assurance qui s’est avérée fausse. Le mensonge cynique à la tête d’une institution d’enseignement est un mauvais exemple donné aux jeunes générations. Etait-ce si urgent ? En nommant l’administrateur provisoire et héritier putatif Hervé Crès, ils pensaient créer l’irréversible. Avec le risque d’être contrariés par le rapport de la Cour des comptes publié le 22 novembre. Or, la Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie afin de juger les dirigeants. La ministre a immédiatement imposé la nomination d’un nouvel administrateur provisoire.
Le coup de force de l’élection du nouveau directeur se justifiait parce qu’Hervé Crès avait été choisi pour continuer la politique de privatisation. Ancien élève de HEC ayant eu une carrière dans le privé, il « collait » bien à la transformation de Sciences Po en business school (lire « Comment Sciences-Po et l’ENA deviennent des “business schools” », Le Monde diplomatique, novembre 2000) selon les projets du triumvirat néolibéral qui le menait jusqu’alors. Dépité d’être récusé par une assemblée générale du personnel et finalement détrôné de son mandat de directeur malgré son communiqué aux personnels qui faisait fi de la nécessaire ratification par l’Etat, il n’en manifestait pas moins son adhésion à l’entreprise néolibérale : « Je n’accepte pas de servir de bouc émissaire. Richard Descoings a bousculé les conservatismes, ce qui a pu provoquer du ressentiment » (Le Monde, 23 novembre). Avec une belle continuité, il reprenait ainsi l’argumentaire de Descoings, qui accusait de conservatisme toute objection, utilisant sa politique de discrimination positive pour renvoyer dans les cordes toute critique de gauche. Belle stratégie de bataille à fronts renversés : plus égalitaire que moi.... Est-ce du conservatisme que de contrôler l’usage des finances publiques ? Conservatisme que de mettre en cause les gaspillages ? Conservatisme que de mettre en cause l’arbitraire, l’opacité et les privilèges ? Il faut une bonne conscience aveugle ou beaucoup de cynisme pour le soutenir.
En prétendant que le statut de cette école n’est pas en cause, on peut craindre que les dirigeants aient raison. Si le gouvernement, une fois de plus, s’inclinait devant la pression des dirigeants de Sciences Po, ils n’illustreraient que le constat selon lequel les élites ne réforment pas volontiers le système de sélection qui les a consacrés. On peut le craindre, d’autant plus que le statut qui a permis de mener subrepticement une politique de privatisation risque fort d’en permettre la reprise une fois la crise finie. Or, avec l’université de Paris Dauphine, Sciences Po joue le rôle de poisson pilote d’une université néolibérale. Après que la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) en ait posé les bases en conférant l’autonomie à chaque université, ces établissements ouvrent la voie à la privatisation de tout l’enseignement supérieur, où les études devront être payées par les étudiants. Par leurs parents pour ceux qui ont la chance d’être bien nés, par l’emprunt pour ceux qui ne l’ont pas. Ces derniers commenceront leur vie professionnelle avec des remboursements étalés sur deux décennies, comme aux Etats-Unis où s’est constitué une bulle des emprunts étudiants (Lire Christopher Newfield, « La dette étudiante, une bombe à retardement », Le Monde diplomatique, septembre 2012). Au moins se tiendront-ils tranquilles. On aimerait que les dogmatiques néolibéraux nous expliquent la supériorité de cette organisation sur l’enseignement public qui les a généralement consacrés en France. Ils ne convaincront pas ceux qui pensent que l’éducation est un bien public, qu’elle doit être gratuite, même pour les gens fortunés, pour corriger les inégalités sociales. C’est vouloir faire prendre des vessies pour des lanternes que de prétendre que la restauration de l’Ecole libre des sciences politiques, pour préparer la privatisation de tout l’enseignement supérieur, est un progrès.