
Un monde est mort, il court encore... La preuve par le poulet
Par François Ruffin, 10/01/2013
Un dossier consacré au plan social chez Doux (numéro 57). Un recueil de témoignages d’ouvriers de l’usine Doux de Graincourt (62), notamment celui d’Annabelle, 48 ans, élue au comité d’entreprise.
« Mais est-ce que vous êtes heureux, ici ? »
Des rires répondent.
Une hilarité collective, contenue.
Qui passe d’un rang à l’autre : « T’as entendu ce qu’il a demandé ? “Est-ce qu’on est heureux, ici ?”
- Il veut rigoler ! On est là pour la paye…
- C’est la chaîne. »
Le moment est mal choisi, c’est vrai, pour les questions existentielles : on piétine à l’entrée de l’usine Doux, à Graincourt, dans le Pas-de-Calais. Clopes au bec, moustaches inquiètes, sacs à main en bandoulière, ouvrières et ouvriers sont rassemblés sur le parking, par petits groupes, en ce matin de juillet. Ils débraient depuis l’aube, espèrent encore. Conservent des lambeaux de foi. Qu’il y aurait des projets de reprise, que « là-haut ils vont sortir un lapin blanc de leur chapeau ». En visite sur le site, d’ailleurs, l’administrateur judiciaire leur a confirmé qu’ « il y aurait, éventuellement, deux acheteurs potentiels », et malgré le conditionnel, et le « éventuellement », et le « potentiels », eux veulent y croire. Malgré les déceptions passées, aussi : « Ils nous ont menti sur un Hollandais, qui devait venir, qui pouvait racheter, mais on l’a jamais vu. Comme ça, on se tient sage. On travaille bien jusqu’au bout. On remplit les commandes. » Et à eux que l’angoisse tenaille, je jette mon interrogation bourgeoise : « Mais est-ce que vous êtes heureux, ici ? »
Après la surprise, les remarques fusent, en vrac, de Philippe, Sylvie, Virginie, Jean-Luc, je peine à noter les prénoms au vol, et encore davantage leurs observations sur les salaires, la sécurité, la formation, les souffrances, etc. Je vais classer ça dans l’ordre, maintenant, qu’on entrouvre la porte de ce paradis.

Les clopinettes
« On enlève la prime de froid, on est au smic. Je ne me rappelle plus avoir eu une augmentation depuis 25 ou 30 ans. »
« Avec mon mari, on a un deuxième boulot à côté : on passe tout l’été à faire du gardiennage à Paris. Ça fait cinq ans qu’on n’a pas pris de vacances. Ma fille, je ne la vois plus, je la croise. »
« On a acheté une maison il y a deux ans, on en a encore pour 23 ans à la rembourser. On voulait aller au Crédit immobilier de France, mais ils ont refusé : “Nous, on ne prête pas pour les employés de chez Doux. Vous n’êtes pas payés, et le groupe n’est pas solide.” »
« Un directeur, je lui ai dit : “Toi, tu fais tes courses où ?
- À Auchan.
- Moi, à Aldi.” »
Les souffrances
« Ici, ils ne voient que le rendement. A la découpe, on tournait à 2700 poulets à l’heure, on est passés à 3200. Ça use. Ça fait des tendinites. Les femmes, la tête baissée, souffrent des cervicales. »
« Avec mes cartons de 15 kilos, j’ai calculé : je porte deux tonnes par jour. Depuis quinze ans. Forcément, le dos morfle. »
« Après 23 ans ici, ils se sont aperçus qu’on était à 90 décibels. On a perdu des dixièmes au niveau des oreilles, des yeux. »
« Ils me font faire un boulot très dur, malgré ma sciatique. Mais on hésite à se mettre en arrêt-maladie, à cause des jours de carence : on est déjà à découvert. »
L’irrespect
« On tourne au ralenti. Du coup, les bêtes abattues vendredi, on ne les a découpées qu’hier, mercredi. Les escalopes avaient une drôle d’odeur. J’ai appelé le chef : ‘C’est ta bouche, il m’a répondu, elle est trop près de ton nez.’ Alors qu’avec cette puanteur, j’étais au bord de dégueuler. »
« Dès que tu l’ouvres, t’es cassé. Le représentant syndical CGT, il s’est fait virer pour faute lourde. On a réussi à le faire réintégrer. Le gars de la CFDT, pareil : deux fois il arrive en retard, il a un petit échange avec son supérieur, il a failli se faire jeter. »
« Ici, tu fermes ta gueule. L’autre jour, des cuisses de poulets, il sortait du pus, rouge, jaune, vert, leurs saloperies d’antibiotiques. Sous la marque Père Dodu. Je fais la remarque : “Ça ne devrait pas arriver sur le tapis…” On m’envoie balader, méchamment. Il a fallu que le vétérinaire intervienne, et qu’il fasse jeter la production. »
La bonne blague des formations
« Depuis vingt ans, je déplace des palettes, les mêmes palettes, sans bouger de poste, sauf parfois un remplacement. On n’a pas la possibilité de changer, d’évoluer, c’est “tu te tais et tu restes là”. »
« La seule formation que j’ai reçue, c’est l’an dernier : un stage de ‘gestuel’. Pour m’apprendre à soulever des cartons. Ça faisait dix-neuf ans et demi que je soulevais des cartons, et là, on allait m’apprendre ! La blague… C’était juste pour les assurances, à cause du taux d’accidents ici. »
Voilà le catalogue, raccourci ici, recueilli à la volée, en cinq minutes, et qui pourrait, j’en suis sûr, s’épaissir pour concurrencer les Trois Suisses. Avec une cause, notamment, j’analyse rapide, à ce très sombre tableau : Doux fabrique des produits à très faible valeur ajoutée. Et investit donc peu, sur le matériel, et sur les hommes. Tout comme la filière textile, déclinante dans les années 80, où l’on retrouvait la même dureté. Y a un petit attroupement, devant mon cahier, et je reprends ma question : « Donc, vous n’êtes pas très heureux ici ?
- Non, pas “très” !
- Et pourtant, vous voyez, tout ce que vous souhaitez, et je vous le souhaite aussi, c’est que ça se poursuive comme avant. Qu’il y ait une reprise, un plan de continuation, à l’identique…
- T’as tout compris. On critique notre boulot, ça nous fait chier de venir tous les jours, mais on a un salaire.
- C’est le seul travail qu’on ait trouvé. Y a rien dans le coin. Et ça ne va pas s’arranger, avec les plans chez Renault, chez Sévenord.
- Moi, j’ai déjà fait deux fermetures d’entreprises.
- Et nous, les gens du Nord, on est des bosseurs, on veut travailler… »
Le courant passe, sur ce bout de bitume. Alors, je prolonge mon numéro : « Vous avez raison, bien sûr. Je vous comprends. Mais ça en dit long, quand même, sur combien notre espoir s’est rétréci : un système pervers, qui ne rend heureux personne, se casse la gueule, et tout ce à quoi on aspire, aujourd’hui, pas seulement vous, mais les syndicats, le gouvernement, même moi parfois, c’est à le remettre sur pied.
- C’est exactement ça.
- Combien de fois j’ai pensé ça, depuis que ça tourne mal... »
Pareillement encouragé, je n’arrête pas ma prédication en route : « Ça témoigne d’une absence, je ne parlerai même pas d’utopie, c’est bon pour un autre monde l’utopie… On vit dans celui-ci…
- Les deux pieds dans la merde, tu peux le dire !
- Ça témoigne, plus simplement, d’une absence d’espérance, de capacité à opérer le changement, à penser une transformation positive. Même sans viser un idéal, juste le “mieux”, rien qu’un petit mieux, ou un peu moins pire, un pas en avant plutôt qu’en arrière... »
Ça opine dans les rangs.
On est bien d’accord.
Mais ça ne nous mène pas loin.
Ça ne résout rien.
Et avec Fabrice Hanot, le délégué CGT, on entrevoit bien, et on énumère, tous les obstacles posés sur le chemin, « les crédits à la consommation », « la concurrence internationale », « le taux de chômage à 10 %, et le double chez les non-qualifiés », sans compter toutes les forces sociales qui sont mobilisées, en face. Diplômés du management, champions de la publicité, experts en ressources humaines, spécialistes en productivité, Premier ministre raisonnable, Commissaires à la concurrence, etc. Toutes ces intelligences, oui, intelligences, ne pas mépriser l’ennemi, qui sont rassemblées pour perpétuer cet ordre des choses. Plutôt que pour l’abolir, et ouvrir l’avenir.
Et nous, en face, désarmés, bien seuls sur ce parking.
Et nous qui rejoignons un Algeco, pour un café au local syndical…

Annabelle, 48 ans
« Ça fait un an seulement que je fréquente la CGT. »
Il ne reste qu’elle et moi dans le local syndical, Annabelle et sa beauté fatiguée. Élue au comité d’entreprise, elle vient de causer devant ses collègues des plans de reprise, de la fermeture pendant les vacances, du passage au tribunal, etc. Ses camarades sont sortis, et elle baisse la voix, l’armure :
« Ça fait pas longtemps que je fréquente ici. Avant, je pleurais tous les jours. Le matin, j’arrivais avec une boule au ventre. Les chefs me criaient dessus, je chialais. Même sexuellement, j’étais harcelée. Mais à force que de côtoyer des gens de la CGT, à force qu’ils me répètent “faut pas te laisser faire, Annabelle”, à force de qu’on me dise ça, je me suis sentie plus forte. » Elle s’allume une clope : « Heureusement que j’ai mes cigarettes. Sans ça, je casse tout. »
Elle exhale une taffe.
« Maintenant, j’ai plus peur du tout, de rien. Ni des chefs, ni des caméras, ni des réunions… C’est moi qui aide les autres ouvrières. J’ai même réussi à aider une dame très grosse, sur la chaîne. Elle ne pouvait plus marcher, c’était terrible, mais son mari ne voulait pas qu’on l’opère… Je suis allée le voir, moi qui avais peur de tout, et je l’ai convaincu, son bonhomme. Elle est passée à l’hôpital, et aujourd’hui, elle revit. J’ai été métamorphosée. En un an, à 47 ans… Jamais je l’aurais cru. Ça peut arriver à tout âge ! A tout le monde, je répète ça : on peut changer sa vie avec la CGT ! Je ne savais pas que ça existait, sinon j’y serais allée avant. Et y en a partout, il paraît, même dans les magasins… Faut le dire. »
C’est Bernard Thibault qui devrait la faire tourner dans une pub…
Elle inspire longuement :
« Je vous raconte ma vie, c’est pas bien. Tant pis. Quand même, j’ai peur. Pour la suite. On est déjà en plein surendettement, avec mon mari. Lui travaille à la Poste, on l’a changé de place. Il était bien, dans une bonne équipe, avec des copains, comme dans un cocon. Maintenant, il déprime un peu. Et aussi, on lui a enlevé ses heures supplémentaires : il est passé de 2 500 à 1 500 euros. Y a 900 euros de son salaire qui partent directement pour le crédit sur la maison, 96 euros pour l’assurance de la voiture, 600 euros du mien, et on verse 300 euros à notre fils pour son diplôme d’aide-médico-psychologique… C’est pour soigner les handicapés. Faut se priver. »
Sa gorge se noue, la peine s’invite dans sa voix : « Hier, mon autre garçon a piqué sa crise : il voulait manger de la tartiflette. Mais on ne peut pas se la permettre, la tartiflette, nous c’est tous les jours des pâtes. Et tout ça, en travaillant. En se levant à trois heures et demies du matin… Depuis que je travaille de nuit, je rentre, je me couche. Je n’ai plus envie de sortir de ma chambre, même pour faire à manger, ou la vaisselle. Heureusement que mon mari tient le choc, il reste fort taquin avec les enfants. Tous ces efforts, et on tire la langue. J’ai dû demander dix euros à un collègue, pour remettre du gasoil. Ou ce dimanche, j’étais invitée par ma famille à une fête foraine. Pour éviter de dire que j’ai pas d’argent, j’ai dû raconter que ma carte avait été avalée par un distributeur. “Bah, vous allez dire, pourtant elle se maquille et tout” ?
- Non non, je ne dis rien…
- Je me suis toujours maquillée, depuis que j’ai seize ans. Donc je ne veux pas me laisser aller. Quand j’ai un peu de sous, je fais plusieurs bazars, à bas prix, je mets de côté. Pareil pour les cigarettes, on m’apporte des tubes du Luxembourg. C’est moins cher là-bas… »
Un moustachu rentre, et interrompt ce récit intime : « Bah alors, on t’attendait là-bas ?, il lance, bougon.
J’arrive. »
Il ressort.
« C’est lui, c’est Jean-Claude qui m’a prêté les dix euros. Et qui m’a encouragée à venir ici. »
Cette fraternité qui ne s’expose pas, cachée derrière des airs bourrus. On traverse la cour. Son talon s’enfonce dans une plaque d’égout, arraché de sa botte : « Je vais devoir faire la quête pour me chausser ! »
Et les poulets ?
Ça faisait sentimental, comme question, pour ces grands costauds, pour ces filles endurcies. Hypersensible urbain, face à ces prolos des campagnes : « Excusez-moi, mais les poulets, c’est pas comme de l’acier, non ? Quand vous les voyez, ça vous fait quoi ? »
Y a comme un temps d’arrêt, devant le sujet.
Interloqués, comme si on ramenait un non-dit, un tabou.
Les habitudes à chasser, âme cuirassée, pour se souvenir.
C’est un homme qui se lance : « La première fois que je suis entré ici, je me suis demandé : “Mon Dieu, où je suis tombé ?” On en fait des cauchemars… Je suis pas le seul. “Tu dormais, m’a raconté ma femme, tu t’es assis dans le lit, et tu parlais des poulets.” Qu’on en tue autant, je ne pouvais pas imaginer. Et il faut voir comment ça se passe… »
C’est une femme qui reprend : « Quand tu les vois qui se débattent… Je ne voulais pas travailler à l’abattoir, je ne voulais pas les voir à l’abattoir. Regarde-les, là, dans ces caisses. Comme on tourne presque plus en ce moment, y en a sept mille, dix mille, qui restent dehors, dans les cages, sans manger, sans boire. Ils vont mourir là. »
Nous voilà dans un grand hangar, totalement vide, chez un éleveur. Toutes ses volailles ont crevé : « L’ordinateur, il a donné l’ordre de chauffer, comme s’il faisait froid. Et il a fermé les rideaux. Automatiquement, les bêtes ont été étouffées. »
D’une voix calme, Éric Carette raconte son petit incident informatique : « En six heures, les poulets étaient comme ébouillantés.
- Y en avait combien ?
- Dix-sept mille. »
De l’ « ordinateur » à « automatiquement », voilà qui décrit bien, dans sa banalité, un système inhumain. « L’expert est passé, conclut l’agriculteur. Normalement, l’assurance doit prendre en charge le sinistre. »
De l’éclosion des poussins jusqu’à leur élevage, leur ramassage, le transport, leur mise à mort… La vie du poulet n’est qu’un long calvaire. Ou plutôt « court » : 41 jours. Le cœur, les poumons, les pattes, tout est malade. Et même les productivistes de l’Inra, l’Institut national de recherche en agronomie, s’en inquiètent… D’un point de vue productif : « Ces troubles entraînent une forte morbidité des animaux . D’après des études faites en élevage intensif, entre 75 et 90% des animaux ont une démarche altérée, ce qui entraîne une augmentation de l’indice de consommation et une diminution de la vitesse de croissance. Au-delà des pertes économiques directes, ces troubles affectent aussi l’image de qualité promue par la filière avicole. »
L’aviculture, c’est l’issue de secours trouvée, après-guerre, par les paysans pauvres. Le poulet industriel a sorti leur ferme de l’ornière, leur a permis d’accéder au confort. D’où l’attachement de ces éleveurs au modèle productiviste. Voire au groupe Doux…
La revanche des « petits »
« Mes grands-parents vivaient sur une petite exploitation de quinze hectares. Ils avaient du mal à vivre, tuaient le cochon, vendaient le beurre, se chauffaient au bois… Presque en autarcie, à part quelques œufs sur le marché. »
Didier Goubil est aujourd’hui élu de la Chambre d’agriculture du Finistère, président du pôle aviculture régional – et défenseur du « modèle [productiviste] breton ». Avec ses bonnes raisons, liées à l’histoire de sa famille :
« Mon père hésitait : il a passé le concours de la gendarmerie, et la même semaine, son oncle et sa tante lui ont dit d’accord pour lui laisser leurs terres. Il allait s’agrandir un peu, et avec 25 hectares il s’en tirerait, il pensait. Mais la Chambre d’agriculture lui répétait : “Vous aurez du mal, avec si peu de surface.” À l’époque, sur Carhaix, il y avait six négociants en volailles. Ils avaient commencé à envoyer quelques camions sur Paris, chaque semaine, dans les restaurants, mais les mandataires sur Rungis se plaignaient de l’hétérogénéité : y en avait des gras, des maigres, des déplumés. Ils réclamaient de la came standardisée.
Mon père faisait partie des jeunes, qui innovaient, dans les porcs, ou dans la volaille. Et il s’est lancé : il a construit un premier poulailler, en 1960. Mon grand-père freinait. C’était pas une mince affaire : le maçon du coin l’a pris pour un fou... Cinq cents poulets ! Ça mobilisait toutes les économies. »
Complexe agro-industriel
Aujourd’hui, a posteriori, on appelle ça le « complexe agro-industriel breton ». On regarde ça comme une nécessité historique. Mais c’est le fruit d’une aventure humaine, faite d’incertitudes, de choix, de doutes, de réussites, de conflits – même familiaux. Des pionniers se sont bagarrés pour lancer ça, pour l’inventer. Et leurs volontés ont épousé le projet des firmes, de la grande distribution, de la recherche agronomique, etc. Et une volonté politique venue du sommet.
Ainsi, par exemple, de « la Rurale Morbihannaise », une coopérative qui, vers 1950, subit les variations du cours des plants de pomme de terre. Que faire, réfléchissent ses dirigeants ? « Un premier essai de d’élargissement des activités de l’Union concerne la production d’arbres fruitiers, mais c’est un échec, retracent les historiens Pierre Daucé et Louis Guigueno. Vient ensuite une tentative de production d’artichauts : elle n’aura pas de suite non plus. C’est alors que l’idée d’élevage de volailles fait son chemin : par des revues, on apprend que la production intensive de poulets de chair se pratique dans certaines régions de France et notamment du Nord. En 1951, quelques responsables de la coopérative décident d’un voyage dans la Somme : ils y rencontrent un notaire-éleveur qui déclare gagner davantage d’argent avec son élevage qu’avec son étude. De retour chez eux, les participants au voyage sont convaincus de la rentabilité de cette production. Une foire-exposition se déroule d’ailleurs à Saint-Brieuc où l’on expose un modèle de poulailler type Ourdin, de 135 mètres carrés. Et en 1952, à Buléon, un premier élevage est mis en place chez un adhérent de la coopérative. […] Malgré les revenus appréciables tirés des premiers élevages, les agriculteurs du secteur restent sceptiques. Ce n’est que lorsque le premier aviculteur de Buléon décide la construction d’un deuxième poulailler en même temps qu’il s’achète une automobile qu’un déclic se produit. » Et c’est alors parti à grande échelle…

Une brique par mois
M. Goubil père connaît davantage de déboires : « Manque de chance, sa première bande est tombée une année de surproduction. Ils ne voulaient plus de poulets à Paris, ou à des prix très bas… Mon grand-père a passé une engueulade à mon père : “Qu’est-ce que t’as été foutre avec un poulailler ?” Du coup, le nouveau hangar servait à stocker des patates.
Et puis un négociant, Plassard, est repassé : “C’est le moment, la demande repart.” Une fourgonnette est venue amener les poussins. Et en juin, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tout le monde avait mis des poussins dans les greniers, c’est à nouveau la crise ! Plassard est revenu : “Y en a trop.” Là, le grand-père a failli péter la pile : il avait fallu vendre trois poulains, plus le veau, pour payer les poussins et les aliments.
Et voilà que, coup de chance, les poulets sont arrivés à Paris un jour où la marchandise manquait. Il les a vendus 5 francs le kilo. Le cours n’a pas changé en cinquante ans, aujourd’hui c’est 80 centimes d’euro. Mais voilà qu’en une seule livraison, ça lui a rapporté les poussins, l’alimentation et le poulailler ! Tout était payé, d’un coup. Là, mon grand-père a changé de gueule, et mon père a construit un deuxième poulailler, quelques années plus tard, en 1969, qui l’a complètement mis sur les rails. Ce sont ces 1 500 mètres carrés que j’exploite toujours.
Mon père me disait : “Je veux toucher une brique par mois” [10 000 francs, 1 500 euros]. Il les a atteints. Sans ça, il aurait cédé la ferme. Et la Bretagne se serait retrouvée comme la Creuse, ou l’Ardèche, un désert avec mille sangliers sur la commune et les écoles fermées. »
Vie méritante
L’aviculture apparaît, dans ce récit, comme la revanche des petits. C’est l’issue de secours trouvée par les paysans pauvres, aux petites surfaces– 7 à 8 hectares, en moyenne, dans les années 1950, en centre Bretagne – pour sauver leurs fermes, pour éviter l’exil en ville, pour suivre le niveau de vie moderne, avec voiture, machine à laver, etc. Et ne pas finir en folklorique repaire de ploucs.
Le presque centenaire Raymond Théodec confirme : « On avait une toute petite ferme, où on faisait un peu de tout. En 1955, j’ai repris les 13 hectares et j’ai foncé tête baissée. On a commencé par 6 000 poulets, grâce au soutien des techniciens de la coopérative. Les parents étaient méfiants, mais il fallait y aller, ou disparaître. Et c’est comme ça qu’on a tout eu : l’eau courante, les sanitaires, et puis le confort électrique. »
Autre lieu, autre temps, mais même sociologie : en Picardie, Éric Carette a exercé treize ans comme cuisinier, d’abord dans un grand restaurant avec étoile au Michelin, puis dans la cantine d’entreprise de Continental – avant sa fermeture. Licencié en 1981, il hérite « des terres et des emmerdements » : « Tout le monde me disait : “T’es fou, avec 15 hectares dans le Santerre, au milieu des grandes plaines de betteraves, tu ne peux pas t’en sortir.” » La volaille lui apporte la prospérité : l’aviculture nécessite « peu d’espace », s’avère « insignifiante en trésorerie », procure « un revenu très correct », réclame « moins d’occupation », bref, que des avantages. Et sa demeure, « un ancien corps de ferme, de ma grand-mère, en démolition », sa décoration intérieure, sa berline garée dans la cour, le parcours scolaire de sa descendance, témoignent de son aisance, acquise – comme le souligne sa femme – au fil d’ « une vie méritante, avec trois enfants, le travail dans la journée, le chantier en soirée et le week-end », mais aussi d’un choix de production judicieux.
Socialement erroné
« L’éleveur est sur la paille », titre Le Canard enchaîné (1/8/12). Et de brosser à grands traits ce portrait d’un métier : « Les poulets (qui, d’ailleurs, ne leur appartiennent pas), l’éleveur doit les engraisser “en quarante jours”, en suivant un“ plan d’élevage”. C’est Doux qui fournit les poussins (préalablement vaccinés), livre la pitance sous forme de granulés fabriqués dans ses usines, puis qui ramasse les poulets calibrés à 1,5 kilo pour les zigouiller et les transformer dans ses propres abattoirs-usines. Un travail passionnant, généreusement payé 17 centimes d’euro le kilo de poulet livré. Les volailles passées de vie à trépas dans le poulailler, c’est pour la pomme de l’éleveur, tout comme le chauffage, les soins vétérinaires, les médocs, les assurances… et bien sûr l’emprunt qu’il a dû contracter pour construire son poulailler XXL. »
C’est factuellement exact.
C’est socialement, psychologiquement, erroné.
En quelques lignes, l’éleveur « généreusement spolié » est dépeint en exploité par le dur Doux. On en rêverait, d’une situation aussi manichéenne : avec fourches et tracteurs, la révolution ne tarderait plus dans les campagnes…
Mais voilà qui ne correspond, mais alors pas du tout, au ressenti des aviculteurs eux-mêmes. Pour ceux rencontrés, l’élevage intensif les a nourris et bien nourris. Grâce à lui, ils ont sorti leur ferme de l’ornière. Et l’on comprend, au vu de cette histoire familiale, leur attachement à ce modèle productiviste, voire au groupe Doux – qu’ils ne critiquent qu’à demi-mot, ne rejoignant pas les ouvriers dans les manifs.
C’est une erreur de diagnostic, et donc une faute politique, de prétendre le contraire. Une illusion de croire ces travailleurs d’emblée acquis à notre cause, convertis par la vertu d’une catastrophe économique, et donc prêts à la reconversion – en bio, en label, etc. Ils ont des raisons, et même des bonnes raisons, d’y résister.

Formule 1 de l’élevage
« Un travail passionnant », ironise Le Canard dans la foulée. « Poussins fournis », « pitance livrée », « plan d’élevage »… Ne resterait aux agriculteurs qu’un boulot de tâcheron, qu’à « appuyer sur des boutons ». Sauf que le métier n’est pas vécu ainsi.
« Comme je me suis retrouvé élu de la Chambre d’Agriculture et maire de ma commune, explique Didier Goubil, j’ai dû arrêter le poulet export. Je suis allé vers la volaille certifiée, mais pas par philosophie, juste à cause de mon emploi du temps : il me fallait de l’élevage à durée plus longue. Parce qu’on doit chasser cette idée des esprits : le poulet industriel serait plus facile à produire. Est-ce que les Twingo sont produites par des mauvais ouvriers ? Et les Vel Satis par les bons ? Au contraire, le poulet export, c’est beaucoup plus technique. C’est la Formule 1, l’éleveur doit être un pilote de course, arriver au poids idéal en quarante-deux jours. Par exemple, hier, avec les températures pas habituelles, même bien ventilé, il fait 3 ou 4 degrés de plus dans le poulailler. Il va manquer 60 grammes en fin de semaine… Tandis que moi, sur mes volailles, je suis moins stressé. J’ai plus de temps pour gérer. »
Il y a pas mal de condescendance à regarder, de l’extérieur, cette profession comme médiocre, dépourvue de savoir-faire. Quel emploi, vu de loin, ne le serait pas ? On peut souhaiter la transformation, voire l’élimination, de ce mode de production. Mais ce mépris paraît un bien mauvais point de départ.
Quelle transformation ?
Quelle transformation de la filière souhaiteraient les aviculteurs ?
Une donnée concrète, au préalable : les trois aviculteurs interrogés ont, depuis leur installation, racheté des terres autour de leurs bâtiments. Physiquement, ils ont donc la possibilité de convertir leurs élevages industriels en « parcours libre » pour les poulets. En ont-ils, pour autant, l’intention ? Dans les tourments de la filière, et dans ses pertes financières, M. Chavatte paraît un peu perdu, cherche une sortie du tunnel. Il secoue la tête : « Bio, label, plein air, tout est pensable, tout est imaginable. Je n’exclus aucune piste. »
Éric Carette « pourrait le faire, [il a] le terrain à côté, mais ça ne [l]’intéresse pas ». Et de lister ses objections :
- La faible rentabilité du « poulet label » avec « 4 500 bêtes à la place de 17 000 », « trois bandes par an à la place de six », et « seulement 30 centimes de différence avec le poulet certifié ».
- L’étroitesse du marché : « Si tout le monde se met en label, y a pas la demande en face. Les cantines, les supermarchés, ils réclament du poulet pas cher. »
- Les investissements à réaliser avec « un quai de chargement bétonné », « la désinfection », « la lumière du jour partout ». Son âge importe, surtout : au bord de la retraite, sans héritier pour reprendre, il ne va pas se lancer « dans un plan de grands travaux. [Il] préfère laisser l’atelier vide ».
C’est Didier Goubil qui apporte le plus d’arguments. Et qui est le plus hostile à une reconversion : « La conjoncture volaille, le poulet dans les vingt ans à venir, c’est faramineux. C’est la première protéine à laquelle les pauvres ont accès. En France, on en consomme vingt kilos par an. Aux Etats-Unis, cinquante. En Chine, un kilo et demi. Ma fille a vécu là-bas, elle m’a dit en rentrant : “J’ai vu la volaille apparaître sur le marché chinois.” Donc, on doit se battre sur l’export. De toute façon, c’est la grande distribution qui gère tout ça : le tableau de bord, il est là. Si les consommateurs veulent du label, on le produira, pas de problème. Mais en réalité, c’est un petit marché qui s’amenuise. Les éleveurs de certifié tirent la langue. »
En responsable syndical, il ouvre des perspectives, non pour lui seul, mais pour la filière : « Il faut re-densifier. Le manque de compétitivité, il faut le travailler : on est 10% plus cher que les Allemands en sortie abattoir. On doit faire comme eux : des plus grosses exploitations, et fabriquer du poulet standard, pas toute une gamme. Concentrer davantage. »
Pas de quoi moquer ce discours.
D’abord parce que, au vu des dernières décisions, on va, en effet, vers plus de productivisme : l’avenir risque de lui donner raison. Ensuite, parce que cette conviction, Didier Goubil ne se l’est pas forgée en illuminé, isolé, dans son coin : ce « modèle allemand » résulte d’un véritable travail intellectuel, mené par un think tank (voir prochaine partie).
Dans ses certitudes, on instille néanmoins un doute : « Ce qui me gêne, dans votre raisonnement, c’est que votre père, et toute sa génération, ils ont imaginé un nouveau système, se sont adaptés à leur époque. Or, vous, ce que vous proposez, c’est juste de poursuivre comme avant, comme dans les années 1970, mais en plus gros…
C’est vrai, c’est vrai », hésite-t-il. Avant de se reprendre : « Ce qui nous enquiquine, c’est la pression mise sur l’environnement. Alors que l’endroit le plus pollué de France, c’est quand même Paris ! Le béton, les gaz d’échappement, les pics de pollution… Et nous, on vient nous embêter pour quelques algues vertes… »
Ce sont les penseurs de l’aviculture. Un institut où se fabrique le discours productiviste de la filière. Et quand une crise survient, ses propositions deviennent des solutions…
Les intellectuels de la volaille
« Vous êtes un peu le think tank de la volaille ? Disons qu’on est un lieu de concertation. On a un rôle d’animateurs, qui associons chercheurs, syndicats d’éleveurs, industriels… » Pascale Magdelaine est « experte permanente » à l’Itavi, l’Institut technique d’aviculture. En liaison avec l’Inra, la FDSEA, Doux, etc, cet organisme met ses « compétences au service des éleveurs et de l’industrie » – comme l’indique son slogan (en anglais).
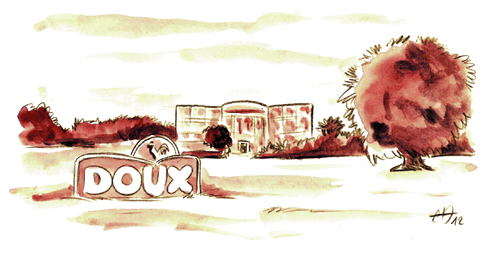
Horizon 2025
Pour son rapport « Prospective : la filière avicole à l’horizon 2025 », furent ainsi auditionnés des cadres du Crédit agricole, des responsables de la grande distribution, des économistes, des hauts fonctionnaires... Pour aboutir à ce constat : « La taille moyenne des ateliers français est de 17 000 animaux, alors que dans les autres pays européens, l’effectif moyen dépasse aisément 30 000 têtes, pour atteindre un maximum au Royaume-Uni de près de 94 000 têtes. »
D’où cette recommandation, réitérée dans (presque) chaque intervention : « À l’avenir, la spécialisation des exploitations et un agrandissement de la taille des ateliers apparaissent comme un moyen d’améliorer la compétitivité des élevages français. Le modèle idéal pour certains industriels serait celui de complexes permettant une optimisation logistique de la collecte, constitués de grosses unités d’élevage (4 000 mètres carrés de bâtiments), professionnelles et sécurisées, situées dans un rayon maximum de 50 à 70 kilomètres autour de l’abattoir. »
Jusqu’à bâtir le consensus : « L’ensemble des avis converge vers la nécessité d’une modernisation et d’une augmentation de la taille des élevages. »
Avec un modèle qui revient, constamment : « Notre degré de concentration est plus faible que celui observé dans les secteurs avicoles d’autres pays comme l’Allemagne… »
Les perroquets de l’Itavi
Quelle importance, me répliquera-t-on, que ce laboratoire inconnu ?
À quoi bon lui consacrer une page ?
Parce que ce sont les véritables penseurs de la filière. Qui ne se contentent pas de réfléchir dans une tour d’ivoire : par des salons, des newsletters, des colloques, leurs idées se diffusent dans les séminaires d’entreprise, dans les tables rondes syndicales, jusqu’aux cabinets ministériels.
Quand Didier Goubil (voir partie précédente) parle de « concentrer davantage », qu’ « on est 10% plus cher que les Allemands », qu’ « il faut des plus grosses exploitations », j’entends derrière la voix de l’Itavi. Idem lorsque Jacques Jaouen, le président de la Chambre d’agriculture du Finistère, s’exprime dans Ouest-France : « Pour que la Bretagne redevienne leader dans ses productions, il s’agit simplement de laisser l’entrepreneur investir, en adaptant la réglementation des ZES [zones excédentaires en azote à cause des rejets d’élevages] pour permettre les agrandissements… En redensifiant la production, le prix de la viande sortie abattoir serait plus proche du prix allemand, un de plus compétitifs en Europe » (4/7/12).
Ce discours, c’est à l’Itavi qu’il a largement été fabriqué.
Son diagnostic sert de base aux grandes orientations. Et ce, d’autant plus que les contestataires, en face, ne disposent pas des mêmes armes, ne s’appliquent pas au même travail – ni d’analyse, ni de rencontre, ni de restitution. Ce champ intellectuel, l’aviculture, est laissé libre à cet institut, militant du productivisme. Quand une crise survient, tel le choc Doux, ses propositions deviennent des solutions. Car oui, pour l’instant, on s’oriente bien, massivement, vers le « modèle allemand »… Avec un peu de bio à côté, pour la déco.

Deux obstacles : libre-échange et cordon bleu
L’Itavi, voilà des adversaires idéologiques. C’est dans leurs documents, néanmoins, qu’on trouvera la plus grande richesse de données, de statistiques. Pour repérer les obstacles sérieux, objectifs, à une reconversion de la filière, il nous faut donc partir de leur état des lieux.
Le premier obstacle, c’est le libre-échange.
« Il y a près de vingt ans, écrivent ces « experts », à l’occasion de la mise en place des accords de Marrakech, de nombreux travaux ont montré que le handicap principal de l’Europe vis-à-vis de l’Amérique du Sud résidait dans une main d’œuvre beaucoup plus coûteuse. »
D’après Pascale Magdelaine, l’une des expertes de l’Itavi, « il y a un écart de 30 à 35% à l’égard du Brésil. Ce qui est quand même énorme. Grosso modo, la moitié du déficit de compétitivité est dû au coût du travail, un quart aux normes environnementales, et le dernier quart aux aliments plus chers ». Et pour aggraver la distorsion, lorsque l’Europe édicte une modeste réglementation, elle ne « s’applique pas aux pays tiers ».
Cette difficulté, Fakir l’a – depuis longtemps – surmontée sans trembler : il faut du protectionnisme. Aucun progrès, social, fiscal, environnemental, n’est pensable en économie ouverte.
C’est un scénario envisagé par l’Itavi. Mais voilà qui paraît bien improbable à ces chercheurs : au contraire, l’Union européenne pèse à l’OMC pour « une conclusion ambitieuse du cycle de Doha ». Et Pascale Magdelaine de préciser : « L’Europe souhaite la prise en compte du bien-être animal, mais ça reste un vœu pieux. Elle ne cherche pas à défendre le marché intérieur, alors que les États-Unis n’importent pas un gramme de volaille. »
Député européen, José Bové espère encore, au téléphone : « Nous, on se bagarre pour des règles internes à l’Europe, qui soient également valables pour les importations…
- Donc, on conclut, vous réclamez du protectionnisme ?
- Non, c’est pas une forme de protectionnisme, c’est plutôt… (Rires dans le combiné.) Une défense de la souveraineté alimentaire. »
Le second souci, c’est la structure du marché.
Cernés par les militants, on est immergés, parfois, dans des milieux où l’un adhère à une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), l’autre bouffe bio, un troisième plante ses salades, etc. Voilà qui crée une illusion d’optique, entretenue par des médias prompts à vanter ces « nouveaux modes de consommation éthique ».
Mais la réalité s’avère bien éloignée : 85 % des achats de volaille se font en supermarché. Et le bio représente moins de 1% des abattages de poulet. Le labellisé, seulement 15 %. Plus inquiétant : cette proportion, loin de croître, diminue lentement. Pour quelles raisons ?
Conjoncturelle, d’abord, à cause de la crise économique. Dans les « raisons d’acheter un produit », d’après les enquêtes en 2000 du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), « le produit porte un label de qualité » devançait légèrement « le prix est compétitif » : 73% contre 72%. En 2008, la donne est bouleversée : le critère « de qualité » plonge à 58 %, contre « le prix » qui grimpe à 79 %. Depuis, le mouvement ne fait que se confirmer.
Il existe une cause structurelle, ensuite. Sur le « poulet entier », le « label rouge » résiste bien, avec près de la moitié des ventes : là, pour faire cuire sa volaille à la broche, le consommateur veille à la qualité. Mais justement, ce marché décline. Alors que la « découpe » (les cuisses seulement, ou les ailes) et les « produits transformés » (escalope panée, cordons bleus) s’étendent. Et sur ces segments-là, le label est largué : « Quand on mange des nuggets, résume Pascale Magdelaine, on ne pense même plus au poulet derrière. La mère de famille pressée ne va pas faire attention au label. »
Cet obstacle, sans doute peut-on le surmonter, par des lois, par des incitations, par des subventions, par des interdictions, bref, par une volonté politique, avec un plan dans la durée. Mais on doit l’affronter. S’y confronter. Ne pas le balayer d’un revers de « nous, on a des alternatives, mais évidemment les agriculteurs n’en veulent pas ». Proclamer que la « filière peut se convertir facilement », c’est illusoire pour les producteurs et les salariés. Qui, d’ailleurs, ne se laissent guère prendre à cette illusion…
L’élevage de poulets était détruit, au Cameroun. Mais un homme est arrivé : Bernard Njonga. Après une âpre campagne, son association l’a emporté sur la mondialisation. Interdit, désormais, d’importer des poulets congelés…
La voie camerounaise
En 1994 sont signés les accords de Marrakech. Un peu plus au sud, au Cameroun, l’effet ne se fait pas attendre : les importations de poulets congelés sont multipliées par huit en 1995. A nouveau par deux, en 1996. Encore par quatre en 1997. Toujours par deux en 1998. Puis par trois durant les cinq années qui suivent. Les chiffres sont vertigineux : en moins d’une décennie, ces importations sont multipliées par 370 ! C’est dire si la production locale n’est pas décimée, mais liquidée.
« J’ai commencé l’élevage en 1993 », témoigne Jean Wakap dans la documentation réunie par Bernard Njonga. L’entretien se déroule dans sa ferme vidée, à Bangoua. « La viande de poulet était incontournable dans les cérémonies autour de moi, et la demande en poulets sur le marché était grande. Avec mes petits moyens, j’ai démarré par une centaine de poussins que j’élevais dans une chambre de ma maison. Après, je suis passé à deux cents, puis à trois cents. Comme l’affaire rapportait, j’ai construit ce bâtiment que vous voyez en 1996, avec certes des bambous raphia, mais une ferme assez solide quand même. J’y élevais mes 300, 400 et parfois 500 poussins. Quand les poulets étaient à maturité, les clients, pour la plupart des gens qui organisaient des funérailles au village, venaient les chercher sur place et j’écoulais les restes sans peine au marché. Bref, je m’en sortais. Début 1999, j’ai constaté qu’à l’approche des grandes cérémonies, les organisateurs ne nous sollicitaient plus trop pour les ravitailler en poulets. C’est là que j’ai vraiment découvert les poulets importés. En quelque temps, c’est devenu une invasion au village. Les femmes les apportaient dans les cartons de Douala ou de Yaoundé pour les faire frire et les servir aux invités. J’ai assisté impuissant à la mort de l’élevage dans mon village. Je n’ai rien pu faire. »
Des milliers de paysans ont subi ce calvaire : la fin du « poulet bicyclette », apporté au marché sur des vélos.

Jusqu’à l’OMC
Que restait-il à espérer, sur ce champ de ruines ? Rien.
Sauf qu’un homme était là : Bernard Njonga. Et que cet homme n’est pas seul.
Ingénieur agronome, ayant étudié puis exercé en France, en Californie, il était revenu dans son pays. « Mais je ne souhaitais pas m’enfermer dans un laboratoire. Je me sentais plus à l’aise aux côtés des paysans, sur le terrain. » Il lance alors, dans les années 1980, un service d’appui aux initiatives locales : « Il n’existait pas d’organisation agricole. Alors, pour mieux les accompagner, j’ai aussi édité le journal La Voix des paysans. Nous les aidions notamment pour faire du petit élevage, ce qui marchait très bien. » C’est en première ligne qu’à partir de 1999, il assiste à l’envahissement des poulets congelés – bretons, allemands, brésiliens. « Pendant trois ans, jusque 2002, nous avons essayé de parler, mais les politiques ne nous comprenaient pas. » S’appuyant sur une nouvelle structure, l’Association citoyenne de défense d’intérêts collectifs (Acdic), il se lance alors dans la bataille.
Avec une enquête, d’abord. Avec une équipe, il interroge Jean Wakap et plus de mille autres éleveurs ! Il questionne les douanes et les ministères, ainsi que les importateurs. Estime, avec des économistes, les pertes en devises et en emplois. Il prélève même, sur les marchés, deux cents échantillons de poulets congelés – qu’il envoie au centre Pasteur en France, contre 9 millions de francs CFA, pour démontrer la présence d’agents pathogènes. Et pour finir, il consulte les registres des dispensaires de Douala et Yaoundé, pour lier la fréquence des maladies aux microbes sur le poulet ! De cette investigation, il tire un rapport d’étude de 300 pages qui devient la base, au Cameroun, pour comprendre la filière avicole.
Il renforce ensuite son organisation. L’Acdic compte alors 11 900 membres, des paysans bien sûr, mais aussi des consommateurs dans les villes, des fonctionnaires. Mieux : se modernisant, il lance « Acdic-infos », un service d’information par SMS, avec des messages de 160 signes maximum. Avec 190 000 abonnés, c’est le service de ce genre le plus lu au Cameroun.
Ainsi armé, vient la campagne elle-même : « On a reçu un soutien international, avec la présence de José Bové. Il est extrêmement populaire, ici. La première fois, ça a donné une manifestation formidable. Du coup, la deuxième fois, le gouvernement lui a interdit l’accès, il est resté bloqué à l’aéroport. Mais l’effet a été encore pire pour eux. » Sur le plan diplomatique, Bernard Njonga se rend alors à Genève, au siège de l’Organisation mondiale du commerce. Il y rencontre son président, Pascal Lamy. Il intervient par trois fois en assemblée générale. Et il convainc les libre-échangistes eux-mêmes que le poulet, au Cameroun, réclame sans doute une exception.
Virage protectionniste
Voilà qui paye : l’État camerounais prend des mesures. Il impose des quotas. Élève les droits de douanes de 23 à 43%. Le tout s’accompagne, côté citoyens, d’une propagande efficace : d’après un sondage réalisé en juillet 2005 par l’Acdic elle-même, « 66,5% des consommateurs des villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam sont au courant de la campagne », et « 86,2% préfèrent le poulet local au poulet congelé ».
Dès le virage protectionniste, les résultats sont spectaculaires : « L’aviculture camerounaise connaît une progression de production et de vente de 30 % par an », « le nombre de petits aviculteurs locaux augmente de 20% par an », « au moins deux unités d’abattage et deux chaînes de froid sont installées au Cameroun ». Et désormais, « la production nationale couvre les besoins du pays ».
Jusqu’à cette victoire finale : « En 2006, nous avons obtenu l’interdiction des importations de poulets congelés. Qui sont revenues, aujourd’hui, à peu près à leur niveau d’avant Marrakech. C’est-à-dire juste de quoi servir les expatriés. »
Qui ne sauraient survivre, en Afrique, sans poulet breton !
Dans le dossier du poulet, le Cameroun est donc revenu du néant. Contre les forces unies de la mondialisation, la « solution citoyenne » s’est imposée. Mais pas par hasard, ou par la seule vertu d’idées généreuses. Non, via une méthode, classique à vrai dire : L’enquête, pour avoir des idées justes.
La propagande, pour conquérir les esprits.
Le rapport de forces, pour imposer nos mesures.
Que d’illusions l’on nourrit si l’on espère, par la grâce d’un blog, ou d’un communiqué, convertir une filière, voire changer la société, sans en passer par ce long chemin…
La bataille du poulet n’a pas eu lieu...
À l’inverse du Cameroun, il suffisait chez nous de savoir ça. Qu’aucun de nos appels dans la gauche bretonne ne nous mènerait à un aviculteur de chez Doux, et la suite de l’histoire était écrite. Autour de cette affaire, il n’y a même pas eu de bataille, seulement des coups de colère balancés dans la presse, ou sur des blogs. Nul bras de fer, entre les productivistes et les autres, les gentils. Les uns étaient organisés, avec un plan pour « la filière avicole à l’horizon 2025 », les autres, marginalisés, avec de jolies déclarations de principe en bandoulière. C’était plié d’avance.
On peut bien dénoncer la puissance de la FNSEA, mais il faut surtout s’en prendre à notre propre faiblesse. A notre maigre implantation dans ce secteur, et ailleurs. A notre cercle trop fermé, voire un peu consanguin, sphère militante qui se vit comme assiégée, perdante d’avance – et le « nous », ici, n’est pas une figure de style : c’est d’une autocritique qu’il s’agit. D’entrevoir nos propres limites pour les dépasser. Pour qu’à la prochaine affaire Doux, pour qu’aux futurs soubresauts de la zone euro, la bataille idéologique, sociale, politique ait lieu. Et qu’on remporte la victoire, en suivant le « modèle camerounais »…