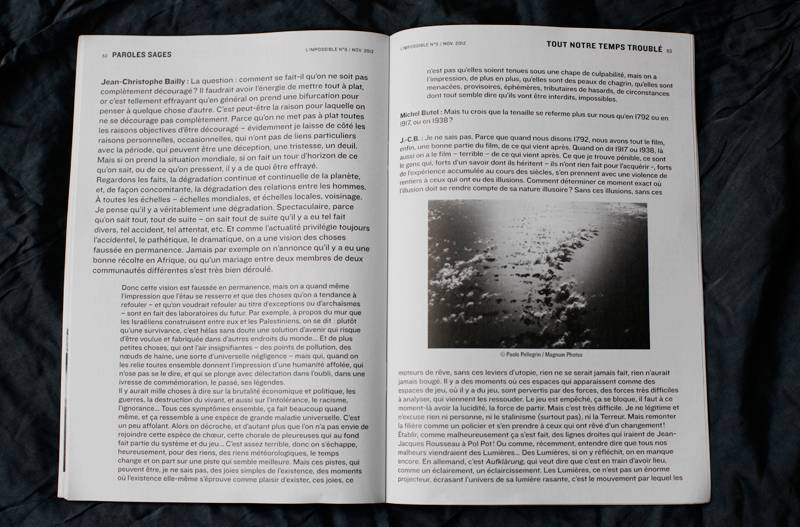
Tout notre temps troublé
Michel Butel et Jean-Christophe Bailly
— Texte paru dans L'Impossible n°9, novembre 2012
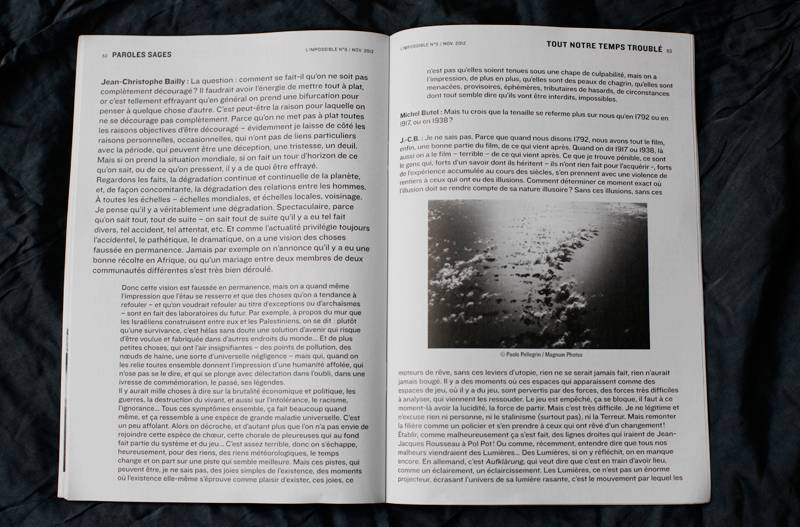
Jean-Christophe Bailly : La question : comment se fait-il qu’on ne soit pas complètement découragé ? Il faudrait avoir l’énergie de mettre tout à plat, or c’est tellement effrayant qu’en général on prend une bifurcation pour penser à quelque chose d’autre. C’est peut-être la raison pour laquelle on ne se décourage pas complètement. Parce qu’on ne met pas à plat toutes les raisons objectives d’être découragé – évidemment je laisse de côté les raisons personnelles, occasionnelles, qui n’ont pas de liens particuliers avec la période, qui peuvent être une déception, une tristesse, un deuil. Mais si on prend la situation mondiale, si on fait un tour d’horizon de ce qu’on sait, ou de ce qu’on pressent, il y a de quoi être effrayé.
Regardons les faits, la dégradation continue et continuelle de la planète, et, de façon concomitante, la dégradation des relations entre les hommes. À toutes les échelles – échelles mondiales, et échelles locales, voisinage. Je pense qu’il y a véritablement une dégradation. Spectaculaire, parce qu’on sait tout, tout de suite – on sait tout de suite qu’il y a eu tel fait divers, tel accident, tel attentat, etc. Et comme l’actualité privilégie toujours l’accidentel, le pathétique, le dramatique, on a une vision des choses faussée en permanence. Jamais par exemple on n’annonce qu’il y a eu une bonne récolte en Afrique, ou qu’un mariage entre deux membres de deux communautés différentes s’est très bien déroulé.
Donc cette vision est faussée en permanence, mais on a quand même l’impression que l’étau se resserre et que des choses qu’on a tendance à refouler – et qu’on voudrait refouler au titre d’exceptions ou d’archaïsmes – sont en fait des laboratoires du futur. Par exemple, à propos du mur que les Israëliens construisent entre eux et les Palestiniens, on se dit : plutôt qu’une survivance, c’est hélas sans doute une solution d’avenir qui risque d’être voulue et fabriquée dans d’autres endroits du monde… Et de plus petites choses, qui ont l’air insignifiantes – des points de pollution, des nœuds de haine, une sorte d’universelle négligence – mais qui, quand on les relie toutes ensemble donnent l’impression d’une humanité affolée, qui n’ose pas se le dire, et qui se plonge avec délectation dans l’oubli, dans une ivresse de commémoration, le passé, ses légendes.
Il y aurait mille choses à dire sur la brutalité économique et politique, les guerres, la destruction du vivant, et aussi sur l’intolérance, le racisme, l’ignorance… Tous ces symptômes ensemble, ça fait beaucoup quand même, et ça ressemble à une espèce de grande maladie universelle. C’est un peu affolant. Alors on décroche, et d’autant plus que l’on n’a pas envie de rejoindre cette espèce de chœur, cette chorale de pleureuses qui au fond fait partie du système et du jeu… C’est assez terrible, donc on s’échappe, heureusement, pour des riens, des riens météorologiques, le temps change et on part sur une piste qui semble meilleure. Mais ces pistes, qui peuvent être, je ne sais pas, des joies simples de l’existence, des moments où l’existence elle-même s’éprouve comme plaisir d’exister, ces joies, ce n’est pas qu’elles soient tenues sous une chape de culpabilité, mais on a l’impression, de plus en plus, qu’elles sont des peaux de chagrin, qu’elles sont menacées, provisoires, éphémères, tributaires de hasards, de circonstances dont tout semble dire qu’ils vont être interdits, impossibles.
Michel Butel : Mais tu crois que la tenaille se referme plus sur nous qu’en 1792 ou en 1917, ou en 1938 ?
J.-C.B. : Je ne sais pas. Parce que quand nous disons 1792, nous avons tout le film, enfin, une bonne partie du film, de ce qui vient après. Quand on dit 1917 ou 1938, là aussi on a le film – terrible – de ce qui vient après. Ce que je trouve pénible, ce sont le gens qui, forts d’un savoir dont ils héritent – ils n’ont rien fait pour l’acquérir -, forts de l’expérience accumulée au cours des siècles, s’en prennent avec une violence de rentiers à ceux qui ont eu des illusions. Comment déterminer ce moment exact où l’illusion doit se rendre compte de sa nature illusoire ? Sans ces illusions, sans ces moteurs de rêve, sans ces leviers d’utopie, rien ne se serait jamais fait, rien n’aurait jamais bougé. Il y a des moments où ces espaces qui apparaissent comme des espaces de jeu, où il y a du jeu, sont pervertis par des forces, des forces très difficiles à analyser, qui viennent les ressouder. Le jeu est empêché, ça se bloque, il faut à ce moment-là avoir la lucidité, la force de partir. Mais c’est très difficile. Je ne légitime et n’excuse rien ni personne, ni le stalinisme (surtout pas), ni la Terreur. Mais remonter la filière comme un policier et s’en prendre à ceux qui ont rêvé d’un changement ! Établir, comme malheureusement ça s’est fait, des lignes droites qui iraient de Jean-Jacques Rousseau à Pol Pot ! Ou comme, récemment, entendre dire que tous nos malheurs viendraient des Lumières… Des Lumières, si on y réfléchit, on en manque encore. En allemand, c’est Aufklärung, qui veut dire que c’est en train d’avoir lieu, comme un éclairement, un éclaircissement. Les Lumières, ce n’est pas un énorme projecteur, écrasant l’univers de sa lumière rasante, c’est le mouvement par lequel les choses, et le rapport de l’homme aux choses, s’éclaircirait, se ferait dans une clarté de plus en plus grande. Et en français, c’est les Lumières, au pluriel. Les Lumières, j’ai toujours pensé que c’était justement toutes sortes de projecteurs, toutes sortes d’intensités différentes les unes des autres : de la petite flamme, presque d’allumette, à quelque chose qui serait de l’ordre du foudroiement. L’intensité d’ailleurs est une notion élastique, parce qu’en termes de mesure, la flamme de l’allumette est minuscule, mais si, dans une pièce obscure, je craque cette allumette, cela suffit à créer un point d’intensité, éphémère, mais vrai. Et les Lumières pour moi, ça a toujours été le mouvement par lequel les points d’intensité de l’intelligible se reliaient les uns aux autres et où ces liaisons formaient justement une structure où il y avait du jeu, quelque chose de souple, quelque chose de sautillant. Ce qui nous menace aujourd’hui, c’est tout ce qui tente d’empêcher ça, de le bloquer, de faire que les points d’articulation deviennent des points de soudure.
M.B. : C’est difficile de créditer Walter Benjamin, ou même Saint-Just, d’autre chose que d’une illusion triste. Difficile d’imaginer qu’ils n’ont pas été dans la tenaille tout de suite - bien avant le silence (de Saint-Just) ou le suicide (de Benjamin) – très tôt, la tenaille fut peut-être aussi impressionnante pour eux que la nôtre maintenant.
J.-C.B. : Bien sûr. Saint-Just habitait à l’intérieur d’une tragédie. Pour nous, ce n’est pas pareil. La situation tragique de l’époque de la Révolution française, ou la situation fermée qui précède, ou qui accompagne la montée vers la Seconde Guerre mondiale, et qui se renforce avec cette guerre elle-même, ce sont des situations beaucoup plus terribles qu’aujourd’hui.
Cela dit je pense que les raisons de craindre pour l’avenir même des choses auxquelles on tient (qui sont justement ces libres structures, ces lumières multiples sur des choses multiples, ces lumières qui sont l’occasion de l’émotion, de la beauté) sont réellement de solides raisons. Des raisons solides, oui. Je ne veux rien dire d’autre. Une telle inquiétude ne doit jamais, à mon sens, sous-entendre ou laisser entendre qu’il y aurait jadis eu un « bon vieux temps ». Un « bon vieux temps » pour la pensée, un « bon vieux temps » pour les choses. Il y a des moments historiques qui sont des moments de cristallisation, d’autres, des moments de venue, des moments de montée, et les Lumières, justement, ce serait un de ces moments. Mais il n’y a aucun « bon vieux temps ». Les idées qui nous permettent de fonctionner, comme l’idée démocratique, sont nées dans des mondes violents, tourmentés. L’idée du contrat social est née du fait même de la violence, de ce qui interdisait ce contrat.
À aucun moment il n’y a eu de « bon vieux temps », mais il y a à chaque époque une distance qui s’invente entre elle et un rêve qu’elle est capable de faire et qui se prolonge au-delà d’elle. Or je trouve qu’aujourd’hui, le rêve qui fait notre époque n’est pas brillant. Là, il y a une vraie différence par rapport à Saint-Just, à Benjamin, etc., c’est qu’on se trouve dans une époque qui ne rêve pas, ou ne rêve plus. Et c’est extrêmement fort, ce silence, ça informe tout le paysage. Je me suis longuement promené au Creusot, qui a été un des fleurons de la France industrielle : un petit village où il y avait une verrerie au XVIIe siècle devient cet énorme site sidérurgique, devient célèbre comme tel, c’est-à-dire à la fois comme lieu de la production, lieu d’une espèce de magie industrielle, avec le gros marteau-pilon, dont les ouvriers sont fiers, dont les ingénieurs sont fiers, et en même temps comme un lieu qui devient l’un des points nodaux de la lutte des classes en France, avec de très grandes grèves, de très grandes luttes. Donc une épopée industrielle avec des fumées, des tensions, de la vie – une activité permanente. Les gens habitaient une forge, ils étaient tous de petits Vulcains, et ils étaient fiers d’être ces petits Vulcains. Quand on visite le musée, on voit les luttes des classes, le rêve d’un monde meilleur, et même dans les plans, les dessins, des ingénieurs, on voit un côté Jules Verne1 … On voit que ce lieu qui était une énorme usine réelle, était aussi une énorme fabrique de rêve. On était à l’intérieur du capitalisme, aliénation comprise, et en même temps, on était à l’intérieur d’une fabrique de sortie. La sortie était rêvée en permanence.
Or, on a l’impression que le vieux monde européen ne fait plus ce travail (de rêve, de sortie). La brutalité de la production est évacuée, elle a disparu. Il y a encore des usines, mais ce n’est plus pareil. C’est historiquement datable, lié à cet événement récent, la fermeture de la dernière mine de charbon en France. Un âge se termine. Se terminerait comme ça. Mais cet âge, ç’aurait été d’abord une certaine façon de rêver, peut-être en noir et blanc. Un certain âge du cinéma. Et s’il fallait caractériser notre époque, il faudrait dire qu’elle est celle qui sait mal rêver, qui ne rêve presque plus. Bien entendu, chaque individu, dans cette époque, rêve. Non seulement en tant que sujet psychique, mais même au sens où j’en parlais, au sens d’une espèce d’élaboration solitaire d’évasion – un désir de sortie, d’ouvrir la fenêtre, de passer par la chatière. Chacun le fait plus ou moins. Mais les rêveries sont dissociées. Ce serait très caractéristique de ce moment que l’on vit, et je pense que c’est un facteur qui peut s’aggraver, aller dans le sens d’un découragement plus facile. On le voit très bien, par exemple, dans la sphère intellectuelle et dans la sphère des arts (elles se recoupent mais ne sont pas identiques), où règne une extraordinaire atomisation, une extraordinaire dissémination des rêveries et des pensées.
(…)
Je crois aussi qu’on devrait commencer à se déshabituer d’un certain nombre d’outils et qu’il n’est pas normal de vivre dans un monde entièrement structuré par des technologies qu’on ne domine pas, qu’on ne comprend pas. On vit entourés d’objets qu’on est incapables de réparer. Incapables de réparer, et incapables de fabriquer. C’est assez incroyable… Il y a trente, quarante ans c’était dans nos débats, c’était là, l’ethnologie, l’anthropologie. Par exemple la méditation à partir de ce que disait Pierre Clastres des Indiens : une petite bande de gens vouée à la disparition, dont la société, l’existence, était structurée à partir de deux objets : l’arc pour les hommes, le panier pour les femmes. C’étaient des objets extrêmement chargés, car rien n’est simple dans le simple. Ce très peu, cette quasi austérité/pauvreté de ces sociétés-là, il ne s’agit pas d’en faire l’éloge, mais simplement de l’avoir à l’esprit comme un exposant mathématique par rapport à la quantité d’objets que nous avons, ou qui nous ont. Un univers entier fait d’individus vivant d’objets que certains fabriquent, et qu’aucun d’entre eux ne maîtrise, c’est un monde en vérité absurde et étrange. Sans parler des armes, ou des médicaments. On peut penser au très beau tableau de Poussin qui est au Louvre : Diogène voit un type qui boit de l’eau dans ses mains, et constate que dans son travail d’austérité, il avait encore conservé la coupe, le luxe de la coupe, et qu’il pouvait faire mieux. Alors, sans dire trop de bêtises, et sans être du tout nostalgique de quoi que ce soit, je pense que ce serait bien si une espèce d’utopie pouvait activer un devenir-Diogène sociétal. Le désir d’un devenir-Diogène chez les individus. Pas pour être plus authentiques ou je ne sais quoi, non, mais pour être moins encombrés : plus libres aussi.
Les livres d’histoire sur la ville, et notamment sur Paris, m’ont fait réfléchir à ça : si démunis, ou si riches, qu’on ait pu être autrefois, on n’était branché à rien, on ne dépendait pas de réseaux. Puis arrivent l’eau et le gaz à tous les étages, puis arrive l’électricité, puis le téléphone et ça n’arrête plus. L’une des caractéristiques de ces dernières années, c’est que même en mouvement, dans la rue, on peut rester branché. C’est le cas de tout ce qui permet d’écouter de la musique enregistrée en marchant, et donc de ne plus être attentif à la rumeur réelle de l’espace dans lequel on se déplace. Le téléphone portable est venu perfectionner, si on peut dire, cette constante d’inattention. Je me souviens, l’an dernier, je rentrais avenue de Versailles, la nuit, tous les gens que j’y ai croisés ou bien avaient une laisse avec un chien, ou bien téléphonaient avec leur portable, en tous cas tous, ils tenaient à quelque chose, la fameuse avenue de Versailles, très belle par cette nuit de mois de juin, personne ne la voyait. Personne ne la regardait. On avait l’impression que ces gens vivaient dans une sorte de beauté indue. Qui ne leur est pas due. Voilà ce que j’ai pensé.
M.B. : Tu ne joues jamais à chercher à penser l’éloge : éloge du portable, éloge de ce dont on devrait se débarrasser ?
J.-C.B. : Non. Mais je voudrais être clair. Les poutres apparentes, les bougies, le vieux vélo, le bon pain, ne constituent pas un monde de plénitude qu’il conviendrait d’opposer à un monde d’objets indignes parce que plus récents, plus neufs. Je pense exactement le contraire et, de toute façon, le processus à l’issue duquel on trouve les objets les plus sophistiqués commence dès l’invention du feu.
Par contre, je pense qu’il faudrait choisir, et pas systématiquement tout accepter, pas systématiquement se laisser encombrer par des tas de choses inutiles. Par exemple, imaginons qu’il n’y ait plus d’avions. Les principaux maux de notre époque ne disparaîtraient pas, mais qu’il s’agisse du tourisme de masse, des expéditions militaires, des bombardements, la disparition de l’aviation serait un grand bienfait. On mettrait trois semaines pour aller au Japon… Et alors ?
Imaginons : plus d’avions du tout, et un an sans nouvelles. Pas de nouvelles. Aucune nouvelle. On ne sait pas ce qui se passe. La plupart des gens diraient : « Oh là là ! Mais ils vont s’en donner à cœur joie ! » À mon avis, non, pas nécessairement. Au contraire. Dans le système actuel, si ça ne se sait pas, ça ne vaut pas le coup de le faire.
M.B. : Tu crois qu’on peut penser le pire ?
J.-C.B. : Oui, je pense. On peut le redouter, et presque le modéliser : une humanité de douze milliards d’habitants se battant autour des points d’eau qui restent…
Le plus terrible, c’est cette absence de soulèvement, qui serait une rêverie pour des convergences, des départs ou des levées. Par exemple, récemment, la ville de Montreuil 2 s’est comportée comme marieuse, en quelque sorte, entre des Vietnamiens et des Maliens, pour une technique agricole. Une ville de la banlieue parisienne, une communauté paysanne du Mali, et une communauté paysanne du Vietnam, ça se met ensemble et ça fabrique quelque chose. On rêve d’une espèce de merveilleux pédalier qui ferait de tels enclenchements se démultiplieraient, et que soudainement l’humanité verrait devant elle l’espace se dégager, s’ouvrir.
M.B. : Oui, mais là ce sont des souplesses. Et quand tout est dur ? Est-ce qu’on peut penser l’intelligence d’une situation quand elle est terrible ? Est-ce qu’on peut penser au-delà de Hitler ou de Staline quand on est contemporain et qu’on voit arriver les choses ?
J.-C.B. : Je ne sais pas, certains l’ont fait, ils ont vu arriver les choses, justement. Si on prend cette période et ces noms-là, Hitler, Staline, il y a ce qui, dans l’histoire, malgré tout fait leçon, une leçon qui doit bien sûr être réécrite, revisitée, retravaillée, fouillée chaque jour. Une espèce d’archéologie vivante, qui n’est absolument pas le devoir de mémoire, mais qui est, disons, la conscience historique, en lutte avec les procédures inverses qui seraient les procédures d’oubli, d’enfouissement.
Je prendrai un exemple, tiré du plus profondément noir de la Seconde Guerre mondiale. On connaît Izieu, cette colonie de vacances dans les Préalpes, dans un site extrêmement beau, où pendant la guerre des enfants juifs ont pu vivre, survivre, grâce à un réseau, disons, de connivences. Et puis un jour, ils ont été donnés, dénoncés. Ils ont tous disparu, la plupart ont été tués à Auschwitz.
On visite ce lieu, qui est le contraire d’un camp, puisque c’est un lieu de bonheur – où il n’y avait certes pas seulement du bonheur puisque ces enfants vivaient hors des conditions normales de l’enfance, mais quand même. Et on voit très bien sur tous les documents, à l’intérieur de la folie et de la terreur de cette époque-là, une bulle de… oui, de bonheur, de connivences. On voit les dessins. On voit les bandes : ils faisaient un petit cinéma en faisant défiler ces bandes devant un abat-jour. C’est ça qu’on voit. Et le deuil de ces gens qu’on n’a pas connus –le deuil qu’on éprouve là de ces êtres, de ces enfants, il est absolu.
Au bout d’une heure qu’on passe là, on est familier des lieux, parce que c’est petit. On est familier de ces gamins, on connaît leurs noms, on les reconnaît sur les photos à force de les avoir vus. J’en ai parlé à la directrice de ce lieu, qui y vit et y travaille. Pour elle c’est très étrange, cette familiarité ressentie au bout d’une heure, pour elle et les gens qui y travaillent, cette familiarité est totale, et par moments, c’est presque un effort de penser qu’ils sont morts. Mais comment expliquer que le deuil est total, et que quelque chose d’autre existe ? Et que dans le témoignage, il y a l’horreur mais c’est comme si cette bulle de bonheur… Je n’arrive pas à l’expliquer, c’est étrange, mais dans cette familiarité qu’on a avec eux, dans la connaissance de leurs noms, de leurs visages, il y a quelque chose qui pourrait faire dire… Rien d’autre que leurs noms et leurs photos, on a rien d’autre que ça. Mais c’est terrible, ce que je veux dire : ce n’est pas rien. Un nom, un visage. La ténuité du nom, la ténuité du visage 3.
C’est quelque chose d’extrêmement difficile à penser parce que ça pourrait être scandaleux, et je ne sais pas si je parviens même à le faire comprendre, à le dire.
J’ai été bouleversé par les lettres de Gertrud Kolmar 4 : Gertrud Kolmar, est détruite, elle est assassinée. Mais le simple fait qu’il y ait son visage, ses lettres… Jamais, jusqu’à son dernier souffle, elle n’accorde à ses ennemis, à ses bourreaux, le droit de la subvertir complètement, jamais elle ne leur accorde le droit de subvenir à la totalité de sa souffrance. Elle est capable jusqu’à la dernière minute de souffrir pour autre chose. Ce n’est presque rien, mais c’est le noyau dur, je crois, de quelque chose qui est je ne dirais pas « humain » d’ailleurs, parce que c’est quelque chose qui évoque la façon dont les bêtes savent mourir.
M.B. : Je pense que ce que tu dis : quand ils les tuent et s’acharnent à les tuer, apparaît le nom et le visage, c’est-à-dire l’ineffaçable absolu.
J.-C.B. : Ce sont des domaines où la parole n’est pas très sûre d’elle-même. En effet, on peut aussi bien dire « effaçable », qu’ « ineffaçable ». Et c’est là, justement, qu’il devient insupportable, le « devoir de mémoire », avec lui c’est un peu comme si le travail avait été fait : il y aurait un bloc de mémoire, comme un médicament, vous en prenez un le matin, un le soir. Mais c’est absurde : le médicament n’existe pas. Il faut le fabriquer.
La mémoire m’apparaît de plus en plus comme la façon dont la dimension du temps, qui est celle de la vie, est percutée par chaque individu. La mémoire n’est pas du tout comme un grenier, une réserve, elle est la condition même à partir de laquelle il y a pensée.
La pensée est un opérateur, mais la mémoire, c’est ce qui dispose les lieux de telle manière qu’il puisse y avoir opération, intelligibilité, comparaison, projection. Et la façon dont ça se promène, dont ça se déroule, la façon dont la mémoire rencontre en elle des éléments flottants qui se libèrent on ne sait trop comment, la façon dont elle rencontre aussi des dépôts qui ne sont pas à l’intérieur d’elle-même, mais dans le monde… À Izieu, il y a quelque chose qui est déposé. Une sorte de poussière, la trace d’un pas dans la poussière, pas plus que ça. Mais cette trace de pas dans la poussière, quand on la voit, elle établit un régime d’associations qui a toute la puissance d’un roman à venir. Le « misérable miracle », pour détourner Michaux, est là : on croise sans arrêt de la poussière de fantôme, de la poussière de fantôme d’avenir. C’est quand même ce que Benjamin a été le premier à apercevoir.
C’est parfois de l’ordre de la sensation. Ce qu’on éprouve dans un endroit où quelque chose a eu lieu : comment cela se fait-il ? Comme s’il n’y avait ni insignifiance, ni indifférence. Il n’y a que signifiance, et par conséquent différence, tout le temps. On est devant quelque chose qui se promène entre la surface, le volume, et la mémoire elle-même. Si on essayait d’en faire une carte, on verrait que c’est une carte gondolée, tellement gondolée que ce n’est pas une carte mais un ruban de Moebius, et tellement un ruban de Moebius que ça a fait le tour du monde. Et on verrait qu’on est au milieu, et puis que non, on n’est pas au milieu, parce qu’en même temps c’est en nous. Ce que je dis au fond, ce n’est rien d’autre que ce que dit la fameuse phrase d’Amadou Hampâté Ba : « Quand un vieillard meurt, une bibliothèque disparaît. » Oui, ce n’est rien d’autre, mais c’est extraordinaire. Le monde devient extraordinaire si on prend la rue Meslay, si on dit : à 18 h 52, il y a 42 passants dans la rue Meslay, donc il y a 42 bibliothèques rue Meslay. On aimerait pouvoir le penser.
Qu’est-ce qui travaille davantage que la mémoire ? Même quand on dort elle travaille. Même quand on dort, il y a quelqu’un. Il y a quelqu’un qui est là, qui veille. C’est qui ? Ce n’est pas nous. Ce n’est pas moi. Ce n’est même pas un sujet. C’est la veilleuse. Le sommeil, c’est la certitude d’être vivant, parce que c’est peut-être là qu’on en est le plus sûr : une veilleuse du monde est allumée en nous. C’est pour ça qu’il y a quelque chose qui m’agace dans la psychanalyse : pour elle, ce n’est pas la veilleuse du monde.
Je voudrais raconter ça : une petite illustration, une petite vignette. Je vais malheureusement assez souvent chez le dentiste. Là, je bénéficie des dernières sophistications technologiques, avec les radios des dents, des simulations, des lasers, des tas de machins extravagants, qui sont plutôt amusants d’ailleurs. Mais enfin quand même, ce n’est pas devenu pour autant une partie de plaisir, et puis surtout, c’est du temps perdu. Alors, sachant qu’on va perdre une heure, comment ne pas la perdre complètement ? Eh bien chez ce dentiste où je vais il y a quelque chose qui m’aide énormément dans la salle d’attente, au point que je ne m’ennuie pas du tout : il y a un aquarium. Un aquarium très beau, un aquarium d’eau de mer, avec de très jolis poissons bien sûr, mais surtout des coraux vivants, des sortes de couronnes d’antennes soyeuses et souples qui bougent, caressées, frôlées par les poissons qui passent. Et ce qui est extraordinaire, si on regarde ça un peu attentivement, c’est qu’il y a une contamination. Ils vivent dans un autre temps. À l’intérieur de cette boîte, il se passe des choses d’un univers qui n’est pas le mien. Bien que ce soit sous mes yeux. À un mètre de moi, il y a un univers qui n’est pas le mien, où des « vivants » – des vivants, je ne peux pas dire autrement – se promènent, évoluent, palpent. Pour l’essentiel, c’est ce qu’ils font : ils palpent. Donc, à l’intérieur de ce petit mètre cube, ils sont dans une exploration éternelle, ou dans une attente, un suspens. C’est un peu comme une maquette d’éternité, cet aquarium, une maquette de l’éternel retour du même. Trois semaines après, un an après, les poissons font les mêmes danses. Bien entendu, ces poissons, ces coraux sont périssables, mais quand même, le temps dans lequel ils sont est un temps où la tension qu’il y a entre la fluidité et le rythme semble résolue. C’est pour ça que ça ressemblerait à quelque chose qui s’appellerait l’éternité. Comment s’ennuyer devant une petite maquette d’éternité ? On regarde, on regarde et on s’abîme, on s’abîme dans cette pensée, dans cette extraordinaire fluidité.
Je crois que la mémoire est comme un aquarium invisible. Une piscine, une citerne où il y aurait des sortes de coraux comme ça, en attente, des tas de poissons, des milliers, des centaines de milliers de poissons, qui se promènent dans une sorte d’invisibilité. Et par moment, de ces bancs, des éléments se détachent parce qu’un reflet de l’autre monde, du monde extérieur, du monde « vrai », est venu les appeler, les éveiller.
Il y a là pour moi des possibilités de divagation infinies, qui en effet, ont une fonction de distraction et d’évasion, mais qui sont toujours au travail, toujours à l’œuvre lorsqu’il s’agit de l’éveil, lorsqu’il s’agit de l’intelligibilité du passé ou du deuil. C’est seulement avec ces connexions-là, telles qu’elles sont libérées dans le monde fluide de la mémoire, qu’on peut avancer, voir, voir mieux, voir plus loin.
Cet entretien a été réalisé en mai 2004 pour un journal qui n’a jamais vu le jour.
Il a été relu en 2012.
· 1. On voyait, faudrait-il dire, car aujourd’hui le musée est littéralement envahi par les trophées et les portraits de la famille Schneider qui a l’air d’y tenir…
· 2. À l’époque de cet entretien, le maire de Montreuil était Jean-Pierre Brard.
· 3. Un remarquable et bouleversant ouvrage recensant ces visages et ces noms a été publié récemment par les éditions Libel et la Maison d’Izieu.
· 4. Gertrud Kolmar, Lettres, Christian Bourgois éditeur, Paris, 2001.
Collé à partir de <http://www.limpossible.fr/actualite/tout-notre-temps-troubl%C3%A9>