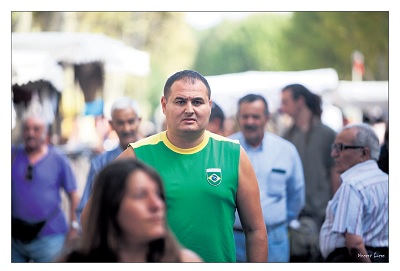
Kamel le chaînon manquant
Par François Ruffin, 29/11/2013 , N°62 (septembre-octobre 2013)
« Pas d’avenir » : les profs ne lui faisaient pas de cadeau, au petit Kamel, sur ses bulletins. Et maintenant, voilà que le grand Kamel cite Karl Marx dans le texte, Frédéric Lordon, Noam Chomsky et bien d’autres. Par quel miracle ? C’est toute une aventure, menée assis, un casque sur les oreilles, un livre entre les mains, que sa biographie politique. L’histoire d’une émancipation. Qui nous renseigne, aussi, sur le chemin des idées – et sur un chaînon manquant de la gauche, entre les intellos et le populo.
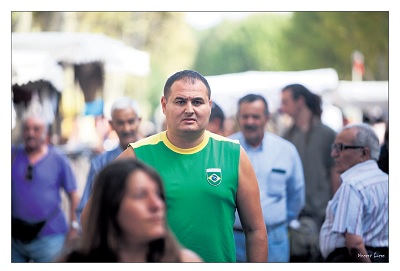
Qu’est-ce qu’il venait foutre là, lui ?
C’était il y a deux ans, à Aix, au bar Le Mansard. Je débattais sur le protectionnisme, et au milieu de l’assistance, qui me semblait composée, comme d’hab, de retraités, de profs, et de profs retraités – j’exagère, bien sûr – , y avait un jeune rebeu. Bon, ça arrive encore, à l’occasion. Mais le gars était venu en survête, un Puma. Je l’ai classé aussitôt « mec des quartiers ».
Il avait dû se tromper d’adresse, il était rentré pour gratter un Keno, ou pour voir un match sur grand écran, et vu qu’y avait du monde, il s’était dit « bon, maintenant que je suis là, on va voir un peu le spectacle ». Le spectacle, il risquait de le décevoir, juste un petit bonhomme sur une chaise qui causait de Parisot, de Goodyear, du TCE : avant cinq minutes, il se serait barré.
Mais non, il se barrait pas.
Il restait, attentif en plus, dodelinant du chef.
Et voilà que, pendant les échanges, il me pose une question sur « Maurice Allais et le mondialisme » !
D’où il sortait, lui ? Si l’habit ne fait plus le moine et le jogging « le wesh-wesh man tu veux de la beuh j’en ai de la pas chère », on va où ?
À la fin, je lui ai payé une bière. Ou l’inverse.
Et il m’a raconté vite fait que, camionneur, il était devenu « beaucoup moins con grâce à toi, grâce à Daniel Mermet, grâce à Là-bas si j’y suis ».
J’étais fier, tiens, d’éduquer le prolétariat. Du coup, j’ai pensé, ouh la, celui-là, il faut pas le rater : je l’ai mis dans un coin de ma tête, pour mon prochain passage en Provence.
Ce fut cet été.
L’occasion de percer le mystère : comment ça se fabrique, un Kamel ?
Parce que c’est un souci, et majeur, d’une gauche souvent hors-sol, qui tourne un peu en rond : qu’un Kamel soit l’exception, alors qu’il nous en faudrait des milliers, de ces hommes-jonctions, les deux pieds dans le peuple et la tête chez les intellos, amenant des idées à l’un et ramenant les autres au réel.
Avec lui, comme ça, durant deux trois jours, on va se balader au soleil, paresseusement, dans sa ville d’adoption, Gardanne (Bouches-du-Rhône), le bistro et le coiffeur, sa famille et la plage.
Trou noir
« Gardanne, c’est une super ville. »
Tandis qu’on part à la crèche, chercher son gosse, Kamel joue les bons offices de tourisme : « Le maire, il est comme ça (pouce dressé), un peu trop, il laisse trop faire. Je suis allé le voir, parce que j’ai peur que la mairie elle passe au FN l’année prochaine. Y a une quinzaine de jeunes, avec leurs scooters, ils font des levers, des bêtises. Et au lieu de voir toute la politique qu’il met en œuvre dans la ville, l’instruction, la piscine, la médiathèque, etc., les gens préfèrent retenir le petit jeune du coin qui prend sa bécane et fait du bruit. Et plus personne ne leur parle. Moi, je discute avec eux, ça va, ça commence à passer, alors que les vieux venaient leur crier dessus, le truc classique : “Moi, à votre âge je travaillais”.
— Avec toi, ils arrêtent de faire du scooter ?
— Non mais (sourire), avec moi, ils ralentissent. La dernière fois, je parlais avec eux, ils ne savaient pas qu’il y avait eu une Seconde Guerre mondiale. Ça m’a rappelé moi. Quand on arrête l’école à quinze ans, en quatrième, on stoppe à Bonaparte. Je connaissais pas Germinal et « J’accuse », je ne savais pas ce que la France a fait en Algérie, je ne savais pas qu’il y avait eu la Commune, qu’il y avait eu l’Empire…
— Mais tu savais qu’il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, quand même ?
— Nan. Je me souviens, un jour, au quartier, un copain, Arnaud, m’apprend qu’il y a eu cette Seconde Guerre mondiale. Il me dit, en me montrant une photo : “Ce gars-là, il a tué six millions de personnes”. Et moi je réponds : “Ce petit, là ? Il est tout maigre. Ils ont peur de lui, je comprends pas !” Lui s’énervait : “Putain, Kamel, c’est pas possible ! Hitler, merde !” J’étais au courant de rien. »
Alors, comment on passe de ça, de Mme Guichard qui, en biologie, tranche sobrement « pas d’avenir » sur son bulletin, d’un « ensemble vraiment catastrophique » diagnostiqué par le professeur principal, d’un relégué scolaire qui sort du collège sans son brevet, d’un précaire qui aligne les contrats-galère, à un trentenaire qui, maintenant, cite Cornélius Castoriadis et Howard Zinn ?
Le déclic
Y a le beau-frère, d’abord, Eduardo. Qui le sermonne à un repas de famille. « Il m’a dit : “T’as vu que samedi il y avait la manif pour les retraites, place Jean Jaurès”. C’était pendant le conflit sur les retraites. Et moi je lui ai répondu : “Ah non, j’étais au marché”. Et il s’est énervé contre moi, et je le comprends, de voir sa sœur avec un mec qui va pas à la manif, tu lui déchires le cœur. En plus, c’est pas en semaine, c’est le samedi, y a pas d’excuse. Il m’a engueulé, “Mais oh, mais oh, mais oh, réveille-toi, merde !” Il a commencé à craquer, chez ses parents, le dimanche après-midi. “Va dans une manif, tu verras bien, les gens sont comme toi et moi.” »
Kamel a obéi.
« À la manif d’après, j’y suis allé tout seul. Je vois des gars qui défilent avec des banderoles, des chasubles, FO, CGT, je savais pas trop ce que c’était. Ils tournent autour du commissariat, ils chantent tous ces refrains que je ne connaissais pas : “Nous sommes les Marseillais !”, “Sarkozy, ah, ah, ah !”, “Le lundi, c’est la grève, le mardi c’est la grève”. J’avais la chair de poule. Parce que le peuple était dans la rue, et au fond, j’avais toujours rêvé de ça. J’y suis retourné avec mon fils, et avec lui sur les épaules, à les entendre chanter, j’avais des frissons. Parce qu’ici c’est Marseille, aussi, ils ont la grève dans le sang. »
C’est par le corps qu’il y vient, à la politique, par la foule, par les chants, par les frissons, en faisant corps. Et c’est Eduardo, encore, qui passe la seconde couche : « Mon beau-frère m’a dit : “Arrête d’écouter tes Grandes Gueules, là, RMC. Mets France Inter, à 15 heures. Et tu verras ce que c’est, du journalisme, ce que c’est, donner la parole au peuple.” Il me l’avait déjà conseillé, mais là, après les manifs, j’ai écouté. Y a des choses, je ne comprenais pas. C’est pas grave, le soir, je la réécoutais. Pour moi, le vrai déclic, c’est Là-bas si j’y suis. »

La débauche
Ils sont nombreux, comme ça, j’en ai rencontré jusqu’au Venezuela, à avoir fait de Là-bas leur université populaire, leur quotidienne contre-école radiophonique. Mais le miracle, avec Kamel, ne s’arrête pas à cette conversion, le miracle, c’est son entêtement : qu’il sombre dans le savoir comme dans une débauche, qu’il se livre à son instruction sur le tard comme à une ivrognerie, qu’il jouisse de l’érudition comme d’un vice.
« Ta série d’émissions, là, sur “Francfort, capitale du Capital”, je me la suis passée au moins cinq fois. Rien que la formule “On a préféré avoir du chômage plutôt que de l’inflation”, pour la saisir, faut que tu rentres dans l’histoire du NAIRU, des dévaluations, de la monnaie, de l’étalon d’or, tu plonges dans un truc, et si tu aimes, tu n’arrêtes jamais. »
Il y a un hasard, aussi. En mai 2011, au boulot, Kamel se prend une palette, une tonne sur la main. Ça lui offre sept mois d’arrêt, le temps d’avancer dans son éducation.
« J’avais que ça à faire. Mais pour moi, c’était plein d’obstacles. Rien qu’une phrase de Lordon, il fallait la décortiquer : Qu’est-ce que c’est que la Commission européenne ? Qu’est-ce que c’est que l’article 123 du traité de Lisbonne ? Je me renseignais sur Internet à chaque mot. Et ça me réclamait un dictionnaire, aussi. Des trucs tout bêtes, “homogène” je ne savais pas ce que ça veut dire, “narcissique”, “post-” : “C’est une époque qui quand même est post-keynésienne”, il racontait, Lordon. “Post ?” Tu crois que quand je vois les collègues, au quartier, je leur dis “post-” ? Nan, je leur dis : “C’était bien après les gars, ouh la”, et je siffle. »
Mais Là-bas si j’y suis n’est pas le savoir.
C’est seulement une passerelle vers le savoir.
Qui demeure, et demeurera, dans les livres.
Kamel descend chez le libraire. « C’est le premier bouquin que je vais lire de ma vie, qu’est-ce que vous me conseillez ? Il m’a dit : “Y a un petit bouquin, là, vous pourriez commencer par là.” C’était Indignez-vous, trente pages, ça allait. Je suis revenu le lendemain, et cette fois, j’ai pris Après la démocratie, d’Emmanuel Todd. Mon deuxième livre. Quand il écrit, page 25 : “Huntington le dit très bien dans Le Choc des civilisations”, je me suis arrêté moi, je suis parti acheter Le Choc des civilisations, je me suis tapé Huntington pendant trois mois, et après je suis retourné à Todd. Et pareil avec Tocqueville et De la démocratie en Amérique, et pareil avec La Démondialisation de Jacques Sapir, et pareil avec tes bouquins. Et quand on lit beaucoup, on ne cherche plus ses mots. Moi le mauvais élève, le nul à l’école, qui traînait ça comme une honte, je suis rentré dans les milieux cultivés, sans complexe d’infériorité, parce que je me suis mis à lire. »
La bande
« Allez, Mehdi, viens manger le poulet ! »
Son frère habite juste l’immeuble en face, et plutôt que de faire le tour du pâté de maison, Mehdi passe par la toiture, au-dessus du Crédit lyonnais. « Je suis commercial et en bagnole, avant, j’écoutais RMC, les Grandes Gueules. À cause de Kamel, j’ai mis Là-bas si j’y suis, et à la première émission, je m’y suis retrouvé. Après, il y a eu les cafés repaires, les livres, Todd, les tiens, Lordon, y a tous ces gens qui sont arrivés dans nos vies, où avant on parlait de Zidane et Ronaldo et maintenant de Sapir, de Chomsky. Avant, on se prenait la tête sur des compositions de match : “T’as vu qui Diego il fait jouer ? — Mais c’est normal, mec : avec qui il a gagné la Coupe du monde en 1986 ? — Nan mec, je suis pas d’accord.” Cinq ans plus tard, on se prend la tête sur Marx, sur Keynes, sur Gorz. »
C’est que Kamel n’est pas un loup solitaire.
Plutôt un homme de bande, toujours avec des frangins et des copains, des « collègues ». Et c’est en homme de bande, avec ses frangins et ses copains, les entraînant dans son sillage, qu’il est parti à la conquête du savoir.
« Je me rappelle, raconte Mehdi, une phrase de quatre ou cinq lignes, qu’on n’arrivait pas à comprendre, dans Le Capital. Et donc il a fallu qu’on aille voir quelqu’un de la famille de ma femme, Alain Bianchi, un sociologue, qui est ancien directeur d’IUFM, un monsieur extraordinaire, et il nous a expliqué ce qu’il fallait comprendre.
— C’est bizarre, parce que c’est toi l’intello dans la famille ? C’est toi qui as fait des études, qui es parti aux États-Unis, qui as décroché des diplômes, qui es devenu cadre ?
— Non, l’intello politique, c’est mon frère. Noam Chomsky, Lordon, Bourdieu, je ne savais pas qui c’étaient. Et dire que, gamin, il voulait pas faire ses devoirs. C’était une teigne. Je lui mettais des tartes. Je lui disais : “Tu sors pas”. Et maintenant, c’est moi qui dois le rattraper ! »
Pour l’économie, c’est sur son pote Mahdi, alias Nanar – ingénieur en système d’information – que s’est appuyé Kamel. « Il me téléphonait le dimanche, se souvient Nanar, et il me demandait : “Le CAC, il est à 3 800 points, c’est quoi ?”, ou alors sur les systèmes monétaires. Pour lui, ceux qui font des études, c’étaient comme des dieux : ils détenaient le savoir. Moi je lui disais : “Non Kamel, je ne peux pas te répondre, je n’ai pas les éléments”, donc on faisait des recherches en parallèle, et on confrontait nos idées. Maintenant, il m’a largué. C’est lui qui me propose des nouveaux horizons, d’autres penseurs. Même sur mon cœur de métier, la finance, j’apprends de lui. »
La contagion
Mehdi sirote le café sur la terrasse : « Nos vies se sont enrichies. Et tout ça, c’est parti de Kamel et de son investissement dans Là-bas. Sur mon portable, d’ailleurs, à la place de “Kamel”, j’ai écrit “Mermet”, parce qu’il a la même dégaine, de dos, il a le casque, il réécoute l’émission, et il essaie de la traduire, de la ramener à un discours très simple envers les gens de Gardanne, parce que si tu commences à leur parler d’eurobonds, c’est fini. Et lui il dit : “Imagine, on va au restau, on partage la note, mais si y en a qui sont dans la merde, on mutualise notre merde”. Et les gens, ils retiennent ça : “Avec les eurobonds, on mutualise notre merde”. Mais si tu leur sors le discours de Laurence Ferrari ou Pujadas… »
C’est l’étape d’après : que faire de ce savoir, de ces idées ? Est-ce qu’elles vont rester isolées dans un cerveau, passives, mortes, comme de jolis papillons épinglés sous verre ?
Avec Kamel, les idées s’animent, contaminent, prennent corps et âme, comme un festin qu’on partage. « Une fois par mois, au boulot, le vendredi, j’organise une bouffe, un barbecue avec merguez. On fait ça dans les ateliers. Avant, c’était dans les bureaux, tout bien propres, les mains bien lavées, et les cols blancs ils jouaient sur leur terrain. Ils monopolisaient la parole. Les ouvriers, même moi, on n’osait pas trop la ramener. Mais maintenant, non, on fait ça dans l’usine, Christophe allume le feu, et si les commerciaux veulent venir, et ils viennent, c’est au milieu des palettes, à côté du chariot élévateur. Ils sont plus chez eux, là, ils la mettent un peu en veilleuse. Et pourtant, il y a 30 mètres ! Jusque-là, ils ne parlaient pas avec les ouvriers, mais on a eu des gros débats. En cuisant les chipos, on en est arrivés à parler de la vie du mec, de l’intérêt général, j’essaie de leur expliquer le travail concret, le travail abstrait, le capital constant, bref, Marx, on a travaillé un peu dessus : “Ah oui, ils me disent, j’avais pas vu que, sur une journée de dix heures, à partir de 16 heures, c’était pour la plus-value”. Maintenant, j’ai réussi à placer Fakir. Des commerciaux à 5 000 € par mois, ils partent en week-end avec Fakir. “On va voter Mélenchon”, ils me disaient. “Je m’en fous pour qui vous votez. Le monde, on le change pas à travers une élection. Faut d’abord réfléchir à quel monde on veut demain.” Je les aime bien tous, là-bas. »
Non-stop
C’est tout un travail de persuasion, pas « travail » d’ailleurs, mais plaisir de conviction, au quotidien, dans le quotidien, mêlé à la vie, inséparable. Quand je tends, moi, et pas que moi, à séparer les deux, la politique lors des débats, au journal – et ne pas gonfler les copains du club de foot avec ça, ou ne pas se brouiller avec la famille au réveillon de Noël. Pour Kamel, toutes les occasions sont bonnes. Au bistro. Avec la serveuse du Select, son plateau au bras :
« J’avais pas ma carte d’électeur, avant de croiser Kamel.
— A y est, t’es inscrite ? il lui demande.
— Oui.
— Le principal, c’est que t’as chopé le virus. »*
Et Sana de témoigner : « Au départ, c’était un client que je n’aimais pas du tout. Il a une voix qui porte assez, on était obligés de s’intéresser à lui. Et puis c’est devenu un ami, et comme un prof pour moi. En une année, dans les anniversaires, en pleine partie de pétanque, il me cause de mondialisation, d’inflation, au milieu des fêtes, et même si ça dérange les autres personnes. Moi qui étais grande ignorante en politique, je ne m’intéressais pas du tout à ça, il m’a fait aimer, il a réussi à me faire aller au meeting de Mélenchon, et maintenant je sens l’importance de s’impliquer. » À la station essence : « je laisse plus passer, relate Kamel. Pendant les manifs sur les retraites, je prenais du gasoil, et je demande à un mec “Saint-Maximin, c’est loin d’ici ?
— Prends la nationale, il me répond, ces cons de grévistes ils sont sur l’autoroute.
— Ces “cons de grévistes”, c’est-à-dire ?
— Ben les grévistes sur les retraites, là.
— Ah oui, parce que tes congés payés, ils sont tombés du ciel ? Vous êtes nés en quelle année ?
— En 1973.
— Bah voilà, on a attendu que Monsieur Untel soit né, en 1973, pour que d’un coup, exprès pour vous, il y ait la Sécu, les retraites. Merci Monsieur.”
Il est parti, il m’a dit : “Non mais vous comprenez ce que je veux dire…
— Nan, je lui ai dit, je ne comprends pas. Que vous ne puissiez pas faire grève, c’est autre chose, mais me dites pas, “Y a des cons de grévistes qui bloquent l’autoroute.” »

En bas de chez lui. « Je bavardais avec des jeunes, et ils me servent le refrain classique : “ça sert à rien de voter.
— Tu passes ta carte vitale ?, je l’interroge.
— Ah ouais.
— Donc t’es remboursé ?
— Mais c’est normal, ça gars.
— Ah nan nan nan, c’est pas normal. Faut savoir pourquoi t’es remboursé.
— Parce que c’est important la santé.
— Ah oui, ça, les virus, quand ils attaquent, ils regardent pas les papiers, si t’es noir ou si t’es blanc. T’as vu le nom de ta cité, là ?
— Ouais, cité Ambroise Croizat.
— Tu sais c’est qui ?
— Nan.
— C’est grâce à cette personne, et à plein d’autres avec lui que tu as la Sécurité sociale aujourd’hui. Y en a qui sont morts pour ça, pour qu’on te rembourse. Je sais que dans les quartiers, vous avez peur de rien, mais si ils touchent à la Sécurité sociale, là les quartiers doivent se battre, être dans la rue, on fout le feu… encore plus que pour les bavures policières.” »
Et la propagande se poursuit ainsi, nonstop, de la plage au coiffeur en passant par la crèche, le kébab, les terrains de foot, prophète bien singulier sur des terres hier quadrillées par le Parti, et aujourd’hui abandonnées par les partis, juste un tract diffusé à l’occasion, mais sans cette proximité, sans ce voisinage, sans ce cousinage des destins.
Le boucan
« Avant, compare son frère, Kamel sortait raconter des blagues, ça faisait marrer tout le monde. Maintenant, les gens lui demandent : “Est-ce qu’on ne devrait pas nous aussi instaurer des plans d’austérité ?”, et Kamel, il explique aux gens qu’est-ce qu’un plan d’austérité, ce que ça a apporté en Espagne et en Italie, ce que ça va faire chez nous. Il arrive dans un bar, et il va foutre la merde. Ils vont parler, causer de leur vie, qu’on est dans un pays d’assistés. “OK, d’accord, il leur dit, maintenant, regardez de l’autre côté de la barrière : les gens qui paient pas leurs impôts, où leur argent est placé.” Il leur ouvre les yeux.
« Nous on rigole : “Dans dix ans, on sera maire de Gardanne !” »
Je ne vois pas de quoi rigoler.
Ça devrait être ça, un parti de gauche : assurer une formation aux fils – et filles – du peuple, aux plus motivés du moins, et les promouvoir dans l’appareil, lors des scrutins. Cette générosité, Kamel ne l’a guère ressentie aux assemblées locales du Front de gauche : « Qui j’étais pour causer de l’euro ? J’étais économiste ou pas ? Même pas prof ou étudiant ? Tu croirais que c’est comme avec la police : là aussi, il faut sortir tes papiers ! »
C’est aux « Repaires » – où se rassemblent les amis de Là-bas si j’y suis –, puis aux Déconnomistes – qui s’opposent à l’orthodoxe Cercle des économistes – que Kamel a trouvé sa place.
Non sans heurt. « Mon souvenir le plus fort, au début, relate Dany, le fer-de-lance des repaires sur Aix et Marseille, c’est quand on a reçu Laurent Mucchielli, un universitaire, spécialiste de l’insécurité. Kamel demande la parole, je la lui donne. Il se lève, vient à côté de moi, face au public, et fait sa conférence. Si je l’avais laissé, il faisait une heure, plus long que Mucchielli. C’est là que je suis intervenu comme modérateur : “Tout ce que tu dis est très bien, et on organisera un repaire avec Kamel comme conférencier, il choisira son thème.” » L’assistance a ri.
« C’est ce qu’on appelle, à Marseille, le “boucan”, celui qui emboucanne, qui fout la merde, on ne s’en dépêtre pas. Un nombril du monde, complètement égotique. On pourrait écrire toute une sociologie du boucan. Et donc, j’ai cru que j’avais à faire à un parfait spécimen de boucan.
« Et puis je l’ai vu revenir, et se discipliner de façon extraordinaire : c’est-à-dire prendre la parole en deux minutes, de façon très pertinente, très percutante. Je me suis dit : “Putain, ce mec, je lui ai balancé trois mots et il a bien assimilé”. Je m’étais trompé sur le diagnostic. Ça n’était pas un boucan, parce que le désemboucannage est normalement impossible. Maintenant, dans les débats, c’est lui qui contrôle les boucans. Quand un gars cause trop longtemps, il fait le modérateur, à son tour : “On est en démocratie, mais vous avez quatre minutes.
— Mais on n’a pas le droit de parler ?
— Si, comme les autres qui sont dans cette salle”. »
Les germes
Mon corps blanc d’intello picard, Kamel a décidé de le dorer au soleil de Provence. Et nous voilà allongés sur des rochers, le drapeau vert flotte sur la plage de Carry-le-Rouet. Autour de nous, des dames se passent de la crème bronzante sur le dos. Et les glacières sont de sortie : « Heureusement qu’elles sont là, hein, les glacières ? lance Kamel, à tout hasard.
— Si elles seraient pas là, on mangerait pas, confirme la voisine. On n’a pas les moyens d’aller au restau.
— Bienvenue au club.
— Déjà qu’on paie le parking, maintenant.
— Faut éloigner les pauvres, c’est pas propre, y en a trop, et ça laisse des papiers.
— Ah non, proteste la maman, moi je ramasse tous mes papiers. »
Cette glacière, ça le ramène à son enfance, Kamel.
« Mon père, il travaillait à l’usine, en trois huit, à la Société mécanique d’Irigny, près de Lyon, mais il nous a toujours ramené le pain sur la table et les vacances en Espagne. On partait à cinq derrière dans la voiture, la glacière sur la plage et le bal du 15 août. Il se cassait la tête pour nous emmener, sinon c’était les colonies. Il se levait le matin, à 4 heures, il emportait le gruyère que ma mère avait préparé, le tupperware, et il passait nous couvrir. Je sentais sa main qui passait sur ma tête, ça faisait du bien, et puis il attendait le bus. La SMI, toute la famille a travaillé là-bas. Lui était délégué syndical CGT. Il a mené des grèves, sans jamais se résigner. En 1983, y en a eu une de dix semaines. On venait d’acheter la maison, on a bouffé que des pommes de terre, du lait, du cacao et de la galette pendant deux mois. Mon père nous confiait : “Je pensais pas qu’après l’élection de Mitterrand, deux ans après, il faudrait faire des grèves. Je pensais que Tonton il ferait le boulot.”
« Les gens disent de mon père : “Il ne lâchait rien”. D’ailleurs, il a écrit un courrier à la direction : “Après 32 ans à 8 500 F, je refuse votre promotion et votre augmentation.” Et il m’a expliqué pourquoi : “Si t’es pas dans les ateliers, Kamel, t’es déconnecté.” S’il montait dans les bureaux, ça devenait un traître à sa classe. »
La métamorphose de Kamel ne s’est pas opérée que par « miracle » : sous un sol d’apparence aride, des graines étaient prêtes à féconder.
Son père, bien sûr. Mais Monsieur Pagliari aussi, un voisin, qui organisait « le Salon du livre antifasciste » à Givors : « On l’avait aidé à porter les barrières, à décapsuler les bouteilles, il nous parlait du Chili, de l’Algérie ». Un prof quand même, Monsieur Boulu, le seul qu’il sauve de ses années d’éducation nationale : « Il m’a fait aimer l’histoire. Il donnait pas un cours, il faisait du théâtre, sans craie, sans le tableau : “Aujourd’hui, on va refaire l’été 1789”, et il jouait Mirabeau. J’ai adoré la Révolution. » Ces germes étaient enfouis, il fallait un déclic pour les réveiller.
Les Kamel
Cette sensibilité, diffuse, confuse, son beau-frère Eduardo la décrit bien : « Kamel a toujours exprimé de l’indignation. Contre ses formations bidons, ses contrats précaires, son expérience de camionneur. Mais ça ne le rattachait pas à des militants, qui se battent pour leurs conditions de classe. Il restait dans l’indignation pure et simple, ne voyait pas comment les choses pouvaient changer. Il aurait pu y avoir le repli sur soi, un discours résigné, “il n’y a rien à attendre de l’homme”. Et finalement, il n’y a pas ça.
« À la Mission locale [de Fézin (69)], je rencontre des tas de Kamel, des jeunes qui sont révoltés, qui n’arrivent pas à mettre des mots, des idées sur leur révolte, qui vivent la précarité, le mauvais traitement, qui ont envie d’aller dans une réflexion. On a tous ça, du moins j’espère.
— Et avec ces jeunes, vous causez aussi de politique ? Vous leur conseillez d’aller dans les manifs ?
— Jusqu’alors, je n’osais pas trop. Maintenant, c’est fini, j’y vais carrément. Je n’hésite plus à parler politique, parce que je crois qu’on leur sert plus, on sert plus la cause de l’insertion, quand on les aide à comprendre leur condition sociale, à les mettre debout, plutôt que de continuer à tenir un système en vie, où les jeunes on les envoie de stages en trucs bidons.
« Ça pèse un peu au-dessus de nous : soi-disant, “il ne faut surtout pas qu’on ait une influence sur le jeune qu’on accompagne”. Alors que bon, les influences, elles sont au quotidien, quand on allume la télé, Internet, du coup je m’autorise. Parce qu’il faut un équilibre, pour offrir une autre vision du monde. Donc je politise mes entretiens, pour essayer de les stimuler. Si on le fait pas, qui le fera ?
« Mais je crois que l’enjeu, aujourd’hui, pour les toucher, c’est la création d’une télé, avec le même type de projet que Là-bas si j’y suis. »
La pièce maîtresse
Je voudrais conclure avec l’essentiel : Isabelle. Parce que j’admire Kamel, mais c’est sa femme qui m’émeut. La pièce maîtresse, sans doute, bien que discrète, presque invisible, de ce parcours. Ils ont deux enfants, bientôt trois.
Secrétaire, elle ne travaille pas.
Elle reste seule à l’appartement les soirs, nombreux, où Kamel s’en va débattre et réunionner – parce qu’il s’est lancé dans les Rencontres déconnomiques, dans les Repaires, comme dans le reste : avec boulimie.
Le fait-elle par sacrifice ? Femme soumise, obéissant à son éducation de catholique portugaise ? Un peu, à coup sûr, bien des épouses n’en supporteraient pas tant, et demanderaient au compagnon combien ça rapporte, ces histoires, quand ils pourront se payer la maison, ou les vacances au ski.
Pas elle, jamais.

Car elle n’en veut pas, de la maison ou des vacances au ski. Car c’est elle, au fond, la vraie politique. C’est elle, la femme de gauche et de valeur. Et qui voit, avec bonheur, son homme la rejoindre.
« On a fait un long chemin en couple. Déjà, on a mis du temps à se marier. Je l’ai croisé dans un salon de coiffure, et il parlait, il parlait, il parlait. J’avais 19 ans, j’étais lycéenne, j’allais passer mon bac. Moi, j’étais d’une famille très catholique, et avec lui musulman, avec les parents ça ne passait pas. Surtout qu’il n’avait pas de situation stable : Kamel ne savait pas ce qu’il allait faire de sa vie, mais j’ai toujours eu confiance en lui, j’ai toujours su qu’il allait y arriver, pas à trouver un beau métier, bien payé, mais arriver à se trouver.
« On s’est entêtés, et on s’est mariés ensemble à 26 ans. Il fallait de l’endurance, sept ans, parce que, sans mariage, il n’était pas question de quitter le foyer.
« Ensuite, on s’est éloignés de Lyon.
— Je voulais entrer dans un centre commercial, intervient Kamel, acheter du fromage et que personne ne me connaisse. À Lyon, j’étais le garçon qui avait raté ses études, qu’il ne fallait pas fréquenter.
— Dans l’Hérault, reprend Isabelle, à Montpellier, il a fait taxi. Et il désirait se mettre à son compte. Il voulait une entreprise. Il était dans l’achat. Moi j’étais contre, c’était source de disputes. J’avais vu mon père, artisan maçon, comment il trimait, comment toute sa vie c’était le travail, les comptes, je ne désirais pas ça. Je n’étais pas pour la consommation, la maison, l’argent, la belle voiture. Je m’en fiche de ne pas avoir des nouveaux habits, de ne pas aller chez le coiffeur toutes les semaines, l’électronique à gogo. Alors que lui, il voulait ça, un peu. Il voulait montrer à sa famille, aux copains, qu’il avait réussi, leur prouver que même sans diplôme…
— J’avais besoin de reconnaissance, admet Kamel. Et dans la société telle qu’elle est, on nous apprend, on nous martèle, que ça passe par l’argent, par les achats.
— Et maintenant, il s’est rendu compte que ça ne servait à rien du tout, qu’il pouvait le faire d’une autre manière. Avec le temps, finalement, il a compris ce que j’avais un peu dans la tête.
— T’étais plus à gauche que lui ? je questionne.
— Oui, parce que j’ai fait de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. On nous transmettait des valeurs, un peu des valeurs que je retrouve dans son engagement, évidemment la religion en moins. Et puis, on nous montrait aussi qu’ensemble on peut agir sur nos vies. Par exemple, notre groupe avait réclamé que, pour les jeunes en recherche d’emploi, les bus soient gratuits, et on l’avait obtenu. C’est le message que je retrouve, aujourd’hui, chez Kamel : ensemble, on peut agir sur nos vies.
_ « Même, je lui disais : “la lecture, c’est important, Kamel”. Il s’en fichait, il allait tous les soirs au foot, y avait que le foot. Il a ralenti pour s’occuper des petits, et d’un coup, il s’est mis à lire, à vérifier sur Internet les faits historiques, le dictionnaire, et il m’impressionne. C’est moi aussi qui l’invitais aux manifs, “Allez, viens, on y va !” mais il ne bougeait pas. Aujourd’hui, il a pris la direction que j’ai toujours souhaitée. Et je le soutiens pour cette raison : parce que ça a plus de sens, quand même, que de faire la comptabilité de sa boîte de taxi. »
Voilà grâce à qui, en vérité, Kamel n’a pas viré auto-entrepreneur, ou entrepreneur tout court. Protestant contre les « charges » trop élevées, aussi convaincant et convaincu qu’aujourd’hui sur la Sécu et les retraites à sauver…
Photos : Vincent Lucas
Collé à partir de <http://www.fakirpresse.info/Kamel-le-chainon-manquant-638.html>