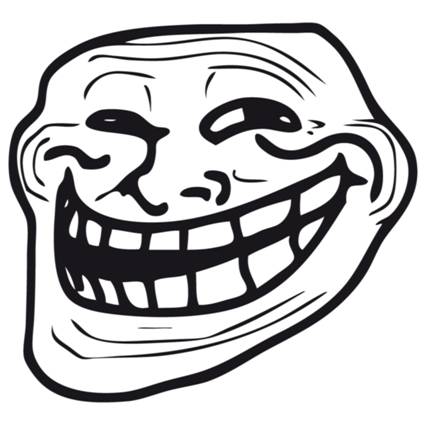
Les mèmes, grains de sable dans la machine propriétaire (#OuPas)
Publié le 23 avril 2015 par calimaq
Cette semaine, Rémi Sussan propose un article passionnant sur Internet Actu, intitulé « Splendeur et misère des mèmes« . Il y souligne la nature ambivalente de ce concept née dans le champ de la biologie et qui sert aujourd’hui à décrire les phénomènes de propagation virale de motifs culturels, particulièrement sur Internet. Une des facettes des mèmes qui, à mon sens, n’a pas encore retenu suffisamment l’attention est leur rapport complexe avec la notion de propriété.
Résultant de processus de circulation et d’appropriation collective à une échelle massive, les mèmes paraissent à première vue aux antipodes de l’idée de propriété, qui implique la possibilité d’imposer un contrôle par le biais d’un droit exclusif. Pourtant, l’actualité récente montre que certains mèmes, parmi les plus fameux, font l’objet de tentatives de réappropriation par leurs « créateurs », notamment au moyen du droit d’auteur ou du droit des marques. La justice commence même à être saisie d’affaires portant sur des mèmes, avec des enjeux financiers parfois non négligeables.
Mais malgré ce retour de la logique propriétaire, il y a quelque chose dans la nature des mèmes qui les rend difficiles à appréhender à travers les notions de la propriété intellectuelle. Le bouillon collectif de création collective dans lequel baignent ces « virus culturels » leur donne une capacité de résistance étonnante, qui se manifeste aussi en droit et peut faire échec à certaines tentatives de réappropriation.
La nature juridique des mèmes ressemble un peu à un chat de Schrödinger : même lorsque qu’ils sont « appropriés », ils paraissent rester inappropriables, et c’est ce qui les rend fascinants !
Le troll ultime ? Trollface est sous copyright !
La semaine dernière, le site Kotaku nous apprenait par exemple que l’un des mèmes Internet les plus célèbres, le fameux « Trollface », avait en réalité fait l’objet d’un enregistrement de copyright et de marque par son « créateur » Carlos Ramirez, pour s’opposer notamment à sa reprise dans le jeu « Mème Run » de Nintendo.
En 2008, alors qu’il n’avait pas encore 18 ans, Ramirez poste sur DeviantArt une petite BD humoristique dessinée rapidement avec MS Paint, dans laquelle il fait figurer le personnage ci-dessous. Il ne s’en préoccupe plus, mais constate quelques mois plus tard que cette figure a envahi le site 4chan, où elle est devenue une sorte d’émoticone universelle pour dénoncer les comportements de trolls. 4chan étant la plus grande fabrique de mèmes des Internets, le motif se répand comme une traînée de poudre et finit par faire l’objet d’un merchandising intensif, en étant reproduit sur des Tshirts, des casquettes et toutes sortes de choses plus improbables les unes que les autres…
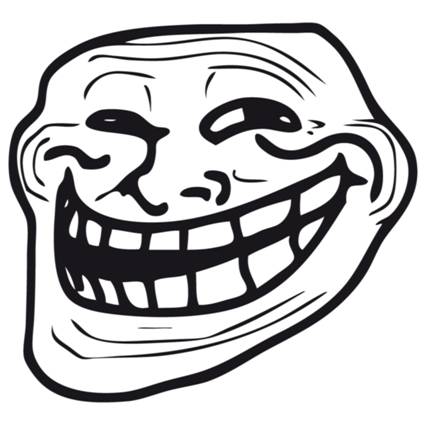
Le trollface original…

… et un aperçu de la myriade hallucinante d’usages dérivés qu’il a engendrés.
A l’origine, Ramirez n’avait pas réellement l’intention de revendiquer des droits sur son dessin, mais il y fut poussé par sa mère, terriblement fière du succès de son rejeton au point de faire peindre le trollface sur la façade de la maison familiale (sic). Ramirez enregistra donc un copyright à la Library of Congress et il déposa également une marque. Depuis, il a rapidement compris qu’il pouvait être très lucratif de menacer de procès des réutilisateurs du trollface, en choisissant de préférence ceux qui sont solvables. En réclamant ainsi des royalties, il est en mesure de générer plus de 10 000 dollars de revenus par mois et c’est devenu son activité principale.
On arrive donc à ce paradoxe que le créateur du Trollface, l’un des mèmes qui a connu la propagation la plus explosive de l’histoire, est lui-même devenu… un Copyright Troll !
La malédiction du Nyan Cat a encore frappé…
Ce retour de la logique propriétaire qui a frappé le trollface n’est à vrai dire pas un phénomène isolé. Il a également affecté par exemple en 2013 deux autres mèmes célébrissimes : le Nyan Cat et le Keyboard Cat. Les créateurs de ces vidéos cultes ont déposé un copyright et une marque pour attaquer en justice Warner Bros qui avait réutilisé ces personnages dans le jeu vidéo « Scribblenauts ».
Aucun jugement n’a été rendu à cette occasion, car Warner Bros a préféré accepter en septembre 2013 une transaction financière pour éteindre la plainte, comme c’est souvent le cas aux Etats-Unis. Dans une certaine mesure, c’est presque dommage que l’affaire se soit terminée ainsi, car certains avaient soulevé de sérieux doutes quant à la validité de ces titres de propriété intellectuelle revendiqués.
Voilà par exemple ce qu’en disait Mike Masnick dans un article du site Techdirt :
La signification culturelle du Nyan Cat et du Keybopard Cat ne vient pas de Schmidt ou de Torres [les créateurs respectifs de ces deux mèmes]. Il y a des milliers et des milliers de vidéos semblables sur Internet. Mais comme tous les bons mèmes, ces deux là ont acquis une signification culturelle particulière parce que des masses de personnes se sont appropriées ces idées pour créer à partir d’elles. Que Schmidt et Torres surgissent à présent pour réclamer une « propriété » sur la qualité mimétique de ces oeuvres est juste insultant. C’est un affront infligé à la communauté des personnes qui ont rendu ces deux mèmes populaires.
[…] Les deux créateurs de ces mèmes ont grandement bénéficié, non pas de leurs propres efforts, mais de ceux de ces millions de personnes qui se sont transmis des oeuvres à la base assez navrantes pour les rendre célèbres. Les voir apparaître dans un jeu vidéo n’a fait qu’accroître encore l’attention et la popularité dont bénéficient ces mèmes.
Ce commentaire est extrêmement intéressant, car il sous-entend que ces deux mèmes ont connu une appropriation collective à une échelle tellement large, qu’ils ne devraient plus pouvoir faire l’objet d’un droit de propriété privée, même par les personnes à l’origine des motifs de base.
Or on va voir que justement, sans aller jusqu’à consacrer une telle « propriété collective » (ou mieux « commune ») sur les mèmes, plusieurs décisions rendues récemment à la fois aux Etats-Unis et en France tendent à considérer qu’ils ne sont pas appropriables par les mécanismes classiques de la propriété intellectuelle.
L’aventure du Left Shark finit dans le domaine public
Cette semaine par exemple, l’Office américain des marques a considéré que la chanteuse -Katy Perry ne pourrait pas valablement déposer de marque sur le « Left Shark ». Ce « Requin de gauche » renvoie au costume d’un danseur qui accompagnait Katy Perry en janvier dernier lors du show qu’elle a donnée pour la mi-temps du Super Bowl. Pour des raisons qu’on ignore, celui-ci a complètement raté sa chorégraphie, déclenchant l’hilarité des internautes, au point que le personnage du Left Shark – dit aussi « Drunk Shark » – est rapidement devenu un phénomène viral, repris à toutes les sauces dans les semaines suivantes et qui est même devenu un personnage de World of Warcraft !
Le problème, c’est que Katy Perry n’a pas du tout apprécié cette propagation incontrôlée d’un des éléments de son spectacle, et notamment le fait que quelqu’un se mette à proposer à la vente des statuettes du Left Shark réalisées en impression 3D. La chanteuse a alors demandé à ses avocats d’exiger le retrait du personnage sur Internet, mais ceux-ci sont alors tombés sur un épineux problème juridique. Car il existe en effet une règle quelque peu étrange en droit américain qui veut que les costumes sont en général considérés comme des « articles utiles » et non des oeuvres de l’esprit pouvant faire l’objet d’un droit d’auteur. Pour appuyer leurs revendications, les avocats de Katy Perry ont donc plutôt cherché à déposer une marque sur le Left Shark, mais beaucoup doutaient de la possibilité de le faire valablement et c’est ce qu’a répondu effectivement cette semaine l’office américain sur la base de ces arguments :
Le design du ‘Left Shark’ identifie uniquement un personnage particulier, il ne remplit en rien la fonction d’identification et de distinction d’un produit de Katy Perry par rapport à un autre, il n’indique pas la source du produit commercial.
En effet, à la différence du droit d’auteur, le droit des marques ne protège pas une oeuvre de l’esprit en tant que telle, mais un signe dans la mesure où il remplit la fonction d’identifier un produit dans l’esprit du public (c’est le critère de la « distinctivité »). Or ici, ce que dit l’office américain, c’est que l’usage massif par le public du Left Shark l’empêche dorénavant de désigner efficacement un produit. Dans l’esprit du public, le Left Shark renverra toujours à ce grand moment de LOL du spectacle du Super Bowl et plus à des produits que Katy Perry pourrait proposer, comme sa musique, des places de concert ou du merchandising.
Sans le dire explicitement, l’office des marques admet donc que c’est bien le public qui a « fait » le Left Shark à partir du motif original créé pour le spectacle de Katy Perry. Cette appropriation collective a rompu le lien de propriété qu’elle aurait pu sans doute revendiquer si un tel phénomène viral ne s’était pas produit.
Quand les mèmes deviennent des biens communs
On pourrait croire que cette décision est liée aux spécificités du droit américain, mais nous avons connu en France un résultat similaire à propos des tentatives d’enregistrement comme marque du slogan et de l’image « Je suis Charlie ». Souvenez-vous : plus d’une centaine de dépôts de marques ont été effectués dans la foulée des attentats du mois de janvier par des rapaces souhaitant surfant sur la vague d’émotion pour tenter de s’approprier à titre exclusif le signe de ralliement qui a spontanément émergé à ce moment.

Je suis Charlie… mais pas une marque, merci.
Or l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) a pris à cette occasion la décision rarissime de rejeter en bloc toutes ces demandes de marques, en faisant allusion cette fois explicitement à la notion d’usage collectif :
L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif. En effet, ce slogan ne peut être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.
Bien que critiquée par un certain nombre de juristes, cette décision paraît bien consacrer le fait qu’un motif ne peut plus faire l’objet d’une appropriation privative dès lors qu’il s’est répandu de manière massive, au point de s’imposer dans l’esprit du public avec un caractère « iconique ».
On notera que cette décision a aussi pour effet d’empêcher Joachim Roncin, le graphiste à l’origine du slogan « Je suis Charlie » et de l’image associée, de déposer lui-même une marque sur sa propre création. La question reste cependant posée de savoir s’il ne pourrait pas revendiquer un droit d’auteur, mais c’est assez improbable dans la mesure où le critère d’originalité doit être satisfait et les juges français en ont une conception relativement exigeante.
On en arrive donc à la conclusion que « Je suis Charlie » est sans doute « inappropriable » et ce caractère le rapprocherait dès lors d’un bien commun parfait. Un raisonnement similaire a d’ailleurs été suivi en 2014 par l’office des marques aux Etats-Unis lorsque certains commerces avaient essayé, suite aux attentats de Boston, de déposer des marques sur le slogan « Boston Strong » qui avait émergé comme cri de ralliement dans le public :
L’usage de ce slogan est si répandu en lien avec l’attentat qui a frappé le marathon ainsi que pour d’autres usages qu’il est devenu « ubiquitaire » […] Déterminer si un terme ou un slogan fonctionne comme une marque de commerce dépend de la manière dont il est perçu par le public. Les termes ici revendiqués comme marque véhiculent essentiellement un message social, politique, religieux et d’autres formes de messages. Ils ne fonctionnent pas comme une marque indiquant la source des biens ou services proposés par les déposant , en permettant de les distinguer d’autres biens ou services.
***
Si l’on revient pour conclure après ce détour à la question initiale du statut juridique des mèmes, on s’aperçoit qu’il existe dans le régime des marques des mécanismes très intéressants, car capables de saisir la dimension collective de l’usage pour l’opposer à des tentatives d’appropriation.
Tel n’est cependant pas le cas pour le droit d’auteur, profondément ancré dans un paradigme individualiste, qui reste de son côté relativement hermétique aux phénomènes collectifs. Ce n’est pas parce qu’une oeuvre devenue un mème fait l’objet d’une propagation massive et d’une multitudes d’adaptations par la foule que le lien de propriété avec le créateur originel se rompt. L’exemple des fameuses parodies du film « La chute », dont le producteur avait obtenu le retrait en bloc sur Youtube en 2010, le montre assez bien. Parfois une certaine forme de tolérance à l’usage finit par s’installer, mais le droit reste inflexible…
Le droit d’auteur a une autre manière d’appréhender la transformation des oeuvres, par le biais notamment d’exceptions comme la parodie, qui admet que l’on reprenne et modifie une oeuvre à condition d’y ajouter quelque chose d’original avec l’intention de faire rire. Une partie des mèmes est sans doute couverte par cette notion de parodie, mais cette approche a quelque chose de profondément réducteur, car à la différence du droit des marques qui appréhende le rôle du « public » en tant que tel, le droit d’auteur ne saisit les propagations virales que comme des chaînes de créations individuelles.
Pourtant en 1791, lorsque le droit d’auteur a été pour la première fois institué légalement en France, la conception d’une propriété du public sur les oeuvres était bien présente, comme en atteste les propos du rapporteur de la loi Le Chapelier :
Lorsqu’un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s’en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sa propriété.
Ces termes font immanquablement penser aujourd’hui au phénomène des mèmes, qui incarnent au plus haut point cette capacité du public à s’emparer des oeuvres pour les faire siennes. Reste à savoir s’il serait possible, comme on le constate en droit des marques, d’introduire un mécanisme au sein du droit d’auteur pour consacrer effectivement cette dimension collective….
Collé à partir de <http://scinfolex.com/2015/04/23/les-memes-grains-de-sable-dans-la-machine-proprietaire-oupas/>