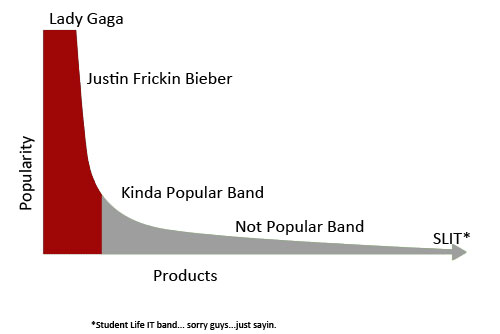La
fin de Grooveshark et le prix à payer pour la survie
des plateformes
Publié
le 3
mai 2015 par calimaq
La
nouvelle est tombée brutalement vendredi dernier : le site de
streaming musical Grooveshark a
fermé ses portes, après plus de huit années
d’existence et une longue bataille judiciaire contre les majors
de la musique, qui
s’était conclue en 2014 par une cinglante
condamnation pour violation du droit d’auteur. Sous la pression
des ayants droit, les fondateurs du site ont préféré
saborder leur navire et mettre un point final à l’aventure,
plutôt que de devoir payer les 700 millions de dollars
d’amendes auxquels la justice les avaient condamnés.

Le
« message d’adieu » qui figure sur la
page d’accueil de Grooveshark depuis vendredi dernier.
Il
est extrêmement intéressant de revenir sur la
trajectoire d’une plateforme comme Grooveshark, car sa destinée
éphémère épouse les épisodes de
la guerre au partage menée depuis des années par
les industries culturelles. Et sa disparition nous renseigne aussi
sur les conséquences de cette stratégie des ayants
droit sur l’écosystème global de la musique sur
Internet.
Un
coup porté à la « Longue Traîne »
de la musique
Grooveshark
compte
en effet parmi les successeurs de Napster, fermé par
décision de justice en 2001. Apparu en même temps
que Limewire par exemple, il prenait à l’origine la
forme d’un réseau de P2P, Grooveshark fournissant un
client pour effectuer du partage décentralisé. Son
originalité était cependant de
prévoir une rémunération pour les
utilisateurs qui acceptaient de mettre en partage des fichiers (0,25$
le titre). Alors que l’on parle beaucoup aujourd’hui du
Digital
Labor et du « travail gratuit » que les
plateformes font effectuer à leurs utilisateurs, Grooveshark
avait sans doute quelque chose de visionnaire dans la manière
dont il envisageait ses rapports avec les contributeurs. Mais ce
modèle constituait aussi pour lui une stratégie,
destinée à étoffer le plus rapidement
possible son catalogue afin de surpasser celui des plateformes
concurrentes.
Sur
cet aspect de la profondeur de l’offre, Grooveshark avait en
effet clairement une longueur d’avance sur ses concurrents
et on le perçoit à travers les commentaires
partagés sur Twitter par les internautes à l’annonce
de sa fermeture. Nombreux sont ceux qui déplorent le fait de
perdre avec leurs playlists des morceaux rares, qu’ils ne
retrouveront pas sur « l’offre légale »
de streaming musical, chez Deezer ou Spotify.
Grooveshark
ferme,
pas sauvegardé mes playlists. Quelques pépites
découvertes resteront oubliées de moi à tout
jamais.
—
Joh
Peccadille
(@peccadille) May
02, 2015
Grâce
aux recommandations, je cherchais de nouveaux noms, proches de mes
goûts. Parfois j'achetais.
—
Joh
Peccadille
(@peccadille) May
02, 2015
L’avantage
de Grooveshark ne tenait d’ailleurs pas nécessairement
au
volume des titres disponibles, mais à leur diversité.
Le catalogue de la plateforme avait donc cette vertu de
matérialiser une forme de « longue traîne »
en musique, dont l’existence ailleurs sur Internet est
loin d’être évidente. Il en est ainsi parce
que son contenu était directement « crowdsourcé »
par ses utilisateurs à partir de la mise en commun de leurs
bibliothèques personnelles. Mais alors que Grooveshark
affichait clairement son intention de
s’inscrire dans l’offre « légale »,
il n’a pas tardé à être attaqué par
les titulaires de droits du secteur, l’accusant de favoriser la
contrefaçon d’oeuvres protégées à
grande échelle.
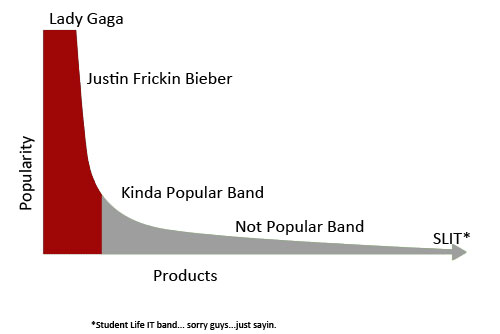
Une
représentation de la « Longue traîne »
de la musique.
Du
P2P rémunéré au streaming musical centralisé
Les
industriels de la musique ont rapidement agité la menace d’une
action en justice et en réaction, Grooveshark s’est mis
à muter, en s’éloignant de plus en plus du
modèle décentralisé. Il est devenu une sorte de
« Napster in the Cloud », en se transformant en
une plateforme centralisée de streaming musical, très
proche en un sens de ce que YouTube
représente pour la vidéo ou SoundCloud
pour le son. Le projet de rémunérer les
utilisateurs pour la mise en mise partage des fichiers sentait trop
le souffre et il a rapidement été mis au placard. A
la place, Grooveshark a cherché un terrain d’entente
avec les majors en mettant en place un système de
rémunération, basée sur un partage des recettes
publicitaires et des abonnements proposés à ses
utilisateurs. La plateforme a d’ailleurs réussi à
conclure des licences avec EMI
et des labels indépendants, mais pas avec le reste de la
profession.

Le
DMCA et son système de notifications de retrait est au coeur
de l’histoire de Grooveshark.
Car
à leurs yeux, Grooveshark portait en lui une forme de « vice
fondamental »: si les industriels de la musique toléraient
l’existence d’un service fonctionnant sur le principe du
partage des fichiers par les individus, ils acceptaient de revenir
sur un des fondements du droit d’auteur, qui veut qu’une
oeuvre ne peut être distribuée sous une forme donnée
qu’avec l’accord des titulaires de droits. Ne parvenant
pas à trouver d’issue légale pour son modèle,
Grooveshark s’est alors abrité derrière la
responsabilité allégée dont bénéficient
les hébergeurs de contenu sur Internet au titre du
DMCA (Digital Millenium Copyright Act) aux Etats-Unis. Une
plateforme ne devient responsable pour un contenu mis en ligne par
ses utilisateurs que si elle ne réagit pas rapidement pour le
retirer une fois qu’il lui a été signalé.
Or c’est ce point qui a causé la perte de Grooveshark :
les ayants droit sont parvenus à prouver devant les juges que
la
société avait demandé à des employés
de charger eux-mêmes de fichiers sur la plateforme, ce qui
a eu pour conséquence de leur faire perdre le bénéfice
du « safe
harbour
»
(sphère de sécurité) prévu par le DMCA.
Après
avoir commis une telle erreur, la fin de Grooveshark était
inéluctable et l’occasion trop belle pour les titulaires
de droits de faire un exemple en l’abattant devant la justice.
Mais au-delà de ce motif de condamnation, on peut se demander
qu’est-ce qui fait au juste la différence entre
Grooveshark et des plateformes dite « légales »
comme Deezer ou Spotify ? Qu’est-ce qui le différencie
aussi fondamentalement de sites comme YouTube ou SoundCloud, toujours
en ligne malgré la « zone grise » dans
laquelle ils se situent également depuis des années
?
Quelle
différence entre Grooveshark et « l’offre
légale » ?
La
différence est en réalité extrêmement
ténue. On peut même dire que Deezer n’est rien
d’autre qu’un Grooveshark qui a réussi. En effet,
il est bon de rappeler qu’à ses origines l’aujourd’hui
respectable Deezer a également subi
des accusations de violation de droit d’auteur.
Le champion français du streaming avait en effet réussi
à trouver un accord avec la SACEM en ce qui concerne les
droits des auteurs, mais pas avec les producteurs de musique qui
l’ont longtemps menacé de procès. Ce n’est
qu’après coup qu’une entente a pu être
entérinée, mais Deezer a bien été obligé
lui-aussi à une époque de « passer en
force », en mettant les titulaires devant le fait accompli
de l’existence d’une offre.
Un
site très proche de Grooveshark a d’ailleurs existé
en France. En 2003, Radio.blog.club avait
essayé
de mettre en place un modèle d’écoute en
streaming gratuit, financé par de la publicité. C’était
d’ailleurs à l’époque le concurrent d’un
certain BlogMusik, qui se se transformera
ensuite en Deezer
après avoir réglé ses problèmes
juridiques. Mais la sanction a été lourde pour lui,
puisque le site a été condamné en 2012 par la
justice, avec un million d’euros d’amendes à
verser pour ses fondateurs.
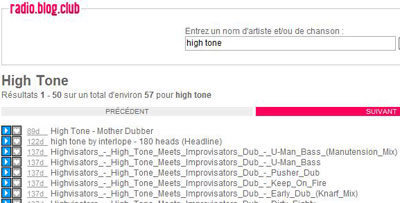
La
page d’accueil de Radio.blog.club, un des pionniers malheureux
du streaming musical en France.
La
frontière entre l’offre « légale »
et les sites pirates est
donc bien plus floue
que ce que l’on veut bien nous faire croire. Beaucoup des sites
dits « légaux » ont commencé leur
existence aux marges de la légalité. Par ailleurs, on
remarquera qu’aussi bien Grooveshark que Radio.blog avaient
clairement l’intention de rémunérer les artistes.
Des plateformes »légales » comme Deezer
et Spotify, toujours actives aujourd’hui, sont de leur côté
régulièrement
pointées du doigt
pour les sommes dérisoires par écoute qu’elles
reversent aux créateurs. Et peut-être est-il bon ici de
rappeler que lorsque MegaUpload a été fermé en
2012 par une intervention manu militari du FBI, il était à
la veille de lancer une offre MegaBox payante,
dont 90% des revenus auraient été reversées aux
artistes. Certains sont allés jusqu’à dire que
c’est même sans doute une des raisons qui ont précipité
sa perte, car les titulaires de droits auraient eu trop peur que
leurs offres légales ne fassent soudain « pâles
figures » à côté de cette nouvelle
piste de financement pour les artistes.
La
frontière entre le légal et l’illégal ne
passe donc pas nécessairement par le fait de rémunérer
ou non les créateurs…
Comment
les plateformes « achètent » leur
survie…
Pourquoi
les ayants droit se sont-ils acharnés à ce point sur
Grooveshark, alors qu’ils laissent subsister des plateformes
proches dans leurs principes de fonctionnement, comme YouTube ou
SoundCloud ? Certes, il y a bien sûr le fait que Grooveshark a
commis l’énorme erreur de faire partager des fichiers à
ses propres employés, ce qui le rendait beaucoup plus facile à
abattre en justice. Mais au-delà de cela, YouTube et
SoundCloud ont accepté de faire évoluer graduellement
leur modèle pour trouver un terrain d’entente avec les
titulaires de droits.
YouTube
a par exemple des accords de redistribution de recettes publicitaires
qu’il génère avec certains producteurs, ainsi
qu’avec des sociétés d’auteur comme
la SACEM en France.
Par ailleurs, il a déployé un système de
filtrage automatique des contenus chargés par ses
utilisateurs, le
fameux ContentID,
dit aussi « Robocopyright ». Cet algorithme
fonctionnant à partir d’empreintes des fichiers
fournies à YouTube par les titulaires de droits assure
une forme de « police privée du droit d’auteur »,
en distribuant des sanctions (les « strikes »)
aux utilisateurs qui chargent des contenus sans respecter le droit
d’auteur. Le système permet à la plateforme
d’exercer une surveilance constante des contenus, sans perdre
le bénéfice de sa responsabilité allégée.
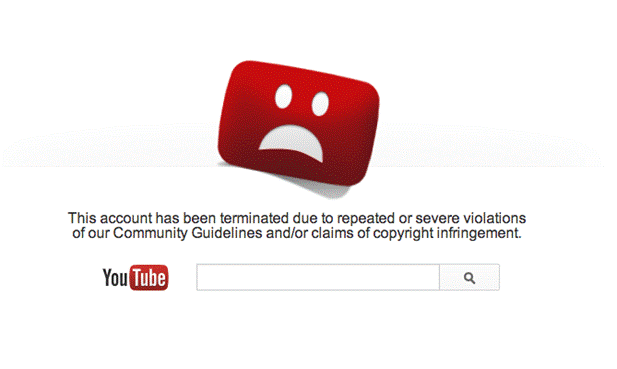
Les
sanctions infligées par ContentID peuvent aller jusqu’à
la fermeture des comptes d’utilisateurs et il est difficile de
contester, même dans les cas d’erreur manifeste du robot.
SoundCloud
a connu exactement la même trajectoire. Un robocopyright a
aussi été progressivement déployé pour
filtrer les contenus et
la plateforme a récemment noué un partenariat
avec la société Zefr
pour améliorer son efficacité. Cette évolution
lui a permis de commencer à nouer des accords avec
Warner Music,
mais les négociations continuent toujours avec les autres
majors. Au passage, l’implantation du robot a eu des
conséquences non négligeables pour les
utilisateurs. Car SoundCloud a longtemps été réputé
comme un lieu privilégié sur la Toile pour le partage
des mixes et des compilations de DJs. Or son algorithme repère
automatiquement les empreintes des oeuvres qu’il est chargé
de surveiller, sans distinguer s’il s’agit de morceaux
entiers ou d’extraits réutilisés dans des
créations dérivées. Depuis quelques temps, les
DJ postant leurs mixes sur SoundCloud font donc l’objet de
sanctions à répétition, et une grande vague de
retraits a même
commencé depuis le partenariat avec Zefr,
à tel point que la
communauté envisage à présent de migrer.
SoundCloud en sera plus « propre », mais aussi
bien plus pauvre…

SoundCloud,
de plus en plus en guerre avec la communauté des DJs.
D’une
certaine manière, on peut dire que deux plateformes comme
YouTube et SoundCloud ont « acheté leur survie »
en acceptant de déployer ces systèmes de police privée
du droit d’auteur. Pour les utilisateurs, cela signifie aussi
qu’il faudra dorénavant se soumettre à une forme
de « robotisation » de l’application
du droit, provoquant de
plus en plus de dommages collatéraux.
Même
s’il change profondément leur nature, ce « deal »
peut s’avérer juteux pour les plateformes. YouTube par
exemple a lancé depuis la fin de l’année une
offre de musique en streaming sur abonnement
à partir des contenus partagés sur sa plateforme. En
termes de profondeur de catalogue, il est le seul qui puisse être
comparé à Grooveshark, parce que son principe repose
aussi sur une alimentation par la foule.
Son
modèle passera par des abonnements proposés aux
utilisateurs en échange d’une suppression de la
publicité qui devient de plus en plus envahissante sur
YouTube. Evidemment, YouTube – et Google derrière lui,
propriétaire du site – a négocié le
montage de cette offre avec les majors de la musique. Mais la
plateforme n’a pas hésité au passage à
utiliser sa puissance pour
tordre le bras des producteurs indépendants,
qui ont été sommés d’accepter des termes
contractuels défavorables sous peine d’être
éjectés de l’offre gratuite.
En
attendant l’extra-judiciarisation de la censure…
Le
seul point « positif » – si l’on
peut s’exprimer ainsi – dans la fermeture de Grooveshark,
c’est qu’il aura quand même fallu un procès
en bonne et due forme pour arriver à ce résultat. On
reste encore dans le cadre d’une décision de
justice, offrant un minimum de garanties pour les droits de la
défense. L’étape suivante que visent à
présent les titulaires de droits, c’est d’être
en mesure de contourner la justice pour faire pression directement
sur les plateformes avec l’appui de l’Etat.

La
justice est aveugle. Elle risque de le devenir au sens propre en
matière de droit d’auteur, à mesure que
s’étendent les stratégies de contournement mises
en place par les titulaires de droits (Image par Nemo. Domaine
Public. Pixabay)
C’est
une tendance lourde que l’on voit actuellement monter à
travers des concepts comme « l’auto-régulation
des plateformes » ou la mise en place de moyens
extra-judiciaires de lutte contre la « contrefaçon
à échelle commerciale », telle la
Charte récemment négociée en France
sous l’égide du Ministère de la Culture à
propos de la publicité en ligne. Le prochain Grooveshark ne
sera pas condamné par un juge : il sera éjecté
de l’écosystème par un
système de censure privée organisé sur une base
contractuelle entre les titulaires de droits et des intermédiaires.
C’est d’ailleurs ce qui avait commencé avec
Grooveshark, puisque Google avait
accepté en 2013
de ne plus afficher le site dans ses suggestions de recherche, avant
même que le jugement final ne
soit rendu en 2014.
Ce type de réactions des intermédiaires techniques
risque de se généraliser.
L’évolution
du streaming dans la musique montre d’ailleurs à quel
point un concept comme celui de « contrefaçon
commerciale » ou de « site massivement
contrefaisant » est évanescent. La différence
entre Deezer, YouTube et Grooveshark n’est qu’une
différence de degrés et pas de nature. Ceux qui
acceptent « d’acheter leur survie »
pourront subsister, mais à condition d’évoluer
vers des modèles de plus en plus problématiques pour le
respect des libertés…
***
La
fin de Grooveshark n’est qu’un épisode de plus
dans la guerre globale au partage qui se livre aujourd’hui.
Cette issue brutale doit aussi nous rappeler que le meilleur moyen de
résister – et de rendre l’écosystème
du partage sain et résilient – est de favoriser les
formes de partage non-marchand les plus décentralisées, comme
le P2P. C’est d’ailleurs là, et notamment au
sein des communautés privées de partage,
que subsiste encore dans toute sa richesse la « Longue
Traîne de la musique ». Ces dispositifs s’appuyant
sur une architecture distribuée ont en effet la vertu
d’éviter la constitution de plateformes centralisés
pouvant être abattues en justice, ou pire, transformées
progressivement en monstruosités
sous la pression des titulaires de droits.
Et
au-delà, il reste essentiel de
réclamer la légalisation du partage non-marchand et la
mise en place de financements mutualisés pour la création,
comme la contribution créative, qui sont les seuls moyens à
la fois de sortir de cette spirale répressive et d’assurer
une rémunération équitable des créateurs.
Collé
à partir de
<http://scinfolex.com/2015/05/03/la-fin-de-grooveshark-et-le-prix-a-payer-pour-la-survie-des-plateformes/>