
24/05/2015
Petite histoire des couleurs de nos écrans
Claire Richard | Journaliste
La couleur de nos écrans est le résultat d’une collaboration entre art et science dans les années 60-70, nous explique la chercheuse Carolyn Kane, qui craint une homogénéisation de notre culture visuelle.
Aujourd’hui, la couleur sur nos écrans va de soi. N’importe quel logiciel de traitement d’images propose des palettes de milliers de couleurs et nous avons pris l’habitude d’utiliser les filtres pour rehausser les teintes du réel de nos photos, trop mornes sur nos téléphones.
Mais il y a derrière cette facilité une histoire invisible : il n’a pas été simple d’amener la couleur sur nos écrans, et ce faisant, les couleurs numériques ont changé de nature.
C’est ce que nous raconte la chercheuse américaine Carolyn Kane, qui vient de publier « Chromatic Algorithms », la première histoire de la couleur dans les médias électroniques et numériques.
Rue89 : D’où vous vient cet intérêt pour les couleurs ?
Carolyn Kane : Quand j’étais petite, comme beaucoup d’enfants, j’étais très attirée par les couleurs vives, fluo, pailletées... Plus tard, j’ai fait des études d’art et j’ai fait des films, de la photo, du webdesign, de l’art numérique... Puis j’ai commencé une thèse. Et je me suis intéressée aux couleurs dans les médias électroniques parce que je me suis rendu compte que dans la plupart des œuvres d’art numérique que j’aimais, dans les années 2000, il y avait très peu de couleurs. Alors même que nous étions maintenant censés avoir accès à des millions de couleurs sur nos écrans.
En me plongeant dans l’histoire des couleurs électroniques, j’ai découvert que lorsque les artistes ont commencé à collaborer avec des ingénieurs et des scientifiques, dans les années 60 et au début 70, ils ont amené la couleur dans un médium et un format qui ne se prêtait pas forcément bien aux formes graphiques et visuelles.
Car les ordinateurs et les technologies informatiques sont à l’origine des outils militaires et mathématiques, qui parlent le langage des chiffres et des statistiques. Quand les artistes ont commencé à arriver dans ces laboratoires et ces centres de recherche, ils ont importé des techniques venues du cinéma et de la peinture. Ce moment passionnant de collaboration entre les arts et la science a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd’hui l’art numérique.
Vous commencez votre histoire de la couleur sur les écrans par celle de la télé couleur, qui a été beaucoup plus compliquée à faire que ce qu’on imagine...
Quand nous sommes sur Internet, nous ne pensons pas aux couleurs, parce qu’elles disparaissent derrière le contenu. La couleur se fond dans le contenant, parce qu’elle a été maîtrisée et contrôlée.
Mais au début, les couleurs étaient complètement incontrôlables. Dans les années 30, les couleurs en Technicolor étaient très difficiles à stabiliser. Au début, on ne pouvait les trouver que dans les dessins animés pour enfants, seul endroit où pouvaient passer ces couleurs crues, pas du tout réalistes ! Avant ça, des artistes et des techniciens de cinéma teignaient la pellicule ou la peignaient, pour obtenir des couleurs très expressives.
Puis dans les années 60, beaucoup de choses fascinantes se sont passées dans le champ de la couleur. L’industrie a commencé à s’intéresser sérieusement à la télé couleur parce que le cinéma couleur commençait à lui faire concurrence sur le créneau du réalisme.
Mais c’était aussi le développement de la contre-culture, avec le développement et la standardisation des couleurs fluo... Cette époque-là a vraiment vu l’explosion d’un monde de couleurs, et c’est dans ce climat qu’est né l’art électronique.

Capture d’écran du clip de « Let’s Groove » (1981) du groupe Earth, Wind & Fire. Les effets vidéo - des arcs-en-ciel lumineux bougeant sur la musique - ont été produits par Ron Hayes, avec sa machine Scanimate
Par la suite, quand l’industrie et le commerce ont appris à fabriquer la couleur et à la produire à grande échelle, celle-ci est devenue moins éclatante. C’est un processus qu’on retrouve dans l’histoire de la télé, au cinéma, dans la photo, l’informatique.
A cette époque, beaucoup des artistes et des ingénieurs qui travaillent sur ces nouvelles couleurs pensent que celles-ci ont une certaine dimension mystique, qu’elles vont créer de nouveaux états de conscience... Ça semble complètement fou aujourd’hui.
Quand de nouvelles couleurs apparaissent grâce à la technologie, on assiste souvent à une célébration un peu euphorique. Dans les années 60 et 70, ces nouvelles couleurs synthétiques étaient élaborées dans des centres de recherche par des ingénieurs et des scientifiques qui travaillaient avec des artistes. Ainsi, les premiers synthétiseurs vidéo permettaient de fabriquer des couleurs entièrement neuves, qu’on n’avait jamais vues. Celles-ci semblaient confirmer les idées générales de l’époque : des formes de fusion entre conscience humaine et machine, des visions utopiques de ce qu’allaient permettre ces nouvelles technologies.
Et de grosses entreprises comme Bell, IBM ont joué un rôle important dans ces expérimentations avec la couleur, en finançant des centres de recherche, en accueillant scientifiques et artistes… Quel intérêt avaient ces entreprises à financer toutes ces folles expériences avec la couleur ?
C’était une époque très différente d’aujourd’hui. C’était après la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de gens talentueux, des ingénieurs, des scientifiques, quittaient l’Europe pour les Etats-Unis, et un grand nombre se sont retrouvés dans les centres de recherche comme IBM, Bell Laboratory, Xerox Park, Stanford Research Institute… Par ailleurs, de nombreuses technologies avaient été développées pendant la guerre sans application ou usage immédiat.
Dans ces centres, les projets visionnaires et la recherche à long terme étaient bienvenus. On y accueillait des musiciens, comme John Cage, des expérimentateurs comme l’artiste Lillian Schwartz… Cet environnement très libre et coopératif a produit de nombreuses avancées importantes dans l’art vidéo et la couleur.
Mais à la fin des années 70 et 80, le climat institutionnel a commencé à se modifier. Les industries se sont recentrées sur la recherche du profit et ont privilégié les projets à plus court terme, plus sûrs en termes de revenus.
De plus, dans les années 80, les artistes avaient maintenant accès aux PC et aux logiciels pour faire de l’art électronique et ils avaient beaucoup moins besoin d’aller voir ces centres de recherche.
Vous décrivez le passage des folles explosions de l’art vidéo aux logiciels grand public comme une « remise en rang » de la couleur, qui va de pair avec sa « démocratisation ». Que voulez-vous dire par là ?
Au début, les programmeurs et les artistes qui voulaient générer des couleurs pour le « computer art » devaient souvent apprendre la programmation ou le code, ou bien travailler avec quelqu’un qui les connaissait. Pour produire des couleurs, il fallait partir de zéro. C’était donc une façon très matérielle et technique de comprendre la création des couleurs. Bien sûr, ce n’est pas absolument indispensable, mais ça ajoute une dimension à la pratique artistique.
Ça a disparu avec l’arrivée des PC et des logiciels. Aujourd’hui, la couleur numérique s’apparente plus à du prêt-à-porter : il suffit de choisir sur un sélecteur de couleurs.
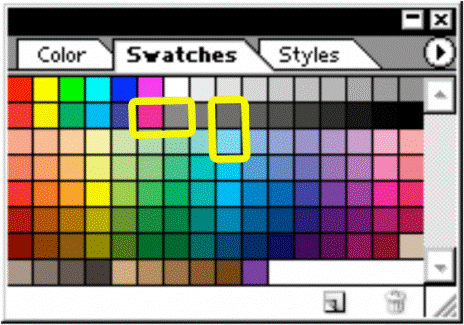
Palette d’Adobe Photoshop, montrant comment les couleurs changent de nuance selon celles à côté desquelles elles sont placées.
S’intéresser à la matérialité des couleurs et à leur histoire est une bonne façon de comprendre pourquoi notre culture visuelle ressemble à ce qu’elle est.
Justement, vous évoquez l’esthétique dominante du Web d’aujourd’hui, que vous appelez, avec d’autres, le « look 2.0 ». Ça ressemble à quoi ?
Le terme « Web 2.0 » a été développé au début des années 2000, par Tim O’Reilly. On était juste après le crash de la bulle des « dot-com », et ce terme servait à évoquer un renouvellement, une vie continue d’Internet, notamment dans le monde de l’e-commerce et du business. Et avec le Web 2.0 est venue une certaine esthétique, très populaire chez les firmes d’un Internet qui se tournait de plus en plus vers la consommation : Google, eBay, Facebook..
Ces plateformes ont un look similaire : des logos avec des lignes claires et rondes, des couleurs primaires, souvent des fonds blancs. C’est très différent des graphismes des années 90, plus « DIY » et faits maison, avec des contours irréguliers. Evidemment, ce design était né d’une nécessité, parce que l’Internet ne savait pas encore produire ces lignes claires. Mais ce design rudimentaire en est venu à définir le webdesign de cette période.
Et donc, après le look 2.0, un certain nombre d’artistes et de designers, frustrés par l’aspect de plus en plus commercial du Web, sont revenus à ce style « crade » des premiers graphismes du Web.
Aujourd’hui, il existe une tension entre ce look très clean de l’entreprise et le look plus « crade » d’artistes contemporains, qui s’en servent pour attirer l’attention sur le fait que l’Internet peut aussi être une forme artistique et se le réapproprier pour ne pas en laisser toute la propriété aux entreprises.
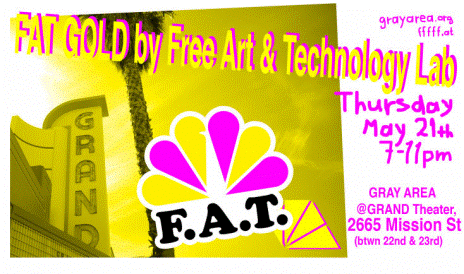
Capture d’écran d’une affiche d’expo pour le collectif Free Art and Technology (2015)
Vous écrivez que la « démocratisation » de la couleur a fait disparaître le côté expérimental et visionnaire du Web... Mais elle a aussi permis à beaucoup plus de personnes de s’emparer des couleurs, de pouvoir elles-mêmes se livrer à des expérimentations sur leurs téléphones...
C’est vrai, c’est très marrant d’ajouter des filtres sur son téléphone, et c’est vrai que ça ouvre beaucoup de possibilités très intéressantes pour le design de jeu, l’industrie, l’architecture...
Mais ne savons pas du tout quelle est l’histoire de tout ceci. Prenez l’exemple des filtres sépia, qui donnent ce côté rétro, années 70, aux photos. Pourquoi le côté « vieille pellicule désaturée » nous fait penser au passé ? Parce que dans les années 70, les réalisateurs de films indés passaient leurs pellicules à la javel pour désaturer les couleurs, en réponse aux couleurs vives utilisées à la télé et ailleurs.
Un autre exemple, c’est celui des filtres Hipstamatic. Avec eux, nous pouvons rendre une photo bleue, violette, rose ou verte – mais rien d’autre. Nos choix sont étroitement encadrés, et nous ne savons pas du tout par qui et comment ces paramètres sont établis.
Puisque les constructeurs ne peuvent pas non plus offrir une kyrielle de choix, quelqu’un, quelque part, fait une sélection parmi toutes les couleurs possibles. C’est plus pratique, plus facile à utiliser pour un plus grand nombre de gens. Mais c’est aussi une sélection très étroite parmi les choix possibles. C’est important de garder ça en tête.
Vous critiquez aussi beaucoup le discours de la « transparence de la technologie », selon vous complètement illusoire...
Une grande partie du discours autour des nouveaux médias tourne autour de concepts comme « le partage », « l’ouverture », « la transparence ». Ce discours sert à promouvoir l’idée des réseaux sociaux comme d’une communauté sans danger, d’une vie sociale sans risque. Mais la façon dont fonctionnent ces applications et dont les données sont collectées et structurées est en réalité très opaque. Nous acceptons des conditions d’utilisation que nous ne comprenons pas bien et nos données sont vendues à des entreprises que nous ne connaissons pas non plus. C’est très, très loin d’être transparent, malgré le discours de partage et d’ouverture.
L’autre grande transformation de la couleur dans le numérique, expliquez-vous, c’est qu’elle est devenue « algorithmique ». Qu’est-ce que ça veut dire ?
Dans la photo ou le film, la pellicule capture littéralement la lumière des choses, la conserve et nous la restitue, grâce à l’intervention de produits chimiques.
Les appareils photo ou les caméras numériques fonctionnent différemment. Ils enregistrent la lumière sur une plaque photosensible mais la transforment ensuite en une abstraction mathématique, une série de zéros et de un.
Ces chiffres sont ensuite mis en correspondance avec un index, qui indique à quelle couleur et à quelle position dans l’image ils correspondent. Cette couleur est ensuite simulée sur l’écran.

Index des couleurs avec les codes HTML correspondants
Contrairement à la couleur dans l’analogique, la couleur que l’on voit sur une image numérique est indirecte et abstraite. Car cette abstraction mathématique se tient entre la chose et son image. C’est ce que je veux dire par « couleur algorithmique » : la couleur n’est plus générée par notre expérience tangible, mais elle passe par des algorithmes. Ce sont les algorithmes qui nous rendent la couleur.
Mais ça, est-ce que c’est visible à l’œil nu ? Est-ce que les couleurs de nos ordinateurs sont différentes de celles de la vidéo ?
Les couleurs des films de 35 mm ou de 16 mm sont plus rouges, plus saturées, parce qu’elles sont plus riches en information. Les couleurs numériques sont plus froides, tirent plus vers le bleu ou le vert, parce que l’information est plus compressée et que le bleu et le vert sont des couleurs que l’œil perçoit plus facilement.
Si vous concevez un système informatique et que vous cherchez à transmettre le maximum d’informations en un minimum d’espace, vous allez orienter la palette vers les bleus et les verts. L’image prendra moins de place et l’œil sera toujours capable de distinguer les différences dans l’image. Petit à petit, ceci devient alors la norme.
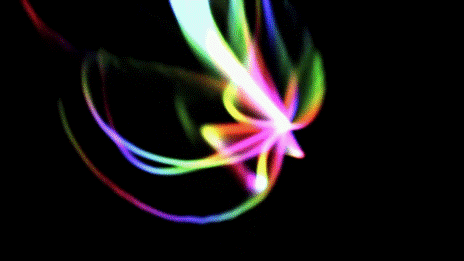
« Flurry », économiseur d’écran pour Mac (vers 2014)
A la lecture du livre, on a le sentiment que vous êtes très préoccupée par une forme d’homogénéisation, de « lissage » du monde.... d’une perception sans heurts et sans accrocs.
Oui, c’est aussi lié à cette idée du « monde algorithmique » (« algorithmic lifeworld ») que je développe.
Si une grande partie de notre culture visuelle est générée par les mathématiques et les algorithmes, qu’est-ce que ça dit de notre mode de pensée ? Si nous utilisons les maths, une façon rationnelle de diviser des chiffres, pour comprendre les relations qui nous unissent et le monde qui nous entoure, qu’est-ce que ça change ? Qu’est-ce que ça change par rapport aux modèles antérieurs où la poésie, la nuance, le romantisme... jouaient un rôle plus important ?
Je pense que chez les jeunes artistes qui travaillent avec les couleurs numériques, dans le « glitch », il y a moins de romantisme, de sens d’enchantement. C’est souvent plus décalé, plus ironique, plus cynique... parce qu’ils travaillent avec un médium qui impose des paramètres très rigides sur ce qu’il est possible de faire.
Mais que peut-on faire si on veut élargir son monde de couleurs sur le Web ?
C’est encore en sortant faire un tour dans la rue et en faisant vraiment attention aux couleurs hors des écrans que l’on peut développer un solide sens des couleurs pour les ramener ensuite dans le champ de l’ordinateur.
Cela dit, je ne veux pas du tout tenir un discours apocalyptique. D’ici une dizaine d’années, nous entrerons probablement dans un nouveau cycle, où apparaîtront de nouvelles couleurs et de nouvelles façons de les produire, dérivées des technologies actuelles.
Collé à partir de <http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/24/aujourdhui-couleur-numerique-sapparente-a-pret-a-porter-259290>