
Pourquoi avons-nous tant de mal à changer d’avis ?
23/04/2019

On n’en a pas fini avec les biais cognitifs, ces déviations du jugement qui sont au coeur du fonctionnement même de nos façons de penser. Dans un livre court et très pédagogique, le psychologue et docteur en neurosciences Albert Moukheiber, cofondateur de l’association Chiasma, nous explique comment Notre cerveau nous joue des tours (Allary éditions, 2019).
Comment peser sur ces biais ? Comment apprendre à se défier de nos certitudes, de nos souvenirs qui sont bien plus reconstruits qu’on ne le croit ? Comment se mettre à distance de soi-même, de nos opinions qui sont souvent bien plus approximatives qu’on ne le pense, pour mieux faire société ? Comment se défier de notre besoin d’explications simples et rassurantes face à la complexité du monde ? Tels sont quelques-uns des enjeux que soulève ce petit traité, très accessible, qui souhaite nous inviter à nous réconcilier avec nos capacités de jugements. À l’heure où nos outils technologiques nous permettent d’évaluer et de juger plus vite que notre ombre, nous avons besoin d’être plus critiques que jamais sur nous-mêmes !
Comment filtrons-nous et interprétons-nous le monde pour le rendre cohérent ?
Albert Moukheiber nous prend par la main dès ses premiers chapitres et rappelle à quel point notre cerveau déforme – ou plutôt re-forme la réalité afin d’en tirer du sens en permanence. Quelques expériences visuelles (comme celle de la danseuse, déjà exposée dans l’interview que réalisait MaisOùVaLeWeb) viennent démontrer que nous filtrons et interprétons le monde qui nous entoure afin d’en dégager une vision globale et cohérente. Ainsi, notre cerveau est capable de combler les vides, en quelque sorte. Si vous lisez la phrase suivante : « C’35t cmmoe ca qu3 v0u5 3t2s enrtian de l1r3 c3tt3 l1gn3 » ? vous créez quelque chose de compréhensible à partir d’un non-sens, si l’on s’en tient à la stricte réalité de l’extrait (un assemblage plus ou moins hasardeux de chiffres et de lettres). Pour le dire simplement : nous ne supportons pas le flou, le cerveau a toujours besoin de nous raconter une histoire, c’est la « réduction de l’ambiguïté ». C’est le même mécanisme qui, il y a quelques années, a divisé les internautes à propos de la couleur de la fameuse « robe infernale » (bleue ou blanche, selon les cerveaux), les deux groupes avaient en réalité raison, mais n’ont pas réduit l’ambiguïté de la même manière. Comme le dit la formule : « nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, mais plutôt tel que nous sommes ».
Ce monde que nous recréons en permanence nous permet d’être « en cohérence avec nous-mêmes » et de réduire certains conflits, ou dissonance cognitive.
Certaines maladies neurologiques sont à ce titre très illustratives, certains patients inventent littéralement des choses pour réduire l’ambiguïté, c’est la confabulation. En 2007, un enfant devenu aveugle et qui se cognait partout expliquait qu’il faisait cela pour jouer. L’explication est la suivante : il était atteint d’une agnosie visuelle, c’est-à-dire que sa cécité était localisée au niveau cortical et non rétinien, il était aveugle « du cerveau » et toujours persuadé qu’il voyait correctement.
En jouant sur ces mécanismes – de façon moins extrême – les scientifiques Elizabeth Loftus (voir sa conférence Ted) et John C. Palmer ont réussi à modifier des souvenirs d’étudiants à qui on avait montré un accident de voiture. Ils devaient dire si les vitres de la voiture avaient été brisées ou non lors de l’impact. Ceux à qui on posait la question avec le mot « smash » plutôt qu’avec le mot « hit » étaient beaucoup plus enclins à affirmer que ce fût le cas. En réalité, la vidéo ne montrait pas de vitres brisées. Elizabeth Loftus a utilisé des techniques de suggestion équivalentes et a réussi à convaincre 25 % de cobayes qu’ils s’étaient perdus dans un centre commercial lorsqu’ils étaient petits. Il suffit donc de quelques mots pour modifier des souvenirs…
Le gaslighting est une autre forme détournement cognitif qui s’appuie sur une manipulation de la mémoire : « il s’agit de faire douter sa victime de sa mémoire ou carrément de sa santé mentale en présentant certains faits de façon tronquée, en modifiant quelques éléments du souvenir initial en lui disant qu’elle a tout inventé, ou qu’elle perd la raison. » Albert Moukheiber nous raconte également l’expérience du psychologue Petter Johansson (voir sa conférence Ted) dans laquelle on demande aux cobayes de choisir la plus jolie de deux femmes sur photo, on leur présente ensuite l’image qu’ils n’ont pas retenue pour savoir pourquoi ils ont choisi cette photo. La majorité des personnes testées justifie ce choix bec et ongles, par la forme du visage, le sourire, etc. Ce phénomène, la « cécité au choix », montre que nous sommes capables de justifier a posteriori des choix que nous n’avons pas faits. Autre exemple : de nombreuses entreprises utilisent pour recruter le test de personnalité MBTI, dont on sait pourtant qu’il n’est absolument pas fiable. Mais il y a eu tellement d’investissements qui ont contribué à faire croire que ce test marchait, qu’un retour en arrière est difficile…
Ces petits exemples entrent tous dans la catégorie des biais cognitifs, sur lesquels Albert s’attarde : le biais d’ancrage par exemple, fait que dans un énoncé, nous avons tendance à retenir la première information qui nous est livrée. On jugera mieux une personne « sympathique et un peu colérique » qu’une personne « un peu colérique et sympathique »… La preuve par l’anecdotique intervient quand nous justifions un raisonnement par un exemple anecdotique (« je connais quelqu’un qui… »), le biais de confirmation fait que nous avons tendance à préférer les informations qui nous confortent dans nos croyances et renforcent nos opinions (ce biais a été notamment au centre de beaucoup de questions concernant le mécanisme de bulles de filtre des réseaux sociaux comme Facebook). Bref, il existe des centaines de biais, qui ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils font partie de notre mode de fonctionnement. Mais les biais cognitifs n’ont pas qu’un impact individuel. Les choses deviennent réellement intéressantes lorsqu’on en constate les effets à plus vaste échelle !
De nos biais personnels à leurs effets sur la société
C’est là un autre apport intéressant du livre de Moukheiber qui entre de plain-pied dans des questions de société, comme celle du dérèglement climatique. Dans sa partie « Ce sur quoi j’ai prise et ce qui m’échappe », le spécialiste explique que d’une part, nous avons énormément de mal à traiter ce genre de problématiques lointaines, car notre cerveau n’y est pas spécialement préparé. C’est un peu le même mécanisme qui sévit chez les fumeurs : « Si nous n’avions ne serait-ce qu’une « chance » sur dix de développer un cancer trente minutes après avoir fumé une cigarette, il n’y aurait probablement pas de fumeurs dans le monde. »
Le chercheur expose ainsi la théorie de Julian Rotter selon laquelle il existe schématiquement deux types de personnes : « ceux qui croient que les événements ne dépendent que d’eux » et « ceux qui pensent que ces événements sont le fait de facteurs extérieurs ». La première catégorie a ce qu’on appelle un locus de contrôle interne (LCI), les autres ont un locus de contrôle externe (LCE). Selon qu’on penche d’un côté ou de l’autre, on se sent plus ou moins impuissant ou en capacité d’agir face à un problème. De même, on se permet de plus ou moins juger les autres en fonction de son propre locus. Albert résume : « Croire que nous n’avons pas prise sur notre environnement et sombrer dans l’inaction, voire dans l’apathie est un piège. Croire que nous sommes omnipotents et que tout dépend de notre seule volonté est aussi un piège. »
Un autre phénomène longuement décrit est « l’illusion de la connaissance » : nous sommes toujours persuadés de mieux comprendre le monde que nous ne le comprenons vraiment. Quand nous abordons un sujet nouveau, nous passons souvent en premier lieu par un pic de confiance, avant de réaliser – ou non – que nos connaissances sont extrêmement limitées et que toute information supplémentaire complexifie le sujet. Ce parcours cognitif s’appelle l’effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance, et peut se schématiser selon le graphique qui suit :
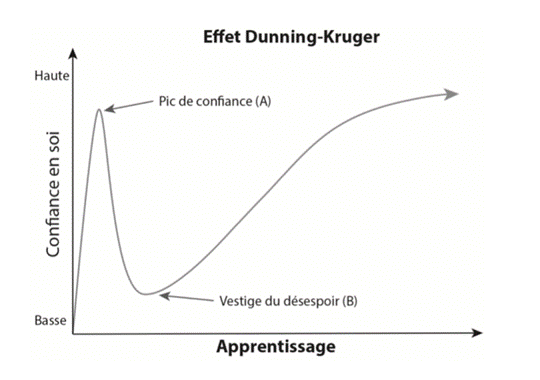
Les effets sur la société sont palpables. Ce genre de biais explique pourquoi, très schématiquement, les gens qui ont confiance en eux sont souvent promus alors qu’ils sont incompétents. À l’inverse, certaines personnes surdouées ont tendance à se sous-estimer. Combinés, ces deux effets donnent lieu à des absurdités : « des personnes sous-compétentes dirigent des personnes sur-compétentes » !
Albert Moukheiber va jusqu’à mettre le Brexit ou certaines critiques anti-OGM sur le compte de ces biais. Au lendemain du Brexit, la requête numéro 1 sur Google était : « Qu’est-ce que le Brexit ? », et la numéro 2 « Qu’est-ce que l’Union européenne ? ». Quant aux OGM, aucune étude scientifique ne vient prouver qu’ils sont néfastes pour la santé. Mais le fond du propos de Moukheiber est plus prudent : il rappelle justement qu’il ne faut surtout pas renvoyer les individus à leurs biais. À cet effet, il critique la mode du « débiaisage » qui sévit à l’échelle des États ou de la banque mondiale et écrit : « les biais cognitifs ne sont pas immuables, ils ne sont pas absolument positifs ou négatifs, mais dépendent de plusieurs facteurs : ils sont contextuels. Il serait plus intéressant d’apprendre pourquoi certains biais émergent dans certaines situations que de les combattre à tout prix. »
C’est là un point très important, me semble-t-il. En effet, la mode des biais cognitifs a tendance à obstruer la juste analyse des origines de certains problèmes (individuels et/ou collectif), ce qui donne lieu à des solutions inappropriées, comme le fameux débiaisage. Il est malheureusement devenu commun de renvoyer un adversaire idéologique à ses biais cognitifs, juste pour le discréditer. C’est une forme d’essentialisation à l’intérieur de laquelle deux dangers couvent : le premier consiste à croire qu’une personne biaisée a tort par principe, et que sa voix politique est juste le reflet d’un manque de compréhension de la situation. À l’inverse, on pourrait tout aussi bien avancer que ces biais et perceptions réduites dénotent un vécu et un quotidien qui demandent à être exprimés et écoutés plutôt que rejetés. Si on s’arrête aux simples biais, on est vite tenté d’affirmer qu’il suffira de faire plus de pédagogie pour que les gens comprennent ce qu’il faut comprendre et votent « correctement ». C’est le fameux : « cette réforme n’est pas acceptée, car elle n’est pas comprise, donc il faut faire de la pédagogie ». Le second danger consiste à reporter sur l’individu et son cerveau ce qui relève de vastes problèmes de sociétés. Or les électeurs ne votent pas Trump ou pour le Brexit parce qu’ils sont biaisés, mais parce qu’il y a une envie d’en découdre, parce que les richesses sont mal réparties, parce qu’ils ont le sentiment de ne pas bénéficier du progrès, et pour tout un tas d’autres raisons. Les activistes anti-OGM de leur côté n’ont pas comme seul argument dans leur besace les questions sanitaires, mais aussi une critique plus globale de certains modes de production. À trop se focaliser sur les biais, on en oublierait presque le contexte.
Albert Moukheiber revient justement sur cette question essentielle dans la suite de son ouvrage. Il rappelle à juste titre que le fonctionnement de notre cerveau et la façon dont nous percevons la réalité varient énormément en fonction du contexte. Nos prises de décision sont liées à nos états psychologiques, au temps qu’il fait ou encore à l’heure de la journée. Le fait d’être pressé par exemple nous pousse à être beaucoup moins empathiques, à ne plus s’arrêter dans la rue pour secourir quelqu’un. Le fait que nous soyons seuls ou plusieurs influence aussi notre comportement : une expérience de simulation d’une crise d’épilepsie dans un lieu public a montré que « 85 % des passants aident la victime s’ils sont seuls sur les lieux de l’accident, 62 % s’ils sont avec une autre personne et 31 % seulement s’il y a plus de quatre autres témoins. Plus les témoins sont nombreux, moins ils agissent, car ils ne se sentent pas aussi responsables que s’ils étaient seuls et que tout ne dépendait que d’eux ». Ce phénomène, c’est celui de la diffusion de la responsabilité. Dans d’autres circonstances, on a prouvé que nous sommes meilleurs pour répondre à des questions de culture générale quand nous sommes par petits groupes de cinq. Individuellement ou dans des groupes plus vastes, nous sommes moins précis. Ce sont là des arguments massue pour tempérer certains discours du moment qui expliquent tout par le quotient intellectuel ou la génétique : les humains ne sont pas des monades isolées, nous vivons en commun dans un monde qui bouge et qui nous influence énormément. Au regard de ce qu’Albert Moukheiber explique, on comprend que le fait d’être intelligent – suivant les critères très discutables du QI – n’assure en rien que nous prendrons les meilleures décisions. Une évidence toujours bonne à rappeler.
Du doute constructif : attribuer un indice de confiance à ce que l’on pense
Il existe bien sûr, à titre individuel, des façons de se prémunir de certains biais. Comme le dit l’adage, si nous ne sommes pas responsables de ce que nous ressentons, nous pouvons agir sur ce que nous faisons de ce que l’on ressent. C’est la conclusion du chercheur qui donne dans ces dernières pages quelques pistes intéressantes pour agir sur ce que nous pensons (c’est ce qu’on appelle la méta-cognition). Nous pouvons par exemple attribuer à nos croyances un pourcentage de fiabilité : « Le but de ces indices de confiance est de savoir à quel moment douter, et à quel moment nous faire confiance en adoptant un mode de pensée graduel (j’en sais beaucoup / j’en sais peu) plutôt que binaire (je sais / je ne sais pas) ».
Moukheiber nous invite également à nous méfier des procédés fallacieux comme la preuve anecdotique, les arguments d’autorité, ou encore les fausses équivalences : « ce n’est pas parce qu’un homme politique a commis des exactions qu’il faudra soutenir que toutes les figures d’autorité politique sont « pourries ». Moukheiber plébiscite un doute constructif, tourné vers soi et non pas seulement vers les autres. D’ailleurs, la lecture de cet ouvrage – que je recommande vivement – ne vous servira strictement à rien si vous n’êtes pas disposé à changer d’avis et à remettre en cause certaines de vos croyances.
Je ne fais ici que retracer quelques éléments de ce bouquin qui fourmille de bonnes petites idées. Après l’excellent Petit cours d’autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon et le non moins agréable Petit traité de manipulation a l’usage des honnêtes gens de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, « Votre cerveau vous joue des tours » est un génial petit manuel qui nous aide à mieux nous connaître et à douter sainement. À ajouter sans aucune hésitation à votre bibliothèque.
Irénée Régnauld
Irénée Régnauld (ire1) est le fondateur du blog Mais où va le web ? (@maisouvaleweb) et cofondateur de l’association les Moutons numériques (@MoutonNumerique), un collectif qui questionne l’innovation. Cet article a été initialement publié sur Mais où va le web ?
Collé à partir de <http://www.internetactu.net/2019/04/23/pourquoi-avons-nous-tant-de-mal-a-changer-davis/>