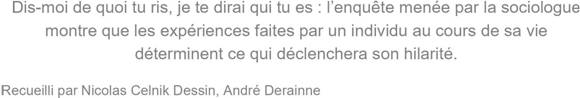
Libération - samedi 11 décembre 2021 Idées
Laure Flandrin «Nous rions de ce qui nous fait
peur, mais aussi de ce qui nous est proche»
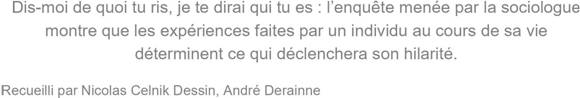
La marche de l’histoire tient parfois à un éclat de rire. Ce fut le cas en 1550-1551, lors de la controverse de Valladolid. Une cour d’ecclésiastiques devait alors déterminer si les Amérindiens avaient une âme, ou s’ils étaient une forme d’humanité inférieure qui pouvait être réduite en esclavage. Convaincu que ce qui distingue l’homme de l’animal est la faculté à rire, le légat du pape présente aux Amérindiens des bouffons et acrobates - qui laissent les Indiens de marbre.
On les imagine alors prêts à se faire mettre les fers au cou jusqu’à ce que le cardinal, qui descendait de son estrade, rate une marche, s’effondre par terre, et déclenche l’hilarité générale.
Si les Amérindiens n’avaient pas ri des bouffons, c’est parce que ces derniers ne leur évoquaient rien. Or ce qui provoque le rire chez un individu dépend des expériences qu’il en a fait en société, a pu observer Laure Flandrin, maîtresse de conférences en sciences sociales à l’Ecole centrale de Lyon. Dans le Rire. Enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions (La Découverte, 2021), la sociologue expose le fruit d’une enquête menée de 2005 à 2016
auprès d’une quarantaine de participants, pour comprendre ce qui rend chaque individu sensible à certaines formes du comique. La première question que nous allions lui poser s’imposait tout naturellement.
Comment puis-je vous faire rire ?
Ma formation de sociologue me rend sensible aux formes de comiques qui mettent à jour les
mécanismes de domination, particulièrement dans le domaine économique. Je suis très réceptive aux humoristes, pas si nombreux aujourd’hui, qui tournent en dérision la vulgate néolibérale : Didier Porte, Guillaume Meurice, Pablo Mira avec le Gorafi.
Mais à l’image de mes enquêtés, j’ai du mal à répondre spontanément à cette question - et c’est normal. Le rire n’est pas une pratique réflexive, et les occasions d’expliciter ce qui fait rire ne se présentent quasiment jamais. En revanche, le comique est le genre culturel dont on parle le plus : c’est une des formes de capital culturel qui se prête le mieux à la conversion en liens sociaux. Les rieurs connaissent par cœur des extraits d’œuvres cultes qui reviennent dans les conversations. Parce que le rire ne s’improvise pas, malgré son caractère apparent
d’instantanéité, ils vont chercher matière à faire rire dans les œuvres comiques.
Face à un auditoire qui rit, vous affirmez qu’il faut enquêter sur la vie de chacun des participants pour comprendre comment le comique opère. Pourquoi ?
Le rire est une émotion sociale, pas simplement parce qu’on rit ensemble, mais aussi parce que les expériences qu’un individu fait dans la société déterminent ce dont il rit. Ces expériences qui nous constituent comme rieurs sont très fondamentales : apprentissage de la bipédie (d’où le rire que peut nous inspirer la chute d’un passant) et du maniement des objets techniques, rencontre avec les pouvoirs (politiques, spirituels), etc. Le rire transforme ces expériences, spécialement celles qui nous ont apeurés, en source de plaisir. Darwin et Freud ont très bien vu que nous rions de ce qui nous fait peur, mais aussi de ce avec quoi on ressent une certaine forme de proximité. Si l’objet du comique est inconnu, s’il n’inspire aucune forme de proximité affective, c’est la peur qui peut l’emporter sur le rire.
Quelle proximité ressent-on quand on rit des personnalités politiques ?
Mon enquête m’a permis d’identifier au moins quatre formes élémentaires du rire. Ce que j’appelle le «comique de dégradation» vise notamment les puissants et montre le souverain qui se décompose brutalement en un homme ordinaire, dominé par des pulsions et des passions basses. On moque les puissants parce qu’ils sont des professionnels de la représentation, et le comique fait découvrir la vulgarité sous le masque.
Une idée reçue consiste à imputer ce rire de dégradation aux rieurs «sans-grade», qui exprimeraient par le rire une forme de revanche symbolique. Or les enquêtés issus des milieux populaires les plus démunis culturellement, qui sont éloignés du cœur parisien du pouvoir et ne lisent pas la presse nationale, sont insensibles à cette forme d’humour. Je développe dans mon livre le cas de Marcel, qui se définit lui-même comme un «"petit paysan" du Sud-Est». La marionnette de Jacques Chirac dans les Guignols de l’info ne le fait pas rire alors que celle de Bernard Tapie lui semble bien plus amusante. C’est parce que la fonction présidentielle renvoie à une forme de souveraineté lointaine et intimidante, tandis que Tapie a démarré sa carrière politique sur une scène locale que Marcel connaît mieux. Rire, c’est reconnaître au coup d’œil. Parmi mes enquêtés, c’étaient donc plutôt ceux issus des classes aisées, bénéficiant d’un certain capital culturel et symbolique, dotés de ressources critiques, qui étaient les plus réceptifs au comique ciblant les politiques.
Vous avez également identifié le «rire de profanation» : de quoi s’agit-il ?
C’est un comique dérivé du comique de dégradation, mais qui s’applique au domaine du sacré. Là encore, il faut que les rieurs ressentent une proximité avec ce dont ils rient pour que le comique fasse effet. Au Moyen Age, ils rient surtout des membres du clergé séculier, et il leur
faudra du temps pour viser des autorités ecclésiastiques : le pape au XVe siècle, pendant les guerres de religion ; Dieu lui-même, puis les dogmes religieux, plus abstraits encore,
au XIXe siècle. Mais à long terme, la perte d’intimité avec les choses de la religion, du fait de la sécularisation très forte de la société, dévitalise ce type de comique.
Quelqu’un rate une marche et tombe, tout le monde rit. C’est un comique très universel, mais n’est-il pas, paradoxalement, de moins en moins opérant ? Buster Keaton ou Charlie Chaplin semblent très datés aujourd’hui.
Cette forme de comique joue sur la suspension temporaire des automatismes pratiques : marcher, coordonner son corps, etc. Si Charlie Chaplin ou Buster Keaton semblent aujourd’hui datés, c’est du fait de la disparition, ou du moins de l’invisibilisation, de la civilisation industrielle et matérielle. Ils exorcisaient les peurs engendrées par les machines que l’on voit dans les Temps modernes. Nous avons développé une dépendance vitale aux objets techniques, mais chaque période historique en rit sous des formes différentes.
Une forme de rire qui n’est sans doute pas près de disparaître, c’est le «rire de prétention».
Le comique de prétention est l’inverse du comique de dégradation : il ne s’agit plus de rire de la chute d’un puissant, mais de se moquer d’un petit qui veut se faire grand sans en avoir les moyens culturels. Les enquêtés qui se montrent sensibles à ce type de comique se caractérisent souvent eux-mêmes par un parcours d’ascension sociale resté inabouti. Ils ont buté sur des impasses qui les amènent à mieux percevoir la naïveté, et parfois le ridicule, de l’ambition face aux poids des structures sociales. Il y a là une part d’esprit de revanche, mais pas seulement. Ces rieurs reconnaissent dans ces personnages comiques une forme d’ambition qu’ils avaient forgée pour eux-mêmes. Une forme de proximité affective, parfois même de parenté avec le moqué, est d’ailleurs mise en avant. Le rire est l’émotion qui permet le mieux de restituer toute l’ambiguïté affective à l’égard de personnages qui paraissent méprisables mais qui nous ressemblent tant qu’on ne peut se résoudre à les dégrader totalement.
C’est d’ailleurs le cas de l’un de vos enquêtés, qui rit des femmes bourgeoises, qui sont pourtant celles qui le séduisent le plus.
Il s’agit d’Alexandre, un héritier bourgeois, fils d’un commerçant fortuné, manager dans l’événementiel, qui aime surtout rire de figures féminines bourgeoises ou aristocrates
(Valérie Lemercier dans les Visiteurs). On pourrait d’abord penser qu’il se moque d’elles pour les dégrader parce que ces personnages renvoient à des femmes qui le dominent dans le contexte professionnel : ce sont ses clientes et elles peuvent disposer d’un capital financier plus important que le sien. Il oppose donc au rapport de classe, qui joue en sa défaveur, un rapport traditionnel de genre qui le reclasse du côté des dominants, convaincu qu’il est que l’art de faire rire participe de la panoplie du charme masculin. Mais ce rire est également une manière de s’approcher de ces femmes et exprime un désir de converger - il dit le désir de faire partie d’un milieu social auquel il est imparfaitement intégré.
Vous montrez aussi que les femmes ne rient pas comme les hommes. Pourquoi ?
C’est en partie un legs du christianisme qui a forgé l’idée que le rire serait nécessairement dégradant et méchant. Les femmes ont donc été exclues du maniement du rire, d’abord parce qu’on attendait d’elles qu’elles soient bienveillantes et compassionnelles. Par ailleurs, les normes esthétiques qui se sont imposées à partir de la Renaissance ont érigé le sourire en topos des grâces féminines, mais ont vu dans le rire un vilain rictus susceptible de déformer la bouche et le visage. Enfin, le rire est suspecté d’enfreindre les normes de la bienséance, car il a fondamentalement affaire au sale et au vulgaire, autant de traits dont les femmes sont invitées à se détourner. Cela n’est donc pas un hasard si lorsque la scène comique s’est féminisée, dans les années 70 et 80, les femmes se sont d’abord emparées de sujets vulgaires - pensons à Jacqueline Maillan, à Sylvie Jolie, ou encore à Valérie Lemercier, qui manient une tension permanente entre élégance raffinée et vulgarité assumée.
Il reste de cette histoire culturelle que le rire féminin et le rire masculin sont encore différenciés. Le faire rire, plus que le rire lui-même, demeure d’ailleurs une chasse gardée du masculin : des travaux sur les petites annonces montrent que les femmes cherchent souvent un homme susceptible de les «faire rire», alors que la réciproque ne va pas de soi. Mais on observe aussi une tendance à rire, depuis l’intérieur de chaque genre plutôt que de genre à genre, des stéréotypes accolés aux deux sexes.
Peut-on rire sans se moquer ?
Il faut se méfier d’une interprétation qui ne verrait dans le rire qu’une forme de moquerie : c’est un héritage du christianisme qui se méfie du «rire mauvais», prolongé par la philosophie morale qui a conçu le rire comme une opération de mise à distance dénuée d’empathie. Mon enquête montre au contraire que même dans les cas du rire raciste, classiste et /ou sexiste, les rieurs ressentent une forme de proximité avec le moqué, qu’elle soit spatiale, sociale ou culturelle, qui implique une menace de contamination et provoque en eux une sorte d’urgence à se séparer. Je pense notamment au cas d’un rieur déclassé, élevé dans la bourgeoisie mais qui vit à présent à proximité d’immigrés dans un HLM, qui trouve dans le rire une manière de mettre à distance dans l’espace symbolique ce qui lui est devenu proche dans l’espace physique.
Inversement, le rire peut aussi moquer le racisme. Mais l’humoriste algérien Mohamed Fellag expliquait très bien à ce sujet que quand on prétend s’en moquer, on rit d’un effet de révélation sur soi : «Moi aussi, je suis comme ça ; moi aussi, je suis raciste». Y compris chez les enquêtés de la bourgeoisie culturelle qui revendiquent ce type de rire antiraciste par posture universaliste et tolérante, c’est le fait de réaliser, même très furtivement et très confusément, qu’on n’est pas aussi «éclairé» qu’on le croit, qui fait rire. Ces enquêtés n’ont pas une conduite raciste d’ensemble mais sont socialisés dans une société où circulent des stéréotypes racistes dont des bribes sont nécessairement intériorisées. C’est alors une partie honteuse de soi qui resurgit pour être immédiatement réenfouie. Là encore, rire, c’est reconnaître, mais sans que cet effet de reconnaissance de soi ne responsabilise, d’où l’immense plaisir pris au comique.
Laure Flandrin
Le rire. Enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions La Découverte, 400 pp., 24 €.