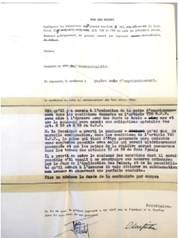
Des homos dans le « panier à salade »
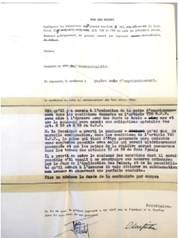
PV
du 23 janvier 1968 du tribunal de grande instance de
Strasbourg.
COLLECTION
PARTICULIÈRE
![]()
Ariane Chemin
Dans la France des années 1960 et 1970, les homosexuels sont encore des proscrits, souvent arrêtés par la police et poursuivis en justice. Quarante ans après l’abrogation du « délit d’homosexualité », « Le Monde » a retrouvé les traces judiciaires et, surtout, les derniers témoins de cette période
Qui savait, parmi les cinéphiles nantais du Katorza ? Qui pouvait imaginer que Jean-Serge Pineau et Henri Le Callonec, les gérants du cinéma d’art et d’essai de la place Graslin, avaient connu la prison avant de vivre plus de quarante ans côte à côte ? Leurs vies auraient pu inspirer un des films de leur programmation, mais leur passé n’était pas de ceux qu’on exhibe. Près de vingt ans après le décès de son oncle Henri, Alexandre Le Callonec, 39 ans, dévoile au Monde cette histoire d’amour d’un autre âge. Depuis la mort de Jean-Serge, fin 2020, ce neveu est bien plus que l’héritier officiel du couple disparu : le légataire d’un poignant secret de famille.
L’histoire se passe avant le 4 août 1982, date – largement méconnue – où un texte porté par Robert Badinter, garde des sceaux de François Mitterrand, abolit une loi promulguée pendant la guerre par Philippe Pétain et Pierre Laval. En autorisant les relations entre deux personnes consentantes de même sexe dès 15 ans – comme pour les hétérosexuels –, et non à la majorité légale, la nouvelle loi va aligner les droits des homosexuels sur ceux des autres. Mais, en attendant, les homosexuels âgés de 15 à 21 ans risquent des amendes, voire des peines de prison. Ainsi va la France des « trente glorieuses » : les « pédés », comme nos témoins se qualifient, sont des proscrits plongés dans l’intranquillité ou le déni.
Œil malicieux, moustache brune, Jean-Serge Pineau est le fils d’une famille nantaise de concessionnaires de voitures de luxe devenus exploitants de salles de cinéma. Il a 27 ans quand, fin 1959, il prend la gérance du Katorza, bel ensemble de salles où l’on vend des sucettes Pierrot Gourmand et dont les ouvreuses portent des gants blancs. La ville court y découvrir le dernier Rivette ou, en avant-première, le prochain Antonioni ; les 1 400 places du parterre, du balcon et de l’orchestre font le plein autour de Jean-Luc Godard, Marguerite Duras ou Jacques Demy, qui acceptent volontiers de participer aux débats enfumés proposés par Jean-Serge et Henri, devenu comptable puis directeur du cinéma.
Leur rencontre remonte au 22 novembre 1960 : une journée restée inscrite dans la mémoire intime du couple. Ce mardi-là, devant la grand-poste de Nantes, Jean-Serge Pineau croise un jeune homme à boucles blondes et aux faux airs de Marlon Brando. Henri Le Callonec doit fêter ses 17 ans quatre jours plus tard et apprend alors la « compta » dans un internat de Saint-Nazaire : il «sait » qu’il est homosexuel et a voulu fuir sa famille. Jean-Serge, de dix ans son aîné, a d’abord pensé, lui, que ses goûts pouvaient changer. Il a présenté plusieurs « amies » à ses parents, comme autant de leurres, et accepté de suivre un traitement à base de « piqûres », puisque sa famille le dit « malade ». Sans résultats, évidemment.
«Tiens, v’là le loustic de Jean-Serge », persifle M me Pineau mère, quand elle croise Henri dans la rue. Pour la bourgeoisie comme pour les ouvriers, l’homosexualité est alors une tare. Elle est d’ailleurs inscrite dans la liste des « maladies mentales » de l’Organisation mondiale de la santé. En novembre 1961, un an après leur rencontre, un homme, dont la famille Le Callonec souhaite taire le nom, dénonce les deux garçons à la police nantaise. Convoqué au commissariat, le père d’Henri confirme la relation entretenue par son fils. Une plainte pour « attentat aux bonnes mœurs », visant à la fois le jeune homme de presque 18 ans et Jean-Serge, 28 ans, est déposée au bureau d’ordre pénal du tribunal de grande instance de Nantes le 3 novembre 1961.
« Jean-Serge est parti à la montagne »
La loi promulguée en 1942 a été maintenue en 1945. Après la guerre, la reconstruction du pays passait en effet par une exaltation de la famille et de la natalité. La France a besoin de « 12 millions de beaux bébés », disait de Gaulle. Le Parti communiste et le MRP, formation chrétienne-démocrate, encadraient la vie politique comme deux blocs de moralité où l’hétérosexualité était la seule norme. La loi de Vichy survit ainsi à la IVe République. Elle se durcit même en 1960 : l’amendement Mirguet, du nom du député gaulliste de Moselle Paul Mirguet, fait de l’homosexualité un « fléau social », au même titre que l’alcoolisme et la prostitution. Et double même les peines en cas d’ « outrage public à la pudeur commis sur personnes de même sexe » : emprisonnement de six mois à trois ans, amende de 1 000 francs à 15 000 francs.
« Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, me découper en morceaux, je serai toujours pédé », aurait lancé Henri au juge, ce même 3 novembre. « Balancer ce qu’il a balancé à 17 ans, il fallait le faire ! », continuait de répéter fièrement Jean-Serge, des années plus tard, au sujet de son compagnon. Jean-Serge et lui sont incarcérés à la maison d’arrêt de Nantes, alors voisine du palais de justice, et jugés en correctionnelle sur citation directe. De tout cela, il ne reste aucune trace en 2022. Leur avocat, un ancien bâtonnier de Nantes, est décédé. Aux archives départementales, le dossier Pineau/Le Callonec a été détruit, comme ceux de tant d’autres affaires déjà anciennes.
Après moins de deux semaines de détention, l’un et l’autre sont placés en liberté provisoire. « “Jean-Serge est parti à la montagne”: voilà ce qu’on me disait quand, à l’âge de 9 ans, je m’inquiétais de l’absence de mon oncle aux déjeuners familiaux du dimanche », raconte Martine Pineau, l’une des nièces de Jean-Serge, exploitante de cinéma et régisseuse de spectacles de cabaret. Rares sont ceux qui ont entendu parler de cette brève parenthèse carcérale, épreuve qui a pourtant scellé leur destin. « La prison a transformé ce qui aurait pu n’être qu’une liaison en histoire d’amour, poursuit Alexandre Le Callonec. Pour apercevoir Henri dans sa cellule, Jean-Serge s’était mis de corvée de bibliothèque. Il lui glissait une lettre dans le livre qu’il donnait ou reprenait. »
Combien d’affaires de ce genre dans les décennies d’après-guerre ? Combien de jugements rendus entre la Libération et l’élection de François Mitterrand, en 1981 ? On l’ignore. Inconnue du grand public, la répression des homosexuels reste un angle mort de la recherche universitaire française. « Les dépouillements des archives commencent à peine. Tout ou presque reste à faire, indique Florence Tamagne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Lille et pionnière de l’histoire de l’homosexualité. Mettre des noms et des visages sur des statistiques, préserver la mémoire vivante, c’est aujourd’hui la priorité. » Ceux qui avaient 20 ans dans les années 1950 sont en effet très âgés, ou morts, parfois fauchés par le sida, responsable de 40 000 décès en France. La rage des mouvements militants qui surgissent alors, Aides en 1984, Act Up en 1989, l’urgence de leur combat face à l’épidémie mortelle ont renvoyé une génération dans l’oubli. « La persistance de l’homophobie et la honte d’avoir été condamné ont fait le reste», avance le sociologue Antoine Idier, auteur du livre Les Alinéas au placard. L’abrogation du délit d’homosexualité, 1977-1982 (Ed. Cartouche, 2013).
Dans un article publié en 2019 par la revue universitaire Déviance et Société, « Les sexualités “contre nature” face à la justice pénale. Une analyse des condamnations pour homosexualité en France (1945-1982) », deux jeunes sociologues de l’EHESS, Jérémie Gauthier et Régis Schlagdenhauffen, avancent « Le compte général de le chiffre de 10 000 « condamnations pour homosexualité » durant cette période. « Le compte général de la justice (statistique judiciaire annuelle, qui compile l’activité de tous les tribunaux français depuis 1820) permet d’atteindre ce nombre, assure le second. Parmi ces personnes, de courtes peines de prison -doublées pour les récidivistes- , des amendes, l’inscription au casier judiciaire... » Rapporté à l’année, cela revient à 270 condamnations par an en moyenne. C’est nettement moins qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne, deux pays qui ont pénalisé l’homosexualité jusqu’à la fin des années 1960. Mais aujourd’hui, cela semble stupéfiant.
Le sens du détail
D’autres travaux semblent confirmer l’usage assez limité qui aurait été fait de ce délit, malgré leurs méthodologies différentes. Doctorant à l’université de Lille, Sébastien Landrieux, qui s’intéresse depuis six ans aux homosexualités entre la fin du XIXe siècle et le milieu des années 1980, a passé au peigne fin les minutes et dossiers correctionnels des quatre décennies d’après-guerre dans le Nord, deuxième département français pour le nombre de condamnations liées à des délits à caractère homosexuel. « Ici, indique l’universitaire, deux tiers de ces affaires relevaient de la pédocriminalité », c’est-à-dire de faits concernant un enfant ou un adolescent de moins de 15 ans. Donc, à une époque où la pédophilie était peu signalée, elle générait dans le Nord davantage de condamnations que pour les relations homosexuelles avec des mineurs de 15 à 21 ans. Au fil des années, les classements par les parquets se faisaient en outre plus fréquents. « Quand nous avons aboli ce délit en 1981, confirme l’ancien ministre de la justice socialiste Robert Badinter, la répression judiciaire était tombée à 150 affaires par an. » Jusqu’à cette date, la menace continue de planer. Une cohorte invisible de garçons nés pendant ou après la guerre a vécu dans la hantise d’un contrôle d’identité et d’une « rafle » policière (c’était le terme employé), ou d’une dénonciation. Pour se figurer ce monde évanoui, il faut imaginer des quais, des brumes, des rues de boutiques obscures, et... des silhouettes d’hommes : l’historienne Florence Tamagne a montré que seule une petite centaine de femmes lesbiennes furent en effet arrêtées. « Les cibles étaient d’abord des ouvriers, indique Régis Schlagdenhauffen, pincés en général par deux, dans des régions industrielles comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, l’Ile-de-France... »
En étudiant le cas de la ville de Lyon, en 2010, le sociologue Antoine Idier a croisé la route d’un certain Jean-René B., né en 1956. Au milieu des années 1970, cet étudiant en droit puis en sciences humaines travaillait le soir comme barman dans un établissement de la rue Bellecordière, sur la presqu’île de Lyon, ou encore au Cercle, bar « homo », maquillé en association du quartier Saint-Jean. Vers minuit, les policiers du commissariat de la place Antonin-Poncet poussaient volontiers les portes pour contrôler les pièces d’identité. « Parfois même, précisait Jean-René B. à Antoine Idier, sans qu’on sache pourquoi, ils relevaient quelques noms. Et je peux vous dire que ça a causé la mort de quelqu’un. »
Un soir, un homme de 25 ou 26 ans, Grégoire B., premier clerc de notaire dans une étude lyonnaise, est embarqué par la police à l’Epi bar, autre établissement de la rue Bellecordière que Jean-René B. fréquentait. « C’est triste à dire, confiait-il, il y a onze ans au chercheur, moi, je faisais tellement de raffut qu’on m’a laissé partir une heure après, tandis que lui refusait de donner ses papiers et protestait: “Je suis juriste, ce que vous faites est illégal !” » Toujours selon Jean-René B., les policiers s’emparent de force des papiers de Grégoire B., tétanisé, puis le préviennent qu’ils vont avertir ses parents ainsi que son patron. Le clerc rentre chez lui au matin, se change et se rend au bureau. Le notaire le congédie. « Eh bien, Grégoire est reparti chez lui et il s’est pendu dans son garage, laissant ce mot à ses parents: “Papa et maman, je vous demande pardon.”»
Si, après 1968, la justice lève le pied, le zèle policier ne faiblit pas encore. « On ne mesure pas les conséquences sociales et familiales d’une arrestation pour des notables de province à l’époque, insiste Robert Badinter. Elles étaient terribles. Je pense au risque pénal, bien sûr, mais aussi au chantage exercé sur des notables qui se rendaient à Paris pour satisfaire ce qu’on appelait leur “vice”. L’homosexualité relevait de l’interdit; celui qui passait pour tel vivait entre le rejet social et la faute. Il faut se rappeler les structures morales de nos sociétés et la malédiction de l’homosexualité dans les religions du Livre. Il est dit dans la Bible: “Celui qui prend un homme comme une femme commet une abomination.” Des hommes élevés dans des écoles catholiques et l’idée du péché étaient ravagés par un sentiment de culpabilité. »
Remonter le fil de ces drames intimes relève d’un travail d’archéologue pénitent. A Nantes, Lille, Bordeaux, dans les archives, les affaires d’« actes impudiques ou contre-nature » sont noyées entre deux vols à la tire, trois cambriolages et une conduite en état d’ivresse: « Attendu qu’Eddie, coiffeur sans emploi», que «Michel, conducteur de wagons-lits », que «Jean-Paul, vendeur-libraire », que « Julien, professeur d’électricité », que « Philippe, attaché commercial », que «Gérard, sans profession », que «Dominique, étudiant » ont «commis un outrage public à la pudeur en se livrant à des actes ou des gestes obscènes dans un lieu public ou accessible au regard de tous... » Vertige.
Certains magistrats ne lésinent pas sur les détails. « Il résulte des débats à l’audience la preuve que Renato, cuisinier, marié, séparé de corps, se masturbait, le 28 novembre 1966, à l’intérieur d’une vespasienne au moment de son interpellation. » D’autres restent laconiques : sur un jugement de 1967, au moment de qualifier le délit d’Antoine, plâtrier, le greffier du tribunal de grande instance de Strasbourg a simplement noté: « homosexualité » – un délit qui, normalement, n’existe pas. Faut-il tenter de joindre les moins âgés d’entre eux ? Un certain D.N. se montre aimable et chaleureux, mais jure au téléphone que la personne que nous cherchons est un parfait homonyme, né le même jour que lui. Un autre numéro, et c’est une épouse âgée qui décroche, elle va aller chercher son mari – « Non, ce n’est pas la peine madame, désolée, j’ai dû faire une erreur. » Trop délicat. Trop bouleversant.
Raser les murs
Le chercheur Sébastien Landrieux nous attend au pied de l’église Saint-Maurice, tout près de la gare de Lille-Flandres. L’historien propose une visite guidée du Lille d’avant. C’est là, entre les absides, que draguaient naguère les homosexuels locaux, juste en face d’un presbytère où, en 1975, se tinrent les premières réunions de David et Jonathan, un mouvement homosexuel chrétien. Là, aussi, que fut construite la première « tasse », comme l’argot du XX siècle appelait ces pissotières publiques de forme circulaire, aujourd’hui disparues, devenues des lieux de ralliement : chacune avait son petit nom.
Son « gay tour » n’est pas banal : il n’y a plus rien à voir. Ici, l’emplacement fantôme du premier sauna homosexuel lillois, rue Saint-Jacques. Là, l’ancien café Gargantua, désormais Peacock Café, où « de vieux messieurs bien nés rejoignaient leurs jeunes amants à l’étage » : le service, uniquement par sonnette, les protégeait de toute intrusion intempestive. Toujours autour de la Grand-Place, l’Omnia, cinéma qui faisait des tarifs pour les militaires et où se croisaient, au balcon, des couples « homos », est devenu un restaurant. Un peu plus loin, le jardin Vauban, ses massifs à l’anglaise et son abri rocheux, blotti sous une cascade. Qui, aujourd’hui, connaît la « grotte de la Sainte-Verge », son surnom d’autrefois?
La visite serpente entre des terrasses riantes qui servent des gâteaux aux graines de sésame et des salades de quinoa. Comme le quartier parisien du Marais, comme la rue du Marché-au-Charbon, à Bruxelles, ces territoires se sont gentrifiés, et du Lille « homo » des années 1960 et 1970, il ne reste presque rien. Sébastien Landrieux s’assied à la terrasse du café Le Molière, aujourd’hui le Dracir, rue Trulin. D’ici, dit-il, entre 1920 et 1986 (date de sa fermeture), les «voyeurs » suivaient le manège des usagers de la « tasse » la plus fréquentée de Lille : deux rambardes d’accès menaient à des urinoirs souterrains, aux murs couverts de faïence blanche. « Une vraie souricière, dit le chercheur lillois. Un policier en civil descendait le premier, suivi d’un second en uniforme. J’ai appris que des usagers brisaient les ampoules pour plonger la “tasse” dans le noir et éviter d’être pris en flagrant délit. »
Si William Phillipps accepte de nous raconter sa vie quotidienne au temps des vespasiennes et des jardins publics, c’est peut-être parce qu’il n’a que 59 ans, qu’il est d’un naturel joyeux et, aussi, qu’il a gardé de bons souvenirs des années 1970. « J’ai la nostalgie sucrée », prévient en souriant cet employé d’un magasin Ikea au bar de l’hôtel où il a donné rendez-vous. Il a une autre raison. « A chaque fois que quelqu’un comme moi meurt, une lumière s’éteint », dit l’homme à l’œil noir et aux cheveux ébène. Comprendre : un témoin disparaît. William a grandi au Havre, cité de la Main rouge, entre huit frères et sœurs, un père docker et une mère femme de ménage, bientôt séparés. En 1982, lorsque le Parlement a abrogé la législation discriminatoire de Vichy, il avait 20 ans et ne connaissait rien de la loi en vigueur. « Je savais juste ce que je risquais. » Il commence son récit en faisant doucement tourner ses bagues autour de ses doigts. « A 13 ans, j’ai expliqué à mes parents que je n’aimais pas les filles. L’homosexualité, l’idée et le mot n’existaient pas. Ils ont cru que je plaisantais. »
Au milieu des années 1970, Le Havre ne compte aucun bar ou boîte pour les homosexuels. Lui se sent curieusement attiré par le fort de Sainte-Adresse, qui domine la ville et qu’il longe pour descendre se baigner à la plage. « A l’époque, il y avait encore des militaires dans la caserne», dit-il, et, autour du blockhaus, ce coin de forêt était devenu un lieu de rencontre, comme les alentours de la prison havraise. Certains antiquaires locaux fréquentent ces sous-bois, mais ils reçoivent surtout à domicile, pour des repas et des fêtes, avant, parfois, de filer à Deauville.
William participe à ces soirées. Il n’a alors que 14 ans. « J’ai toujours su ce que je faisais, réplique-t-il si l’on s’interroge sur son âge et celui de ses fréquentations. Je n’ai jamais été forcé, je n’ai jamais été agressé. J’aimais mes parents, mais ces hommes-là ont été pour moi des pygmalions. » Il a gardé de cette époque des reliques d’un autre monde – un carnet de bal en nacre ( « Tu ne vois ça que dans les films de Renoir »), une Bible reliée en ivoire – et le souvenir de conversations grisantes sur « l’opéra, Jean Genet ou Arletty ». Telle était alors l’homosexualité : une masse d’ombres grises, contraintes de raser les murs, mentant aux autres et parfois à eux-mêmes ; quelques personnages exubérants qu’on surnommait les « folles » et dont se moquaient le théâtre et le cinéma; et puis ces artistes et ces notables, de Normandie ou d’ailleurs, persuadés de ne pas faire de mal à ces adolescents de moins de 15 ans...
Fuite vers la ville... Le Havre est devenu trop petit pour les rêves de William. « J’avais besoin de liberté, d’anonymat. Alors, les vendredis soir, avec une amie, j’attrapais le dernier train pour Saint-Lazare, celui des militaires, où on n’était jamais contrôlé. » La drague y était tellement plus simple qu’ailleurs. Tricks, récit de Renaud Camus (l’homme qui promeut aujourd’hui le concept raciste et complotiste de « grand remplacement »), préfacé en 1979 aux éditions Mazarine puis chez P.O.L par l’éminent Roland Barthes, raconte ses « coups d’un soir » sans que la police pointe son nez. Dans le livre, les chambres de bonne sont parfois sordides, mais elles protègent les ébats des regards indiscrets.
L’épicentre du milieu < homo » parisien s’est déplacé depuis les années 1960. Après Saint-Germain-des-Prés, le quartier de l’Opéra tient désormais le haut du pavé. De la gare Saint-Lazare, le jeune William file découvrir le Louvre, « si beau », et explore ses environs. « Je me souviens, la première boîte proche du Palais-Royal où je suis entré offrait une consommation avec le ticket d’entrée. Je serrais fort le papier, mais je ne savais pas quoi commander. » L’homme qui le précède au bar commande « une Marie Brizard ananas ». Alors William répète, comme une formule magique: « Une Marie Brizard ananas. »
« Douleurs enfouies »
A-t-il croisé, devant les façades sombres des bars de la rue Sainte-Anne, l’ombre de Mic Guillaumes, de douze ans son aîné? Ce chorégraphe d’aujourd’hui 71 ans rôdait lui aussi dans le quartier de l’Opéra à la fin des années 1970, mais n’est pas plus parisien que le jeune Havrais : il s’était enfui de l’appartement familial marseillais quelques années plus tôt. « J’avais confié à mes parents mon goût pour les garçons. Ils m’ont emmené voir un psy, puis m’ont inscrit dans une école militaire. Alors, j’ai déplacé une armoire normande devant la porte de ma chambre et je n’ai plus bougé. Quand j’ai fini par quitter la maison, ils n’ont plus jamais demandé de mes nouvelles. »
Mic est plus timide que William. « Je traînais au Sept ou au Pimm’s, rue Sainte-Anne, parce que c’était la seule façon ou presque de rencontrer des personnes de même sexe, mais je n’aimais pas, c’était si anxiogène. Et puis, pour un étudiant, c’était cher. » Des Tuileries, ce jardin «ex-tra-or-di-naire » chanté par Charles Trenet dans un feu d’artifice de paroles cryptées et dont seuls les initiés comprennent le sens caché, Mic n’a pas gardé un très bon souvenir. Il se souvient trop des cars grillagés « prenant les allées tous feux ouverts et les policiers braquant leurs torches vers les bosquets. Tout le monde s’enfuyait en courant, une vraie sortie d’école ».
William préfère les pelouses escarpées du Sacré-Cœur aux allées bien tracées des Tuileries. « A gauche de la basilique, entre le mur et le funiculaire, c’est là que des garçons se retrouvaient pour draguer. On marchait et, quand il y avait un feeling, eh ben... Un jour, j’ai entendu des voix qui criaient: “Ne bougez pas !” Le garçon avec qui j’étais a couru, moi je me suis fait choper. Au commissariat, j’ai expliqué que étais fasciné par la magie des lumières qui illuminaient les arbres à chaque aller-retour du téléphérique – inventer, bricoler la vérité, c’était ça ma vie. » Les «flics » lui font la morale » mais le relâchent. Mai «, 68 est passé par là. La police elle-même commence à se lasser.
De toute sa vie, William Phillipps a été condamné à une seule amende, en 1980 – qu’il n’a « jamais payée ». Mic Guillaumes s’est fait embarquer à « huit ou neuf reprises » au poste, mais n’a jamais été poursuivi en justice. « Restent ces douleurs enfouies. Aujourd’hui je suis marié, mais il y a des choses que je ne peux pas dire: ce que je suis, ce que j’aime. J’ai été arrêté un jour alors que j’étais simplement assis à côté de quelqu’un sur un banc. Depuis, donner la main à un homme dans la rue, c’est une chose que je n’ai jamais pu faire, sans doute à cause de ces heures passées dans les frimas glacés à mendier des gestes furtifs volés à un monde sournoisement violent qui nous prenait pour des déviants... »