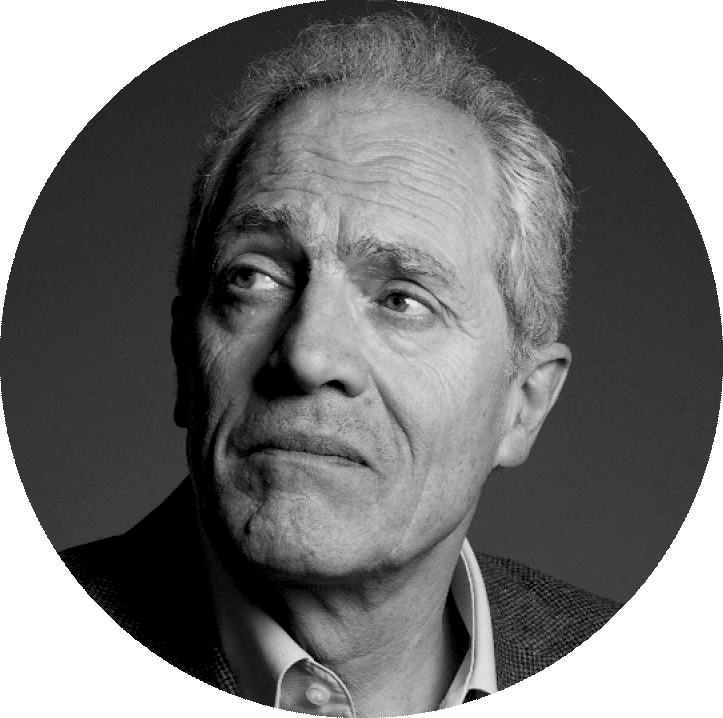
Le secret de Jorge Luis Borges, une conversation avec Jean-Pierre Dupuy
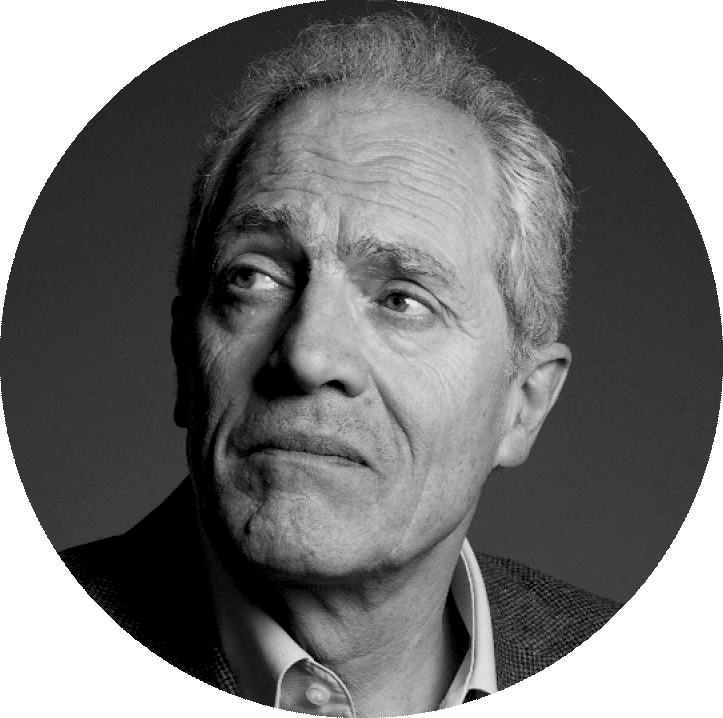
Jean-Pierre Dupuy — « Il y a une énigme Borges que je crois avoir en partie résolue. »
Nucléaire, fin des temps, violence et sacré — presque toutes les « obsessions » intellectuelles de Jean-Pierre Dupuy doivent beaucoup à Borges.
Le philosophe des catastrophes signe un essai vertigineux qui dévoile une clef de lecture inédite pour comprendre l’œuvre du maître argentin.
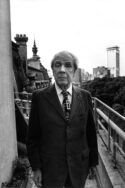
L’œuvre de Borges a toujours accompagné les travaux — et la vie — de Jean-Pierre Dupuy. En témoigne de façon juste et éloquente le nouveau livre que le philosophe français vient de publier aux éditions du Seuil, Vertiges. Penser avec Borges.
Entre essai de critique littéraire et biographie intellectuelle, Dupuy pense avec Borges — c’est-à-dire à ses côtés mais aussi avec son aide — sur certains des grands questionnements qui le passionnent depuis toujours : « peut-on changer le passé ? Une totalité est-elle réductible à une énumération ? Qu’y a-t-il dans un paradoxe qui ne se ramène pas à une contradiction ? »
Mais cela amène Dupuy à penser aussi sur Borges et par là même à proposer une lecture inédite de l’œuvre du génie argentin — notamment à partir de l’« affreux secret » de ce dernier…
Vous écrivez au début de votre passionnant Vertiges. Penser avec Borges que la lecture du maître argentin comblait dans votre jeunesse votre double sensibilité — et un déchirement : les sciences d’un côté et les lettres, de l’autre. Vous citez notamment cette phrase de certains critiques qui aurait pu synthétiser cela : « Borges, c’est de la littérature pour matheux ». Mais vous la récusez aussitôt. Pourquoi ?
Cette phrase se veut méchante et je la comprends comme disant que Borges, c’est de la littérature uniquement pour matheux, ce qui signifie que ce n’est pas de la vraie littérature.
Je parierais volontiers que c’est seulement ou surtout en France que l’on dit cela, car notre pays est celui où les intellectuels ont non seulement une formation uniquement littéraire, mais où il est de bon ton de se dire « nul en maths ». On n’inviterait pas à France Culture quelqu’un qui ne saurait pas si Victor Hugo a vécu avant ou après la Révolution française.
Mais un autre qui serait fier d’avouer qu’il n’a aucune idée de ce à quoi une spirale logarithmique peut bien ressembler susciterait de petits rires de connivence. Je reconnais là l’influence de Heidegger et de sa distinction entre pensée calculante et pensée méditante. Heidegger n’a rien compris à la mathématique. Il n’a pas compris que ce n’est pas le calcul qui la définit, mais la reconnaissance des formes.
C’est la forme qui fascine Borges mais il sait très bien que « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface », comme disait Victor Hugo.
Pourtant il vous arrive aussi de faire de très belles analyses scientifiques pour ainsi dire, mathématiques de textes de Borges (comme de « L’approche d’Almotasim »). Faudrait-il dire plutôt, tellement c’est génial, « Borges, c’est de la littérature même pour matheux » ?
Étant donné ma réponse à votre question précédente, je dirais plutôt que Borges, c’est de la littérature pleine et entière, et que les lecteurs dotés de l’esprit mathématique, même s’ils ne sont pas mathématiciens de métier ou de sacerdoce, ont une longueur d’avance pour y pénétrer.
La littérature est pour moi très importante, mais je tiens que l’art suprême est la musique. Sans doute parce que la musique ne représente rien, elle est pure forme. Les rapports entre la musique et les mathématiques ont été souvent soulignés. Il y a une poésie inhérente aux mathématiques, un accès à la transcendance que ceux qui se veulent « nuls en maths » se condamnent à ignorer. Cioran dit que la meilleure preuve de l’existence de Dieu, c’est la musique de Bach.
Au centre du cyclone, c’est le calme plat. Bien des utopies se situent là, ensorcelantes car inaccessibles.
Jean-Pierre Dupuy
Vous expliquez que c’est un « choc esthétique » qui marque d’abord votre rapport à Borges. Pourriez-vous revenir sur cela ?
Mon éditrice, Christine Marcandier, a eu l’idée géniale de concevoir un bandeau pour mon livre qui représente… une spirale logarithmique.
Le monde des spirales est comme la classification chinoise du monde animal selon Borges, qui a inspiré Foucault. Il est impossible de les classer en catégories claires et distinctes. La spirale d’Archimède est la plus bête. Elle part de son centre et s’enroule autour de lui en volutes de plus en plus amples qui l’éloignent à jamais. La spirale logarithmique, c’est l’inverse. Elle s’enroule autour d’un centre en volutes de plus en plus proches de lui, mais sans jamais l’atteindre. C’est une figure à la Derrida déconstruisant le structuralisme en exhibant des structures dont le centre ne fait pas partie de la structure. C’est la figure du vertige. Le centre absent a un pouvoir d’attraction incomparable, bien théorisé par Sartre. Il est difficile de s’arracher à la tentation de se jeter dans le vide. Ce centre absent est un leitmotiv permanent dans l’œuvre de Borges.
Soyons plus concrets. Vous avez certainement vu des photos de cyclones, par exemple Katrina recouvrant la Nouvelle Orléans. Au centre, nommé l’œil, et contrairement à l’usage qui veut de plus en plus que l’on y voie la violence tourbillonnaire la plus déchaînée, c’est le calme plat. Bien des utopies se situent là, ensorcelantes car inaccessibles.
J’évoquais la musique. Le premier accord de l’opéra de Wagner, Tristan et Isolde, l’un des sommets de la musique occidentale, n’a jamais cessé de faire disserter les musicologues. Quelle que soit l’interprétation retenue, il est indéniable qu’il a sur l’auditeur un effet massif, où la beauté tragique de la mélancolie se mêle à la frustration de l’absence de résolution. Il n’y aura pas de résolution, sauf à la toute fin dans l’accord de si, quatre heures et demie plus tard, lorsque les deux amants seront enfin réunis dans un amour qui se confond avec la mort. C’est une des raisons pour lesquelles j‘ai débuté ce livre par une lecture du film le plus métaphysique d’Alfred Hitchcock, Vertigo, indissociable de la partition de Bernard Herrmann, laquelle s’inspire de l’opéra de Wagner.
Borges, c’est Tristan en littérature.
Certains parlent de « borgien » ou « borgésien » quand « ils rencontrent un certain style », écrivez-vous. Comment définiriez-vous ce mot ?
Très souvent, et pas seulement dans les milieux littéraires, il arrive qu’une référence soit faite en passant à Borges, comme si cela allait de soi et que tout le monde comprenait de quoi il s’agissait.
On n’a pas besoin d’en dire plus, comme si l’homme et l’œuvre étaient des « données » qu’on pourrait cerner par des définitions.
Aujourd’hui, alors que j’ai accompli les recherches qui ont abouti à ce livre, et que la spécificité du cas Borges m’apparaît dans toute sa complexité, il m’est difficile de revenir en arrière et de faire comme s’il n’y avait pas une énigme Borges qui précisément n’allait pas de soi. Car il y a une énigme, que je crois avoir en partie résolue.
Borges vous a accompagné tout au long de votre carrière, de vos travaux et vous l’avez relu pour l’écriture de ce livre. Diriez-vous que vous avez toujours le même rapport à son œuvre ? Y a-t-il toujours ce « choc esthétique », s’est-il déplacé — ou autre chose a pu prendre le dessus ?
J’ai procédé selon la méthode qui se nomme en ingénierie le « reverse engineering ».
Cela consiste à partir du résultat accompli — en l’occurrence, mes travaux — et à chercher comment on y est arrivé. J’ai filtré cette recherche rétrospective en me limitant aux cheminements de pensée qui impliquaient l’influence de Borges. De là, je suis passé à l’œuvre et, plus haut encore, à l’homme.
Il m’est difficile de revenir en arrière et de faire comme s’il n’y avait pas une énigme Borges qui précisément n’allait pas de soi.
Jean-Pierre Dupuy
Ce faisant, j’ai fait des découvertes qui m’ont bouleversé, y compris sur moi-même.
C’est à l’adolescence que j’ai commencé à lire Borges et à m’imprégner de ses obsessions. J’étais amateur de romans policiers et de récits de science-fiction et j’étais séduit par ce que ces genres devenaient sous sa plume. On y trouvait une dimension fantastique qui me fascinait, naissant de la conjonction de la logique et de l’étrangeté. Les êtres humains semblaient y figurer seulement pour illustrer des concepts. Mais j’étais frappé par le fait que tout un ensemble de contes échappaient à cette description. Ils mettent en scène des hommes et des femmes aux prises avec des situations extrêmes où la violence et, dans une moindre mesure, le sexe, sont au premier plan. Ils ont leur propre étrangeté. Les héros s’y révèlent être des traîtres, les hommes d’action des couards, les êtres fascinants des leurres, les alpha-mâles des puceaux.
Je ne sais comment l’intuition m’est venue que ces deux catégories de contes étaient complémentaires, les premiers illustrant les propriétés purement formelles des seconds.
Mais il me manquait une clef, la clef qui ouvrirait l’énigme Borges.
D’une certaine façon, ce livre est l’œuvre de toute une vie.
Mais c’est seulement il y a quatre ou cinq ans que je me suis décidé à m’acquitter de la dette que j’avais contractée à l’égard de Borges, en révélant, avant tout à moi-même, tout ce que je lui devais. Les recherches que j’ai menées m’ont assez rapidement conduit à découvrir un trait de la biographie de Borges que j’ignorais totalement mais qui s’est révélé être la clef que je cherchais. Elle touche aux rapports qu’il entretenait avec les femmes.
Borges aimait la compagnie des femmes et il avait un immense besoin d’elles, matériellement d’abord, étant donné sa cécité précoce, mais aussi, et sans doute surtout, affectivement. Jusqu’à la mort de sa mère, alors qu’il avait presque 76 ans, il vécut avec elle. Il se maria, à l’âge de 67 ans, mais ce mariage ne dura pas plus de trois ans. Toutes ses aventures féminines connurent le même sort. On peut même décrire Borges comme un amoureux permanent, transi, se trouvant à chaque instant ou bien en proie à une passion dévorante dont dépendait sa vie, croyait-il, ou bien pris dans les affres d’un échec pitoyable. Dans le meilleur des cas, il sut transformer l’amour en amitié.
J’éprouve une grande compassion pour cet homme qui sut sublimer sa détresse et sa honte et les transformer en une œuvre littéraire majeure.
Jean-Pierre Dupuy
L’un des chefs d’œuvre de la littérature française, Armance, le premier et peut-être le meilleur roman de Stendhal, publié sans nom d’auteur en 1827, met en scène un brillant mais taciturne jeune homme, fraîchement sorti de Polytechnique, Octave de Malivert. Il est amoureux d’une jeune fille, Armance, qu’il va finir par épouser avant de se suicider une semaine plus tard. Octave est une énigme, qu’il formule lui-même ainsi, s’adressant à sa fiancée :
« Ai-je besoin de vous jurer que je vous aime uniquement au monde, comme jamais je n’ai aimé, comme jamais je n’aimerai ? Mais j’ai un secret affreux que jamais je n’ai confié à personne, ce secret va vous expliquer mes fatales bizarreries. »
Jamais le mot n’apparaît dans le roman, mais les lecteurs ne s’y sont pas trompés : Octave est sexuellement impuissant. Nous avons tous les indices nécessaires, et même les preuves, pour dire que ce fut le cas de Borges.
Jamais il ne fit l’amour à une femme.
Il en résulta une souffrance inouïe. J’analyse une partie de son œuvre comme un appel désespéré au lecteur : « Vous savez maintenant. Eh bien, méprisez-moi ! »
J’en ai assez dit pour pouvoir répondre enfin à votre question au sujet du choc esthétique que fut pour moi la lecture de Borges et ce qu’il est devenu. Sachant ce que je sais, et constatant que personne n’en parle, j’éprouve une grande compassion pour cet homme qui sut sublimer sa détresse et sa honte et les transformer en une œuvre littéraire majeure. J’éprouve aussi de la colère pour l’éditeur de Borges dans la Pléiade, Jean Pierre Bernès, qui, ignorance, naïveté ou fausse pudeur, ne dit mot de l’« affreux secret » de Borges.
Comment expliquez-vous cet angle mort dans l’étude critique de l’œuvre de Borges ?
Sans doute un reste de cette théorie littéraire funeste qui veut que la littérature ne fasse référence qu’à elle-même.
La biographie des auteurs ne devrait intervenir en aucune manière dans l’analyse et l’interprétation de leur œuvre. Certes, mais que vaut cet interdit si l’on peut montrer que c’est seulement à la lumière de l’expérience vécue de l’auteur que le texte prend tout son sens ?
Je crois avoir fourni cette démonstration dans le cas Borges.
Votre démarche peut néanmoins paraître assez surprenante dans la mesure où on aurait plus tendance à associer Borges à l’universel ou à l’abstraction — plutôt qu’aux émotions amoureuses. Comment réussissez-vous à confirmer cette lecture ?
Cette lecture, c’est Borges lui-même qui nous incite à la faire ! Si on ne s’en est pas aperçu avant, c’est dû à l’insensibilité des critiques et à l’inattention des lecteurs.
Dans plusieurs de ses contes où la violence et le sexe jouent un rôle, l’écrivain Borges met en scène des doubles de lui-même qui eux ont des rapports sexuels, souvent après avoir fait montre d’un acte de bravoure — comme s’il fallait mériter par la violence l’accès au corps des femmes. L’un de ces contes, sans doute l’un des plus beaux de son auteur, a pour titre Le Congrès. Ce mot désigne le projet qu’une poignée d’individus ont formé de bâtir : le « Congrès du monde ». Borges l’écrivain sait pertinemment que ce mot désigne aussi l’acte sexuel. Le dictionnaire Littré précise : « Congrès : Épreuve qu’ordonnait autrefois la justice pour constater, en présence de chirurgiens et de matrones, la puissance ou l’impuissance des époux qui plaidaient en nullité de mariage. » Ce conte est donc celui où Borges est reçu avec succès à ce congrès-là.
Je pourrais multiplier les exemples comme je le fais dans le livre. Certains se récrieront : mais c’est de la littérature ! Ce sont eux les aveugles, et non l’écrivain argentin.
Il y a aussi la poésie, dont Borges se sert pour nous dire, certes à mots couverts, le mal qui le ronge. Ainsi de ce poème bizarrement nommé « H. O. ».
Borges a 73 ans et il imagine ce qu’aurait été sa vie si une compagne l’attendait, le soir venu, dans la paix d’un foyer. Il conclut :
Ces choses ne sont pas. Autre est mon sort :
Les vagues jours et la mémoire impure,
Le long abus de la littérature,
Et ce mystère avant la mort, la mort.
Je ne veux qu’elle, et je la veux totale,
Abstraite : les deux dates sur la dalle.
L’Octave de Stendhal s’est suicidé. Borges est mort à Genève le 14 juin 1986. Il m’arrive quand je suis dans cette ville de m’incliner devant sa tombe, au cimetière de Plainpalais.
Pourquoi pensez-vous que Borges, eu égard à ce jeu permanent dans ses textes de « la représentation qui coïncide avec le représenté » (p. 56), n’a pas cherché à mettre en scène plus la présence — et moins la disparition comme dans « L’Aleph » ou la séparation dans « Le Congrès » — de l’être bien-aimé ? On aurait pu penser que la dynamique de la performativité omniprésente dans son œuvre aurait pu motiver un tel choix…
Vous pourriez ajouter la Madeleine de Vertigo, qui n’est ni disparue ni séparée, mais, comble de l’absence, qui n’aura été qu’une fiction — une fiction dans cette fiction qu’est Vertigo. Certes, ce n’est pas Borges, mais ma lecture l’est.
Votre question nous ramène à la spirale logarithmique par laquelle nous avons commencé.
Elle ne prend sens que par rapport à un point, son centre, qui lui reste extérieur. Ce centre est présent par son absence. Isolde ne peut pas devenir Madame Tristan, comme le remarque Denis de Rougemont. Dans « L’Aleph », que vous citez, le narrateur Borges se félicite que Beatriz, la femme aimée, soit morte : « en de certaines occasions, je le sais, ma vaine passion l’avait exaspérée ; morte, je pouvais me consacrer à sa mémoire, sans espoir mais aussi sans humiliation. »
Les totalités de Borges sont des leurres, conçus pour noyer l’entité que l’on veut cacher, ou bien que l’on veut atteindre sans que cela soit su.
Jean-Pierre Dupuy
Pourriez-vous revenir sur cette magnifique phrase appliquée par Borges sur Borges en suivant la méthode de Plotin : « Borges est tous les hommes, et chaque homme est tous les hommes et Borges » ?
Pourquoi le nom de cet hôtel qui existait à Paris près de la Bourse, « Hôtel de l’Univers et du Portugal », nous fait-il sourire ?
Sans doute parce que le Portugal est une partie si minuscule de l’univers que sa mention est complètement superflue. Comme nous fait sourire l’histoire du gardien du musée d’histoire naturelle qui fixe l’âge de l’imposant tyrannosaure qui trône au milieu de la salle à soixante millions et six ans parce qu’on lui a dit que l’animal était vieux de soixante millions d’années lorsqu’il a pris son service il y a six ans.
Mais ici, le supplément, c’est Borges — et Borges ne se voit pas comme un homme.
Il cache cette honte en se fondant dans la totalité des hommes. Il est tous les hommes de la même manière que chaque homme est tous les hommes, cela ne le distingue en rien. Son sort est finalement commun à tous les hommes : « Ce que fait un homme c’est comme si tous les hommes le faisaient », écrit-il dans un de ses contes les plus beaux (« La forme de l’épée »). D’où cette formulation complexe en ouroboros.
La fin du chapitre sur Vertigo se clôt ainsi : « Voilà pourquoi la vraie forme de Vertigo n’est pas le cercle, mais bien le cercle qui veut se refermer sur lui-même mais qui n’y parvient pas : c’est la spirale descendante, la plongée tourbillonnante dans l’abîme. » Pourrait-on dire exactement l’inverse de « La Biblioteca de Babel », quelque chose comme : « ‘La Biblioteca de Babel’ est un cercle qui veut se refermer sur lui-même et qui y parvient : c’est la spirale ascendante, l’ascension ou l’élévation tourbillonnante vers les cieux » (en pensant notamment à la dimension illimitée de la bibliothèque et de cet « élégant espoir » de la dernière phrase de la nouvelle) ?
Votre lecture est légitime, mais ce n’est pas la mienne.
Plusieurs contes de Borges mettent en scène des totalités : la totalité des points de l’univers (« L’Aleph ») ; la totalité des livres (« La Bibliothèque de Babel ») ; la totalité des événements mutuellement exclusifs (« La Loterie à Babylone ») ; la totalité des chemins possibles (« Le Jardin aux sentiers qui bifurquent »).
Mon interprétation est que ces totalités sont des leurres, conçus pour noyer l’entité que l’on veut cacher, ou bien que l’on veut atteindre sans que cela soit su. Hérode sait qu’un bébé vient de naître qui, un jour, prendra sa place, mais il ne sait pas lequel : il les fait tous massacrer. Tous les points sont dans l’Aleph, mais le seul qui compte est celui qui démontre l’impuissance de Borges. Il y a peu de chances qu’on le repère. Un livre, sans doute, dit le sens de la Bibliothèque puisqu’ils sont tous présents. Un homme, sans doute, l’a lu ou le lira. Mais ni le livre ni l’homme ne sont ni ne seront connus, pas plus que ne l’est la proposition de Gödel dans un système d’axiomes cohérent, une proposition qui est à la fois vraie et non démontrable. L’absence d’un point fixe repérable est ce qui crée le vertige : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » (Pascal).
Le concept à construire est celui de nécessité rétrospective. C’est ce concept qui est au cœur du récit de Borges.
Jean-Pierre Dupuy
Pourquoi « l’avenir est inévitable, mais il peut ne pas avoir lieu » ?
Le conte de loin le plus difficile et le plus sophistiqué que Borges ait jamais concocté a pour titre « Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ». C’est celui qui m’a conduit à mes recherches les plus abstraites, celles qui portent sur la métaphysique de la temporalité. L’intrigue de ce récit d’espionnage n’intéresse visiblement pas Borges. Il y est question d’une œuvre qui est à la fois labyrinthe et livre, et qui se révèle être le temps. Ne jamais parler du temps en termes d’espace, prescrit Borges citant Bergson. La métaphore du jardin semble d’emblée violer cette sage maxime. Mais les sentiers de ce jardin ne bifurquent pas vraiment, disons entre la droite et la gauche, ils sont en superposition, la droite et la gauche « en même temps ».
C’est cette conception de l’avenir qui, sous le nom de temps du projet, m’a permis de bâtir ce que j’ai appelé le catastrophisme éclairé. La phrase que vous citez et qui figure dans un essai de Borges ressemble à une contradiction dans les termes. Mon travail a consisté à transformer cette contradiction en paradoxe. Je suis parti de la conception de l’avenir qui est celle de beaucoup de populations rurales dans le monde. Une catastrophe personnelle se produit, la perte d’un enfant, disons. Le fatalisme inhérent à ces peuples conduit à dire : c’était écrit, depuis toujours. Mais cela n’implique pas qu’avant l’événement fatal, la chose était tenue pour inévitable. Les deux possibilités — l’événement se produit, d’un côté ; de l’autre, il ne se produit pas — étaient vraies en même temps. C’est la survenue de l’événement qui fait qu’il devient vrai qu’il était de tout temps inévitable.
Le concept à construire est celui de nécessité rétrospective. C’est ce concept qui est au cœur du récit de Borges.
Vous racontez dans le livre les très nombreux questionnements que soulève Borges dans ses textes et qui vous ont passionné dès le début (p. 9). Avez-vous trouvé depuis des réponses à certains d’entre eux, ceux-ci par exemple : « Une fiction peut-elle façonner la réalité ? » ou encore « Le hasard crée-t-il nécessairement du chaos ou peut-il avoir un pouvoir organisateur ? »
Tous les travaux aboutis — mais certainement pas définitifs — que je présente dans ce livre résultent, par le fait de ma méthode de « reverse engineering », de l’influence que Borges a exercée sur moi, même si c’est inconsciemment.
Tous, donc, ont trouvé une réponse.
Il y a des questions aussi diverses que le Carnaval brésilien et les paniques financières, la catastrophe de Tchernobyl, les élections présidentielles américaines, l’arme et la guerre nucléaires, la mort, la violence et le sacré, l’antisémitisme chrétien, le nouveau roman et la nature de la littérature et, surtout, omniprésent, lancinant, le grand mystère du temps qui ne peut s’approcher que par une démarche où abondent les paradoxes.
Sur le hasard créateur, j’ai consacré à ce thème plusieurs décennies de ma vie et même créé au sein de l’École Polytechnique, mon alma mater, un centre de recherches philosophiques où ce thème a servi d’attracteur. En arrière-fond, il y a le défi de penser un ordre sans designer, que celui-ci soit Dieu ou l’homme. On parle alors de systèmes à auto-organisation, de complexité et d’autotranscendance. Les sciences cognitives ne sont pas loin, ni la question politique de l’autonomie. Quant au rapport entre la fiction et la réalité, je crois que ce que j’ai fait de mieux, c’est de travailler… sur Borges.
Borges fut un être souffrant de son incomplétude, une infamie pensait-il, et nous suppliant, nous ses lecteurs, d’au moins le comprendre.
Jean-Pierre Dupuy
En quoi Borges a influencé la critique littéraire française des années 1960 et 1970, avec notamment cette célèbre et brillante phrase qui se trouve dans la « Note préliminaire » du Sartor Resartus de Carlyle que vous traduisez ainsi : « La littérature est un jeu avec des conventions tacites. Les violer totalement ou partiellement est l’une des nombreuses joies (une des nombreuses obligations) du jeu, dont les limites sont inconnues. » ?
À cette époque, le nom de Borges était en France sur les lèvres de tous les intellectuels qui se voulaient à l’avant-garde.
Des livres comme Le récit spéculaire : essai sur la mise en abyme, de Lucien Dällenbach (1977), Pour une théorie du nouveau roman, de Jean Ricardou (1971) et déjà Le Degré zéro de l’écriture de Roland Barthes (1953) se voulaient des variations sur les intuitions de Borges. On répétait des phrases comme « Toute la littérature peut dire : ‘Larvatus prodeo’, je m’avance en désignant mon masque du doigt » (Barthes) ou encore « Le signe des grands récits est que la fiction qu’ils proposent n’est rien d’autre que la dramatisation de leur propre fonctionnement » (Ricardou) en les rapportant à Borges.
Dans mon livre, je m’amuse à appliquer ce type de lecture « néo-borgésienne » au chef d’œuvre du grand romancier britannique Ian McEwan, Atonement (« Expiation »). « Ça marche », mais je ne suis pas sûr que ces jeux de langage rendent justice à la profondeur de ce roman, au vertige qui s’empare du lecteur du fait moins de sa forme que du poids d’humanité qu’il charrie.
Ce que j’ai essayé de faire, dans mon livre, c’est de montrer que Borges fut un être souffrant de son incomplétude, une infamie pensait-il, et nous suppliant, nous ses lecteurs, d’au moins le comprendre.
25 mai 2025
Collé à partir de <https://legrandcontinent.eu/fr/2025/05/25/le-secret-de-jorge-luis-borges-une-conversation-avec-jean-pierre-dupuy/>