

Technologia imperatores : aux racines de la fascination des « tech bros » pour l’Empire romain
Par Damien Leloup et Alexandre Piquard
Les grands patrons de la Silicon Valley sont presque tous captivés par l’Empire romain et sa chute. Une obsession qui met au jour leur vision du monde.
A la fin de 2023, alors qu’Elon Musk flirte sur X avec l’influenceuse conservatrice Ashley St. Clair, ils échangent des plaisanteries autour d’un mème populaire à l’époque sur les réseaux sociaux, qui consiste à demander à des hommes « à quelle fréquence ils pensent à l’Empire romain ». Dix-huit mois plus tard, Ashley St. Clair annonce qu’elle a donné naissance au treizième enfant connu d’Elon Musk.
Ils lui ont choisi le prénom de Romulus, dernier venu d’une fratrie recomposée que le patron de Tesla, X et SpaceX appelle, en privé, sa « légion ». Pour ses trois filles, le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, a, quant à lui, opté pour des noms inspirés d’empereurs romains : Maxima, August et Aurelia. Et lorsque les deux hommes ont envisagé, courant 2023, de s’affronter dans un combat de MMA (Mixed Martial Arts, arts martiaux mixtes), Elon Musk a proposé de l’organiser à Rome, dans le Colisée.
De nombreux patrons des grandes entreprises du numérique vouent une fascination à l’Empire romain. Palmer Luckey, le pionnier de la réalité virtuelle reconverti dans les drones militaires chez Anduril, veut créer une simulation ultraréaliste de la Rome antique. Jack Dorsey, le créateur de Twitter (aujourd’hui X), dresse volontiers un parallèle entre l’avènement d’Internet et le développement des aqueducs par l’Empire romain. Quant au puissant investisseur Marc Andreessen, il compare la Californie à « Rome en 250 après Jésus-Christ, car on vit une explosion de culture et de créativité, mais les routes ne sont plus sûres et personne ne sait vraiment pourquoi ».
Mark Zuckerberg, qui a un bon niveau de latin, se passionne pour Rome, au point d’avoir récemment conçu lui-même des tee-shirts détournant des locutions latines. Par exemple : « Carthago delenda est » (« Carthage doit être détruite »), ou une autre formule qui lui avait valu quelques railleries : « Aut Zuck aut Nihil » (« Ou Zuck ou rien ») – allusion au « Aut Caesar aut nihil » (« Ou César ou rien ») prêté à César Borgia, le « Prince » de Machiavel.

Mark Zuckerberg, lors d’un jogging, à Rome, en 2016. MARK ZUCKERBERG/FACEBOOK
Pourquoi ces multimilliardaires du numérique partagent-ils cette attirance pour un empire disparu il y a plus de quinze siècles ? Pour Honor Cargill-Martin, historienne britannique spécialiste de l’Antiquité, « une partie de l’explication est sans doute assez simple : ce sont des hommes de pouvoir et, en Occident, Rome est le premier paradigme que nous avons pour le pouvoir ». La chercheuse voit aussi un rapprochement possible, pour ces patrons, entre l’Empire romain, fruit de siècles de conquêtes, et leurs propres entreprises parties de rien, qui ont connu une croissance exponentielle dans le monde entier.
Une référence historique fondamentale
Rome véhicule aussi une image très évocatrice aux yeux de patrons qui se définissent avant tout comme des ingénieurs. « Les Romains eux-mêmes pensaient que leurs succès n’étaient pas seulement dus à leur courage et à la faveur des dieux, mais aussi au fait qu’ils étaient les meilleurs logisticiens », note Honor Cargill-Martin. Ainsi, les représentations célébrant la puissance de Rome montrent très fréquemment les soldats construisant des routes, des ponts ou des fortins, et la permanence de ces infrastructures au fil des siècles est séduisante pour des entrepreneurs, relève le sociologue Olivier Alexandre, spécialiste de la Silicon Valley.
« C’est aussi, dans l’esprit de certains de ces dirigeants, un moyen de combattre l’idée du différentialisme culturel, selon laquelle on ne peut pas hiérarchiser les différentes histoires. Il y aurait des principes de hiérarchisation qui tiennent à la technique, à l’innovation, à la structuration de l’économie, à la tradition d’ingénierie, à la maîtrise des mathématiques », observe-t-il. Autant de compétences qui se trouvent être les points forts des entrepreneurs du numérique.
Mais Rome représente aussi, pour les Américains, une référence historique fondamentale. Au moment de leur naissance, les Etats-Unis veulent couper les ponts avec l’Empire britannique et, par extension, avec les monarchies – de la même manière que les Romains, en 509 avant notre ère, ont chassé le roi étrusque Tarquin le Superbe pour instaurer la République. Encore aujourd’hui, « les Américains apprennent à l’école que la démocratie est inventée en Grèce au Ve siècle avant Jésus-Christ, puis arrive à Rome, avant de renaître aux Etats-Unis », explique Caroline Winterer, professeure d’histoire antique à Stanford et spécialiste de l’influence de Rome dans la vie politique américaine.
Les magnats du numérique adorent Rome. Ils parlent parfois de Sparte, la cité grecque de la guerre et des lois, mais n’évoquent presque jamais la démocratie athénienne, relève-t-elle. « L’âge classique d’Athènes était celui des philosophes, du débat d’idées, du pouvoir suprême du peuple. Ce n’est pas ce que souhaitent ces chefs d’entreprise : ils n’ont aucune envie de partager le pouvoir avec leurs employés ! Même lorsqu’ils évoquent Rome, ils parlent bien davantage de l’Empire que de la République, du partage du pouvoir entre le Sénat et les tribuns de la plèbe. »
Obsession pour la chute de l’Empire
Car la comparaison avec Rome est avant tout politique. Elon Musk, en particulier, l’évoque surtout pour conjurer la peur du déclin et de la chute, en établissant un parallèle entre la Rome du Bas-Empire et ce qu’il perçoit de la situation actuelle des Etats-Unis. « L’Amérique est la nouvelle Rome », lançait-il sans détour sur X, à la fin de 2024. La même année, invité dans le podcast de son ami Lex Fridman, il citait l’Empire romain à l’appui de l’une de ses obsessions : la chute de la natalité aux Etats-Unis. « Rome est tombée parce que les Romains ont arrêté de faire des Romains. Il y a aussi eu la malaria », assénait Elon Musk. « Est-ce vraiment si simple ? », l’interrogeait Lex Fridman. « Si une civilisation ne remplace pas ses membres, elle meurt », rétorquait l’entrepreneur.
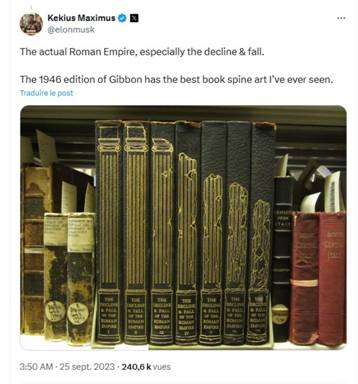
Message d’Elon Musk vantant l’édition de 1946 des livres de l’historien anglais Edward Gibbon.
« C’est juste un appel du pied à l’extrême droite », s’agace Paul Cooper, historien et créateur du podcast « Fall of Civilizations », consacré aux civilisations disparues, dont Elon Musk dit pourtant qu’il est son podcast préféré. « Ce qu’Elon Musk sous-entend, c’est que la bonne sorte de personnes ne fait pas assez de bébés, et que si celles-ci le faisaient, on pourrait mettre fin à toute immigration. Il utilise ces références à l’histoire antique pour justifier ses fantasmes d’extrême droite », estime l’historien.
Les raisons de la chute de l’Empire font l’objet, depuis quinze siècles, de discussions sans fin (l’historien allemand Alexander Demandt a répertorié pas moins de 210 théories). Faute de données statistiques, la dénatalité que l’Empire aurait subie entre le IIIe et le VIe siècles est impossible à quantifier. Cela n’a pas empêché cette thèse, souvent associée à l’idée d’une décadence causée par le relâchement des mœurs, de s’imposer comme un grand classique, en particulier chez les auteurs les plus conservateurs.
« M. Musk semble avoir trouvé cette idée chez [l’historien américain, mort en 1981] Will Durant, qu’il a cité dans une interview, note Paul Cooper. Mais les archéologues contemporains n’ont trouvé aucune preuve du fait que cela avait été une cause centrale de la chute de l’Empire romain. »
Elon Musk cite aussi, beaucoup plus fréquemment, une autre référence : l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, de l’historien anglais Edward Gibbon (1737-1794), dont les six volumes ont été publiés à la fin du XVIIIe siècle et qui reste un classique incontournable, ainsi qu’un authentique best-seller, dans le monde anglo-saxon. « M. Gibbon est un maître incontesté du récit historique et il inaugure quelque chose de très radical pour l’époque : au lieu de fixer la chute de l’Empire à un moment précis, il part du principe qu’il s’agit d’un processus long », explique Honor Cargill-Martin. Dans son analyse, les deux raisons principales de l’effondrement de Rome sont claires : une forme de corruption morale qui s’empare des élites, doublée de l’avènement du christianisme.
« Pour Gibbon, la cause principale de la chute de Rome, c’est le christianisme. Son livre a été interdit par le pape, détaille Caroline Winterer. A ses yeux, le christianisme est ce qui transforme le courageux guerrier romain en un être qui se préoccupe davantage de l’au-delà que de l’Empire, qui tend l’autre joue, aime son prochain, au détriment des anciennes valeurs martiales. Une lecture de la situation américaine à l’aune de Gibbon consisterait à dire que le problème des Etats-Unis, c’est le christianisme. Mais, bien sûr, ce n’est pas une lecture qui plairait à la droite. » A moins de voir, dans les premiers chrétiens, l’équivalent des militants aujourd’hui qualifiés de « woke » par la droite américaine…
La figure de Marc Aurèle comme idéal
Gibbon était un homme de son temps, un intellectuel protestant (malgré une courte parenthèse catholique durant son adolescence à Oxford) et le membre d’une élite anglaise craignant plus que tout d’être « diluée » dans l’Empire britannique, à la manière des vieilles familles sénatoriales romaines voyant arriver peu à peu, à mesure que l’Empire grandissait, de nouveaux hommes forts nés en Orient ou en Afrique. « Il était député et siégeait au Parlement britannique lors de la révolution américaine, rappelle Caroline Winterer. Il écrivait dans un contexte où, pour la première fois, l’Empire britannique commençait à rétrécir. C’est aussi cela qui l’a incité à réfléchir à ce qui fait qu’un empire se disloque. »
L’influence de l’œuvre de Gibbon a même largement débordé du terrain de l’histoire pour irriguer la culture populaire et la science-fiction dont sont friands les patrons de la tech. Elle représente l’une des principales sources d’inspiration de l’auteur de science-fiction Isaac Asimov (1920-1992) pour son cycle de romans Fondation, mettant en scène la chute inéluctable d’un empire galactique et la lente renaissance qui s’ensuit.
Elon Musk évoque régulièrement l’influence majeure de Fondation, qui l’a incité à créer SpaceX et, plus généralement, à se passionner pour la conquête spatiale. De fait, en 2018, il a envoyé des exemplaires de ces livres dans l’espace. Et, en mars 2025, on a appris la naissance de son quatorzième enfant (connu), prénommé… Seldon Lycurgus. Une manière d’accoler la figure du personnage central de Fondation, Hari Seldon, à celle du grand législateur de la Sparte antique.
L’idéal de ces grands patrons, c’est la figure de l’empereur Marc Aurèle, estime Caroline Winterer, mais dans sa version du film Gladiator, de Ridley Scott – celle du « bon empereur, qui se tient aux côtés [du général et futur esclave, puis gladiateur] Maximus, qui a connu la guerre et ressemble à un philosophe ». Le capital-risqueur de la Silicon Valley Marc Andreessen et le célèbre podcasteur Joe Rogan, tous deux ralliés à Donald Trump, dressent un parallèle entre le « sens des responsabilités » (voire du sacrifice) de Marc Aurèle et l’engagement en politique du président des Etats-Unis et de certains de ses partisans, comme les entrepreneurs Elon Musk, Vivek Ramaswamy ou J. D. Vance (aujourd’hui vice-président), qui « auraient très bien pu faire autre chose ».
« Ma partie préférée des méditations [de Marc Aurèle], c’est quand il dit : “Vous allez vous lever ce matin et tout le monde va vous détester, vous mentir, prendre de mauvaises décisions et vous allez être très frustré et ne recevoir aucune reconnaissance pour tout ce que vous faites, mais vous devez quand même vous lever” », racontait Marc Andreessen dans une émission de novembre 2024, voyant, dans l’approche stoïcienne de Marc Aurèle, une symétrie évidente avec la fonction de président-directeur général.
L’empereur philosophe Marc Aurèle dissertait certes sur l’âme humaine, mais il était considéré comme l’égal d’un dieu, et il a dirigé l’Empire sans partage jusqu’à son dernier souffle. Tout le contraire du modèle de désintéressement vanté par les Pères fondateurs de la démocratie américaine : Cincinnatus, ce patricien des débuts de l’époque républicaine qui s’était vu supplier par les Romains d’assumer la dictature tandis qu’il labourait ses terres, qui était retourné à sa charrue une fois cette mission accomplie, et dont ils voyaient en George Washington un équivalent moderne.
Marc Andreessen, vétéran de la tech qui fonda Netscape, loue la notion de « vertu, au sens romain », qui ne se limite pas à « être de “bonnes personnes”, mais implique aussi d’agir et de prendre les choses en main » – toutes facultés que les Romains de l’Antiquité prêtaient uniquement à l’homme (« vir », en latin). Joe Rogan note en réponse que ce genre de « doctrine » « manque dans la société séculière d’aujourd’hui », alors qu’elle est présente dans la « religion » et la « vraie chrétienté », c’est-à-dire pas la « version géante et subvertie de la chrétienté qu’on pratique dans les stades, avec des prêtres qui voyagent en jet privé et en Rolls-Royce ».
Dis-moi quel empereur tu préfères…
Dans une Silicon Valley peu sensible à la religion et au protestantisme américain, les grands hommes romains peuvent prendre place dans une sorte de panthéon païen. « Chez les dirigeants de la tech californienne, les références les plus utilisées en politique sont soit des grandes figures de l’Antiquité, soit des Pères fondateurs américains comme Thomas Jefferson ou Alexander Hamilton, soit, enfin, des personnages de science-fiction », remarque le sociologue Olivier Alexandre.
« Au-delà de l’unité de la symbolique antique, ces références permettent aussi d’identifier les différentes manières dont les dirigeants de la tech s’autoqualifient. Ce n’est pas la même chose de s’identifier au Macédonien Alexandre le Grand, comme le fait Elon Musk, que de s’identifier à l’empereur Auguste, comme le fait Mark Zuckerberg », analyse-t-il. Dis-moi à quel empereur tu rêves, je te dirai qui tu es…
« Je suis la réincarnation de l’esprit d’Alexandre le Grand », avait lancé à un investisseur médusé le jeune Elon Musk il y a trente ans, lors d’un rendez-vous de présentation de sa start-up de numérisation des Pages jaunes Zip2, rapporte Faiz Siddiqui, journaliste au Washington Post, dans sa biographie du patron de Tesla, Hubris Maximus : The Shattering of Elon Musk (« hubris maximus : la chute d’Elon Musk », St. Martin’s, 2025, non traduit). Et qui mieux qu’Alexandre (356-323 av. J.-C.), petit roi de Macédoine à l’intarissable soif de conquêtes devenu, en quelques années, le maître d’un immense empire allant de l’Egypte aux rives de l’Indus, pouvait être digne de servir de modèle au futur homme le plus riche du monde ?
L’Antiquité qui fascine ces patrons est aussi et surtout celle où « de grands hommes faisaient de grandes choses et où on leur érigeait des statues », note un ancien haut responsable de l’un de ces géants de la tech, pour qui ces entrepreneurs, devenus des « méchants » dans le discours public, sont aussi en quête de reconnaissance populaire.

Elon Musk, lors d’une visite au Colisée, à Rome, en 2023.
Pour sa part, Mark Zuckerberg met depuis longtemps en avant sa passion pour l’un des « plus grands » Romains : Auguste (63 avant J.-C. - 14 après J.-C.). Le premier empereur a eu un rôle dans le choix de Rome comme destination de son voyage de noces. « Ma femme se moquait de moi. Elle disait qu’elle avait l’impression que nous étions trois en lune de miel : moi, elle et Auguste. Toutes les photos étaient des sculptures d’Auguste », a-t-il raconté avec amusement au New Yorker, en 2018.
Face sombre
Le fondateur de Meta continue de vouer un culte à celui dont beaucoup d’internautes le soupçonnaient de s’être inspiré pour sa coupe de cheveux, avant qu’il opte récemment pour un look aux boucles plus débridées. Sur l’un de ses tee-shirts maison est écrit en latin : « A l’âge de 19 ans, j’ai levé une armée, de ma propre initiative et à mes propres frais. » Une citation tirée du récit Res gestae divi Augusti, laissé par Auguste… et un parallèle assez évident avec lui-même, qui fonda Facebook à 19 ans. Que voit Mark Zuckerberg dans ce chef romain ? « En gros, avec une approche très dure, il a établi deux cents ans de paix dans le monde », avait-il théorisé dans le New Yorker, décrivant Auguste comme une « figure complexe », ambiguë mais « fascinante ».
Les différences de caractère attribuées à Alexandre le Grand et Auguste se retrouveraient en partie chez leurs aspirants héritiers : « Elon Musk est fougueux, tempétueux, martien au sens mythologique du terme, et il vit dans la confrontation quasiment physique, alors que Zuckerberg a un rapport au politique beaucoup plus distancié, stratège et patient », pense Olivier Alexandre. De plus, la geste d’Alexandre dure à peine quinze ans et s’achève par l’éclatement de son empire, tandis que le magistère d’Auguste s’étend sur six décennies…
Certes, le personnage d’Auguste a, comme le dit avec euphémisme le dirigeant de Meta, une face sombre : vainqueur de Marc Antoine, qui lui contestait la succession de César, il conquiert l’Egypte, le nord de l’Espagne et une partie de l’Europe centrale. Mais il reste surtout connu pour avoir mis un terme à la République romaine en prétendant la sauver, jetant les bases du principat, qu’on appellera par la suite l’Empire.
« Auguste est un personnage assez fascinant, qui est devenu un despote et un tyran sans jamais en donner l’apparence, rappelle Olivier Alexandre. Il est lié à un règne de paix et n’est pas vu comme un conquérant, mais il a beaucoup manœuvré politiquement, su nouer des alliances et commettre des trahisons. Il est, au fil du temps, devenu une figure de sagesse qui ne correspond pas tout à fait à son action politique, également empreinte d’une forme de brutalité et de détournement de l’esprit des institutions. »
Culte de l’homme fort
Invoquer Rome peut, bien sûr, servir les partisans du recours à un homme fort. Ainsi, la métaphore impériale antique est idéale pour les conservateurs américains, constate Honor Cargill-Martin, parce qu’elle combine à la fois le thème du déclin moral, omniprésent chez Edward Gibbon, et l’idée d’un exceptionnalisme des Etats-Unis, perçus comme une version moderne de la Rome éternelle. Si les barbares sont aux portes, il faudrait, comme à Rome, un empereur bienveillant, un dictateur au sens historique, qui utiliserait ses pleins pouvoirs pour sauver l’Etat américain.
« Peut-être avons-nous besoin d’un Sylla », spéculait ainsi Elon Musk, en 2023, dans une conversation sur X avec son ami entrepreneur David Sacks, qui dit lui-même que sa période historique préférée est la chute de la République romaine. Sylla (138-78 avant J.-C.) est connu pour avoir mis un terme aux luttes de factions à coups de proscriptions, ouvrant la voie à une période d’autoritarisme forcené pour rétablir les pouvoirs exclusifs de l’oligarchie sénatoriale.
La référence à Rome sert même de canevas politique à une frange des trumpistes, notamment issus de la tech, qui souhaitent saper la démocratie américaine pour instaurer un « changement de régime », note l’écrivain Giuliano da Empoli. « Leur idée, explicitement théorisée par Curtis Yarvin, un blogueur influent très proche de J. D. Vance et du [cofondateur de Paypal et investisseur] Peter Thiel, est que Trump est le véhicule pour basculer de la République romaine à l’Empire » et qu’il « doit s’emparer de tous les instruments du pouvoir, comme s’il était un monarque doté de pouvoirs absolus », a expliqué l’auteur italo-suisse de L’Heure des prédateurs (Gallimard, 2025), dans un entretien au Monde paru le 21 avril.

Un supporteur de Donald Trump devant le stand du « Third Term Project », à la Conservative Political Action Conference (conférence d’action politique conservatrice), la grand-messe annuelle des conservateurs américains, en février 2025. YOUTUBE
Pour défendre son argument en faveur du passage à une forme de « monarchie », Curtis Yarvin a noté, dans un podcast de 2022, « qu’Auguste n’était pas le représentant des factions romaines, mais le dirigeant [“ruler”, en anglais] de Rome ». Figure unificatrice, Auguste, tout comme César avant lui, ne représente ni le camp « bleu » ni le camp « rouge » – une référence aux couleurs des partis démocrate et républicain aux Etats-Unis. De façon plus directe, en février, des militants trumpistes ont, à l’occasion de la Conservative Political Action Conference (« conférence d’action politique conservatrice »), la grand-messe annuelle des conservateurs américains, déployé une banderole montrant le profil de Donald Trump en empereur romain. Objectif : promouvoir leur mouvement, le « Third Term Project », visant à changer la Constitution américaine afin de permettre au président de briguer un troisième mandat – perspective que l’intéressé a depuis cru bon de démentir.
« Les acteurs de la tech [qui ont rallié Trump] puisent leurs références dans l’histoire antique pour les mêmes raisons que les fascistes et les autocrates l’ont fait par le passé, à commencer par [Benito] Mussolini. Dès qu’un autocrate prend le pouvoir, il cherche à légitimer son règne par un retour nostalgique à l’Antiquité. [L’ancien dictateur irakien] Saddam Hussein a fait la même chose, en se présentant comme l’héritier [du roi de Babylone] Nabuchodonosor », pense l’historien et podcasteur Paul Cooper, qui dénonce l’essor, aux Etats-Unis, d’une idéologie « technofasciste ». « On retrouve la référence à l’Empire romain – par le biais de l’imperium [le pouvoir suprême, civil et militaire], de l’aigle ou de l’idée d’un empire puissant et durable – dans tous les fascismes », note Olivier Alexandre.
Influences masculinistes
Une personne au profil atypique, à la fois spécialiste universitaire de l’Empire romain et proche du milieu de la tech, avait, dès 2018, alerté sur l’usage politique des références antiques dans les discours sur Internet de l’alt-right, la droite de la droite américaine : Donna Zuckerberg, chercheuse en lettres classiques et sœur cadette de Mark Zuckerberg.
Deux ans après la première élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, cette ex-rédactrice en chef de la revue spécialisée Eidolon publiait Not All Dead White Men (« pas tous les hommes blancs morts », Harvard University Press, non traduit), un essai remarqué décrivant la manière dont des courants masculinistes s’étaient emparés de références issues de l’Antiquité, et notamment du stoïcisme, en les dévoyant, selon elle.
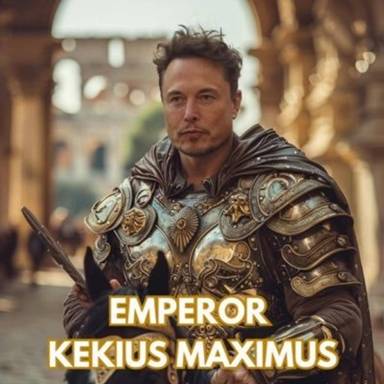
Photo de profil utilisée par Elon Musk sur le réseau social X, générée à l’aide d’une intelligence artificielle.
Quel regard Donna Zuckerberg porte-t-elle aujourd’hui sur la fréquence des références à Rome chez les patrons de la tech ? « Le “déclin” et la “chute” de Rome ont été grandement mésinterprétés et exagérés, explique-t-elle au Monde. Certes, le siège du pouvoir est passé à Constantinople [siège de l’Empire romain d’Orient], mais l’Empire a continué d’exister pendant mille ans », relativise la chercheuse, ajoutant que « l’idée de Rome comme symbole du pouvoir » est restée attrayante, depuis les Empires russe ou britannique jusqu’à ceux des « titans » de l’économie américaine, tous prompts à s’imaginer en « nouvelle Rome ».
Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Mark Zuckerberg veut plus d’« énergie masculine » et moins de politique de diversité
Donna Zuckerberg estime aussi que le discours des dirigeants du numérique rejoint le récit classique qui associe Rome aux « grands hommes ». « Je pense que [l’homme politique et orateur] Cicéron a joué un rôle-clé dans la manière dont nous comprenons la fin de la République romaine : pour différentes raisons, il voulait montrer Rome comme une méritocratie où les hommes de grand talent, comme lui-même, parvenaient au sommet », analyse la sœur du dirigeant de Meta. Avant de mettre en garde : « Il y a une forme d’identification et l’idée que la Silicon Valley, comme Rome, est une méritocratie. Mais, bien sûr, la réalité est nettement plus complexe et élude les structures de pouvoir qui facilitent le chemin vers le succès des hommes riches et bien connectés. » Comme une invitation à se replonger dans l’Antiquité glorieuse, avec moins de narcissisme et plus d’humilité.
Le Monde 06/06/2025