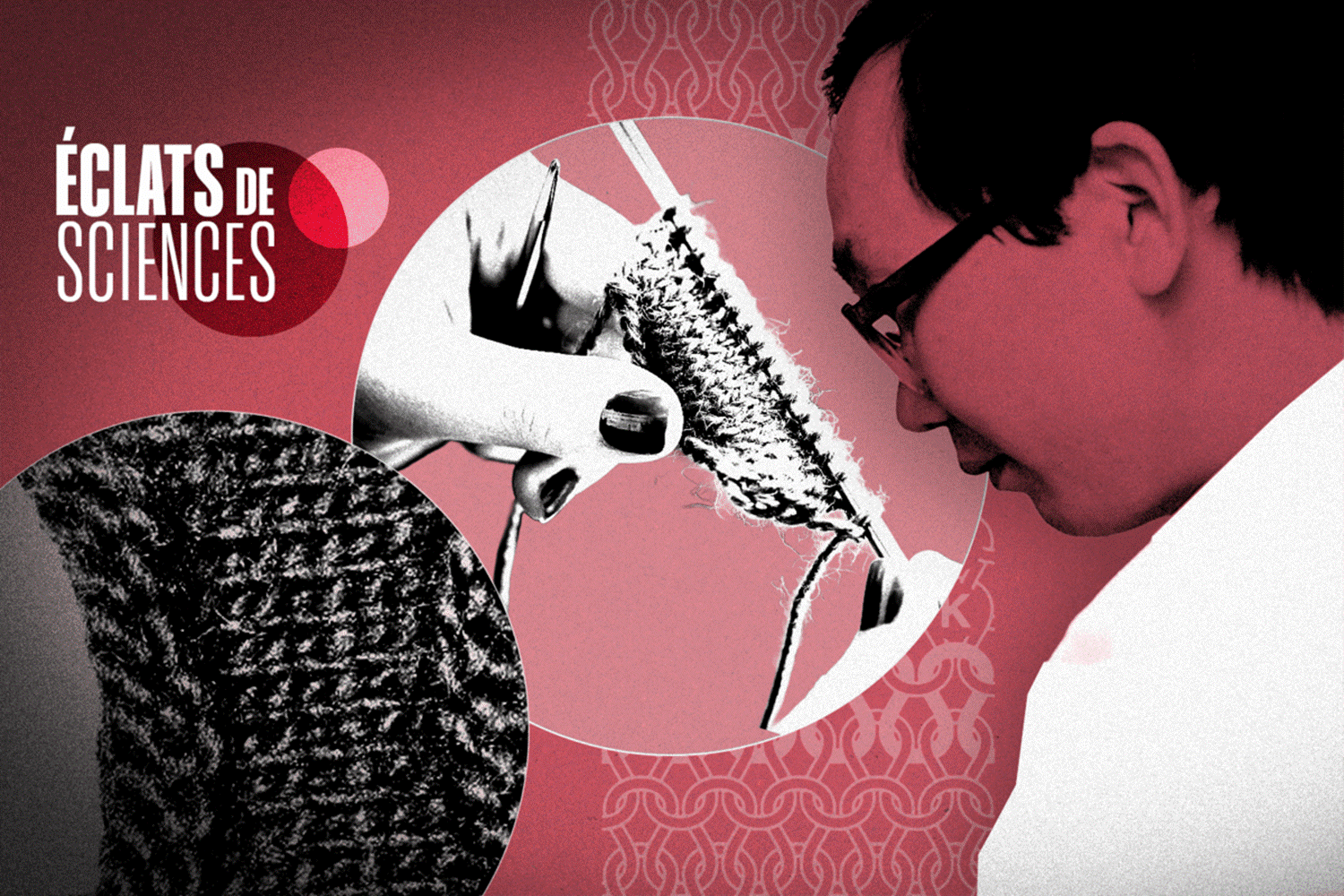
Des scientifiques tentent de percer un grand mystère : l’art du tricot
Bien que les humains tricotent depuis des milliers d’années, cette pratique reste encore très peu comprise d’un point de vue scientifique. Mais à mesure que son étude progresse, les scientifiques prennent conscience de son potentiel, au point de vouloir créer des jumeaux numériques de ces ouvrages.
28 juin 2025
Dans leurs laboratoires, vous ne trouverez ni nouveau polymère compliqué ni structures en carbone sophistiquées. À la place, leurs étagères et bureaux sont remplis d’écharpes tricotées aux motifs variés. Un matériau qui, sous ses airs anodins, donne bien du fil à retordre aux scientifiques. Et qui pourrait, s’il était mieux compris, s’appliquer à d’autres domaines que les vêtements, en particulier la robotique ou la médecine. Pour mieux déchiffrer le tricot, des équipes de l’université Drexel et de l’université de Pennsylvanie aux États-Unis viennent de concevoir un modèle qui prédit la forme d’un tissu à partir de la répartition de types de nœuds envisagée.
« Ce matériau a des propriétés mécaniques fascinantes et peu communes par rapport aux autres : il est léger, flexible, se déforme facilement », énumère Audrey Steinberger, chercheuse à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, qui se passionne pour le tricot depuis ses années post-doctorat. À partir d’un fil, de deux grosses aiguilles et d’un peu de temps, on obtient un objet à peu près plat (une écharpe par exemple) ou une structure en volume pour les plus habiles.
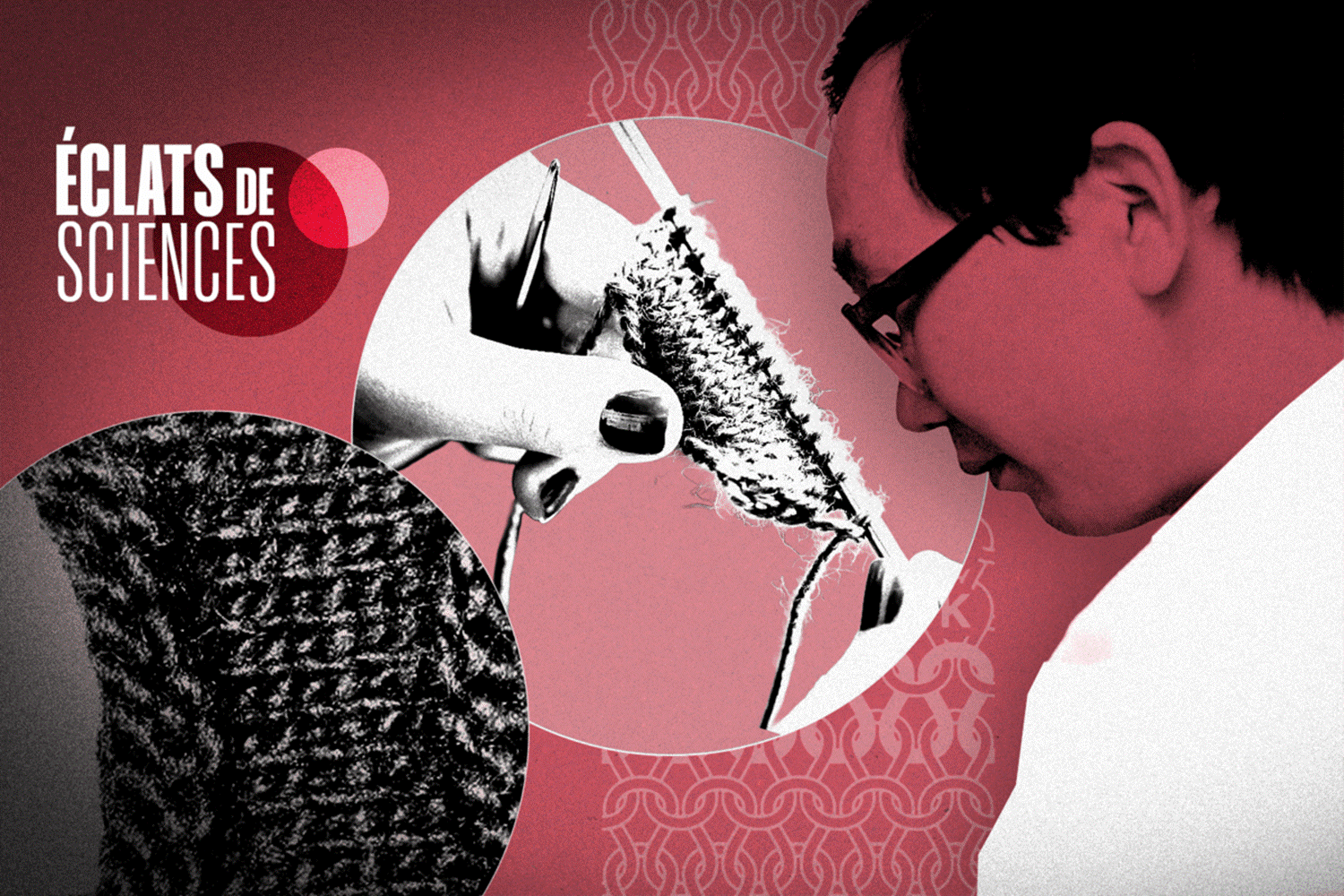
© Illustration Justine Vernier / Mediapart
À force d’empiler des mailles, le matériau acquiert de nouvelles propriétés : alors que le fil n’était pas élastique, le tricot est quant à lui étirable. On parle de métamatériau, un objet qui acquiert des propriétés non pas de ses constituants (le fil) mais de sa géométrie (l’enchaînement de nœuds). « Le tricot est un matériau dont les propriétés ne peuvent pas se déduire facilement de celles du fil », ajoute Frédéric Lechenault, chercheur du CNRS au laboratoire de physique de l’ENS à Paris.
Cet aspect rend le textile tricoté intéressant côté applications : en devinant les caractéristiques émergeant des mailles, on peut concevoir des matériaux sur mesure simplement en jouant avec les différents nœuds. C’est justement ce que les chercheurs et chercheuses de Pennsylvanie tentent de faire dans leur récente publication.
Comprendre les secousses sismiques
« Quand on a commencé à s’intéresser à ce sujet, c’est parti en buzz. Des physiciens qui s’intéressent au tricot, cela semble ridicule », s’amuse Frédéric Lechenault. À la fin des années 2010, ils étaient parmi les premiers scientifiques à tenter de démêler les propriétés de ce métamatériau. Ils établissent alors un modèle simple pour décrire en équation la trajectoire des points quand on l’étire. Ce travail leur permet notamment de comprendre pourquoi cet entremêlement de mailles est élastique alors que le fil ne l’est pas. « Le fil a cette propriété qu’il est beaucoup plus facile de le fléchir [la courbure qui se crée quand on rapproche les extrémités – ndlr] que de l’étirer. En fait, quand on tire sur une écharpe, l’élasticité vient non pas du fil qui s’étire mais du fil qui se fléchit », explique-t-il.
Mais une fois les pieds pris dans la pelote de laine, difficile d’en sortir : les questions affluent sur ce sujet. Frédéric Lechenault et ses collègues se rendent alors compte que le tricot aide à comprendre les secousses sismiques, car des failles dans le tissu ont des similitudes avec celles de la Terre.
Comprendre la science derrière le tricot, c’est très coûteux du point de vue des calculs .
Geneviève Dion, chercheuse à l’université de Drexel et ancienne créatrice de mode
Puis ses coauteurs diffusent l’intérêt de cette pratique à d’autres équipes. Par exemple, ils constatent avec Audrey Steinberger qu’un tricot a plusieurs positions d’équilibre. Contrairement à un élastique, un objet tricoté peut tenir en place dans plusieurs positions différentes : qu’on le plie, qu’on le mette à plat, qu’on le mette en boule, il va rester dans cette forme. Cette multistabilité provient des frottements du fil aux points de contact des boucles. « La friction fait que le tricot ne bouge pas », explique Audrey Steinberger.
Le souci, c’est que cet objet ne se laisse pas facilement scruter. « C’est un système très compliqué, c’est un seul fil enchevêtré avec lui-même », souligne Frédéric Lechenault. Pour comprendre parfaitement la situation, il faudrait prendre en compte tous les croisements de fils qui créent de la friction, les propriétés du fil comme son élasticité et son usure, la géométrie (comme le type de mailles), la longueur du fil prise dans chaque maille, la température, l’humidité…
« Pendant des milliers d’années, les gens ont manipulé cet objet et ont compris intuitivement ce qui se passait. Mais comprendre la science derrière le tricot, c’est très coûteux du point de vue des calculs », pose Geneviève Dion, chercheuse à l’université de Drexel et ancienne créatrice de mode. Résultat, « c’est un système sur lequel on ne sait pas grand-chose. On n’a fait qu’entamer légèrement la surface du problème », ajoute Frédéric Lechenault. Rien que savoir pourquoi un pull rétrécit à la machine s’il est lavé à chaud n’est pas clair !
Des tricots programmables
Ces premiers travaux laissaient espérer une opportunité pour ce métamatériau : qu’il soit possible de deviner son apparence ou ses propriétés – sans jouer des aiguilles – à partir d’une répartition de mailles. Rendre programmable le tricot. Surtout que c’est cohérent d’un point de vue technique : les machines industrielles peuvent assembler n’importe quel enchaînement de nœuds rapidement. « Quand j’ai vu ce que pouvaient faire ces machines, j’ai trouvé ça incroyable. Je me suis alors demandé comment deviner ce qui allait se passer dans le tricot. Sans cela, le processus de fabrication ne s’accélère pas », décrit Geneviève Dion. Concevoir en quelque sorte une version numérique du tissu, qui donne exactement les propriétés qu’il aura une fois qu’il sera créé.
En 2024, une équipe de l’Institut de technologie de Géorgie et de l’université du Massachusetts, aux États-Unis, constate que selon la suite des mailles choisies, les propriétés d’élasticité du tissu sont différentes. Par exemple, les tissus qui mêlent les deux mailles classiques (à l’endroit et à l’envers) sont bien plus extensibles que ceux qui ne sont qu’en mailles à l’endroit. Ils conçoivent alors un modèle qui, à partir de la distribution des nœuds, devine les propriétés élastiques du tissu.
Les applications pourraient être nombreuses : en robotique, en médecine, en électronique…
Puis, en février 2025, Geneviève Dion et ses collègues se penchent à leur tour sur la programmation du tricot. Eux s’intéressent en particulier à deviner la forme et les courbures du textile une fois les fils enchevêtrés.
Quand on tricote en maille à l’endroit, cela crée une courbure en creux dans le tissu et le matériau a tendance à s’enrouler sur lui-même. Curieusement, une fois fini, le textile est régi par un comportement contradictoire : il s’enroule sur la longueur et la largeur. « Et si je fais une maille à l’endroit, une maille à l’envers, cet effet s’efface. Tout dépend vraiment du contenu du type de mailles », explique Frédéric Lechenault.
Cet effet, Geneviève Dion l’a constaté et a même joué avec, car il est possible de créer des motifs plus originaux en mélangeant les points. « Et même si on n’utilise que les deux mailles classiques (endroit et envers), il y a des milliers de possibilités et aucun moyen de savoir comment l’ouvrage va se replier », décrit-elle. On peut créer des chevrons en volume qui s’aplatissent à la manière d’un accordéon quand on tire dessus, des ondulations, des quadrillages en creux et en bosses. Le seul moyen c’est de tâtonner, de tester, de se tromper et de recommencer.
Le modèle conçu par l’ancienne créatrice de mode et ses collègues a pour but d’accélérer ce processus. Le programme devine la forme finale, et le créateur peut l’ajuster virtuellement à ses envies ou contraintes.
L’intuition face au calcul
« Ce qu’on aimerait vraiment, c’est réussir le parfait jumeau numérique du tricot. Mais cela s’avère plus difficile qu’on l’aurait cru », ajoute Geneviève Dion. Impossible, pour l’instant, de prendre en compte tous les points et la friction au niveau des zones de contact. Il y en a trop. Leur modèle approche la forme sans entrer dans le détail. L’autre difficulté, c’est d’intégrer des points plus fantaisistes, car bien d’autres existent. Les prendre en compte enrichirait pourtant les formes et propriétés possibles.
« Même si je ne fais plus de mode aujourd’hui, je peux percevoir le potentiel de ce type d’outil pour la création », suggère Geneviève Dion. « On vient en quelque sorte mettre en équation cette technique sur laquelle on a un savoir-faire énorme, pour aider à concevoir des matériaux sur mesure ultralégers, performants et durables », apprécie Audrey Steinberger. Les applications à la clé pourraient être nombreuses, d’autant que les outils de production sont déjà existants et maîtrisés.
Dans l’habillement bien sûr, avec des vêtements adaptés à la morphologie ou des tissus originaux. Mais aussi pour étendre le tricot à d’autres domaines comme la robotique avec des structures tricotées déployables, l’électronique pour concevoir des produits portables à partir d’assemblages de fibres, ou encore en médecine pour des greffes ou des implants : en 2023, une équipe chinoise a étudié les propriétés d’un implant anti-hernie tricoté avec des filaments de polyester.
Néanmoins, alors que le tricot est une activité millénaire qui repose sur l’intuition et l’expérience, cette programmabilité ne vient-elle pas gâcher sa surprise et sa beauté ? L’ancienne créatrice de mode ne le pense pas. « Je vois ça principalement comme une opportunité, une aide pour choisir et composer ce que vous avez en tête. Cela va surtout venir réduire le nombre d’étapes dans le processus itératif d’essais et d’erreurs, et il n’y a pas de mal à ça », soutient-elle.
En tout cas, ce n’est pas la seule pratique artistique que les chercheurs tentent de capturer et d’expliquer. L’origami – le pliage de papier – est lui aussi un métamatériau scruté par les scientifiques. Un programme existe même pour, à partir de n’importe quelle forme en volume, établir la succession de plis à faire pour la créer. Mais ces tentatives de mises en équation ne nous empêchent pas de continuer à être éblouis par la dextérité d’un origamiste ou par une œuvre réalisée avec des aiguilles à tricoter.
Collé à partir de <https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/280625/des-scientifiques-tentent-de-percer-un-grand-mystere-l-art-du-tricot>