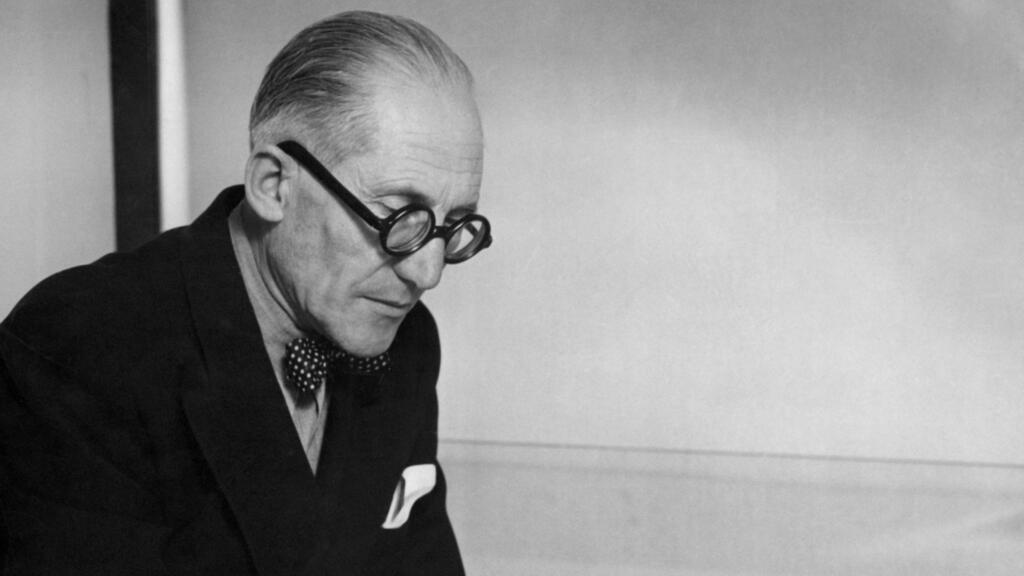
Architecture: Le Corbusier, pionnier du modernisme à l’héritage contrasté
Soixante ans après sa mort, Le Corbusier reste une figure centrale et controversée de l’architecture moderne. Aux quatre coins du monde, ses réalisations ont façonné le XXe siècle et sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Visionnaire célébré, il fut aussi décrié pour son engagement fasciste et une conception du modernisme jugée autoritaire.
Publié le : 27/08/2025
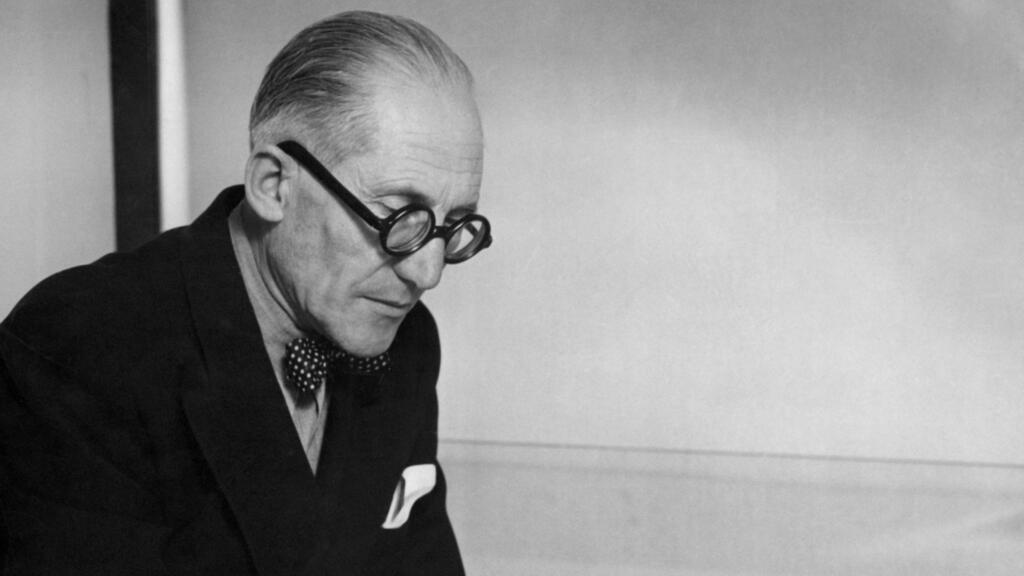
Photo datée de 1961 de Charles-Édouard Jeanneret, dit «Le Corbusier». AFP
Par : Timéo Guillon
Figure iconique de la modernité, Le Corbusier n’a cessé de diviser. Célébré pour avoir inventé un langage architectural nouveau, il a aussi été critiqué pour ses projets jugés autoritaires et son implication politique sulfureuse. Ses bâtiments, disséminés sur plusieurs continents, incarnent à la fois l’utopie d’un monde réinventé et les dérives d’une pensée parfois trop normative. Soixante ans après sa disparition, il reste un créateur incontournable dont l’œuvre, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, continue à susciter fascination et critiques.
Le Corbusier, itinéraire d'un artisan suisse à l'accent français
Né en 1887 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, Charles-Édouard Jeanneret grandit dans un environnement familial artisanal qui partage le goût du travail, de la culture et de la nature : son père est graveur, sa mère pianiste. Doué pour le dessin, il rejoint à 12 ans l’École d’art de son canton helvète, où il rencontre Charles L’Éplattenier, maître des arts décoratifs, qui devient son mentor et l’oriente vers l’architecture à ses 18 ans.
À peine majeur, Charles L’Éplattenier lui propose de réaliser la Villa Fallet, dans sa ville natale. C’est la première maison construite par celui qui ne s’appelle pas encore Le Corbusier. Avec l’argent gagné, il parcourt l’Europe durant près de cinq ans, multipliant croquis et notes qui alimenteront ses inspirations. Au début des années 1910, il sort de terre plusieurs bâtiments dont la Villa Jeanneret-Perret (1912), commandée par ses parents.
C’est à cette époque que Charles-Édouard Jeanneret se rapproche de la France et des réseaux d’architecture parisiens. Durant la Première Guerre mondiale, sans réelle clientèle, il rêve de participer à la reconstruction de la France. En février 1917, il écrit à ses parents : « Nous sommes de sales neutres occupés à des affaires », laissant sous-entendre qu’il aurait aimé prendre les armes pour la France. La même année, il s’installe définitivement à Paris, capitale de l'art et de la culture, et adopte en 1920 le pseudonyme Le Corbusier. Il se construit son personnage par la même occasion : lunettes rondes, nœud papillon et pipe à la bouche, qui forgera sa légende.
La consécration d’un maître moderne
En 1923, son manifeste Vers une architecture érige la géométrie pure en idéal esthétique : « Les formes primaires sont les belles formes, parce qu’elles se lisent clairement. » Avec son cousin Pierre Jeanneret, il conçoit de nombreuses habitations comme de véritables « machines à habiter ». En 1927, les deux hommes formalisent les célèbres « cinq points de l’architecture moderne » (pilotis, façade libre, plan libre, fenêtres en bandeau et toit-terrasse), qui s’imposent comme la pierre angulaire de la modernité.
Parmi ses premières œuvres majeures : la Maison La Roche à Paris (1925), expression emblématique du purisme, et l’Immeuble Clarté à Genève (1932), où il expérimente la façade vitrée et les duplex. Des bâtiments qui traduisent une rupture avec les styles de l’époque, annonçant une architecture pensée comme fonction, non comme ornement. Au début des années 1930, Le Corbusier est devenu incontournable dans le débat de l’architecture moderne au point où il se voit contraint de refuser certaines commandes.
En 1934, il conçoit l’Immeuble Molitor, à la frontière entre Paris et Boulogne-Billancourt, qui devient le premier immeuble d’habitation à façade entièrement vitrée. Le Corbusier y installe son appartement-atelier aux deux derniers étages. Un domicile qu’il occupera jusqu’à sa mort en 1965. « C’était un péril pour moi d’aller habiter ma propre architecture. Au vrai, c’est magnifique. C’est une vue pleine de campagne avec aucune notion d’être perché au septième et huitième étage, grâce à des stratagèmes architecturaux. Pas de vertige ainsi », écrit-il à sa mère lors de son emménagement. Pensé comme un espace fluide, modulable et baigné de lumière, ce duplex de 240 m2 est devenu, après sa disparition, un lieu patrimonial confié à la Fondation Le Corbusier, classé monument historique en 2015.
Un bâtisseur planétaire et une œuvre inscrite au patrimoine mondial
Après la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier étend son influence à une échelle planétaire. En France, il conçoit par exemple l’Unité d’Habitation de Marseille (1947-1952), surnommée la Cité radieuse : un immeuble de dix-huit étages regroupant logements, commerces, école et espaces de loisirs, pensé comme une « ville verticale ». Un projet traduisant son ambition de créer une nouvelle forme de vie collective.

Vue de la «Cité Radieuse », conçue par l'architecte Le Corbusier, construite en béton brut entre 1947 et 1952, photographiée en avril 2015 à Marseille, dans le sud de la France. AFP - BORIS HORVAT
Sur le plan international, son projet le plus emblématique demeure la ville de Chandigarh, au nord de l’Inde, commandée en 1950. Chandigarh incarne la transposition à grande échelle de ses principes d’urbanisme : plan orthogonal et fonctionnel avec des bâtiments monumentaux tels que l’Assemblée ou le Palais de justice. L’architecte contribue aussi à des projets en Amérique du Sud, au Japon ou encore en Afrique du Nord.
Cette dimension universelle a conduit l’Unesco à inscrire, en 2016, dix-sept sites conçus par Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial, répartis dans sept pays. L’organisation souligne que ses réalisations « témoignent de l’invention d’un nouveau langage architectural qui a influencé l’ensemble du XXe siècle. » Pour assurer la préservation de ce patrimoine, la Fondation Le Corbusier, créée en 1968, conserve aujourd’hui ses archives, dessins, maquettes et mobiliers, tout en supervisant la restauration des bâtiments.

Le bâtiment de l'Assemblée législative de Chandigarh, l'un des bâtiments du centre administratif de la ville conçus par Le Corbusier. Mais Chandigarh, avec ses nombreux bâtiments en ruine et sa pollution croissante, est en passe de devenir un véritable chaos urbain surpeuplé. AFP - JOHN MACDOUGALL
Un engagement fasciste révélé au grand jour
Le 27 août 1965, Le Corbusier meurt à la suite d’un malaise cardiaque à l’âge de 77 ans, laissant une empreinte indélébile sur le monde de l’architecture. Ses lignes épurées, son culte du béton et sa vision d’une « machine à habiter » continuent d’inspirer architectes et urbanistes à travers le monde, malgré de nombreuses critiques. Ses propositions, visant à raser les vieux quartiers et à les remplacer par des tours et des autoroutes (comme le Plan Voisin pour Paris en 1925), sont considérées par beaucoup comme destructrices du tissu urbain. Une esthétique autoritaire, rationnelle, parfois jugée inhumaine, mais qui a façonné durablement l’idée de modernité.
Son héritage est également terni par ses liens avec le fascisme. Après la Seconde Guerre mondiale, l’architecte est soupçonné d’antisémitisme, de collaboration. En 2015, le journaliste Xavier de Jarcy publie Le Corbusier, un fascisme français, révélant l’ampleur de la part d’ombre de l’architecte. Proche des milieux d’extrême droite, il est conseiller pour l’urbanisme auprès du gouvernement de Vichy durant la guerre. Dans plusieurs lettres écrites à sa mère, il se réjouit de la défaite française en juin 1940, permettant un « grand nettoyage » dans le pays : « L’argent, les Juifs, la franc-maçonnerie, tout subira la loi juste. Ces forteresses honteuses seront démantelées. Elles dominaient tout. » Après la guerre, Le Corbusier se fait passer pour une victime des pétainistes. Mais il restera fidèle à certaines amitiés et ne reviendra jamais sur son mépris des « populations parasitaires ».
Soixante ans après sa disparition, l’héritage de Le Corbusier continue à susciter débats et controverses. Le philosophe Roger-Pol Droit estime que les liens entre « politique fasciste et urbanisme moderniste » tendent à être minimisés. Selon lui, son « unité d’habitation de grandeur conforme » peut se lire comme une cage de béton, bien plus proche d’un rêve mussolinien que des idéaux humanistes. En 2015, une exposition lui étant consacrée au Centre Pompidou provoque la colère de Serge Klarsfeld, président de l’association des Fils et filles de déportés juifs de France. Derrière l’architecte visionnaire demeure un héritage contrasté, où grandeur créative et positions idéologiques restent indissociables.
Collé à partir de <https://www.rfi.fr/fr/connaissances/20250827-architecture-le-corbusier-pionnier-du-modernisme-%C3%A0-l-h%C3%A9ritage-contrast%C3%A9>